|
| |
|
|
 |
|
SÉMIOLOGIE |
|
|
| |
|
| |

SÉMIOLOGIE, subst. fém. A. − MÉD. Partie de la médecine qui étudie les symptômes et les signes cliniques traduisant la lésion d'un organe ou le trouble d'une fonction. Synon. sémiotique (vx), symptomatologie.La neuro-physiologie illustre parfaitement ce que la méthode anatomo-clinique a pu réaliser avec l'appoint simultané de la sémiologie, de l'histologie et de l'expérimentation (Bariéty, Coury, Hist. méd., 1963, p. 657):
1. ... après quelques oscillations on observe une fixité remarquable, subsistant longtemps et témoignant de l'exagération de l'équilibre volitionnel statique alors que l'équilibre volitionnel cinétique est déficient comme le montre l'hypermétrie. Babinski a complété l'ensemble magistral de cette sémiologie cérébelleuse en étudiant parallèlement la déséquilibration vestibulaire par l'étude des mouvements réactionnels, par l'épreuve qu'il a proposée du vertige voltaïque. Ce que la Fr. a apporté à la méd., 1946 [1943], p. 262.
B. − COMMUN., LING.
1. [Notamment chez F. de Saussure] Étude générale, science des systèmes de signes (intentionnels ou non) et des systèmes de communication:
2. On peut (...) concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale; elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par conséquent de la psychologie générale; nous la nommerons sémiologie (...). Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. (...) La linguistique n'est qu'une partie de cette science générale, les lois que découvrira la sémiologie seront applicables à la linguistique, et celle-ci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien défini dans l'ensemble des faits humains. Sauss.1916, p. 33.
2. En partic.
a) Étude des systèmes de communication (incluant ou non les langues naturelles) posés et reconnus comme tels par l'institution sociale (code de la route, signaux maritimes, etc.). Une « sémiologie de la communication », c'est-à-dire (...) une discipline qui étudie les structures sémiotiques ayant la communication pour fonction, qu'elles soient ou non des langues (L.-J. Prieto, Pertinence et prat., essai de sémiologie, 1975, p. 11):
3. ... tous les post-saussuriens (...) ont constitué (...) les bases solides d'une sémiologie qui serait d'abord la description du fonctionnement de tous les systèmes de communication non linguistiques, depuis l'affiche jusqu'au code de la route, depuis les numéros d'autobus ou de chambres d'hôtel jusqu'au code maritime international des signaux par pavillons. G. Mounin, Introd. à la sémiologie, 1970, p. 11.
b) Étude des pratiques signifiantes, des significations attachées aux faits de la vie sociale et conçus comme systèmes de signes. Synon. plus fréq. sémiotique (v. ce mot II A 2 et sémiologique B ex. de E. Benveniste).La sémiologie (...) a pour objet tout système de signes, quelle qu'en soit la substance, quelles qu'en soient les limites: les images, les gestes, les sons mélodiques, les objets et les complexes de ces substances que l'on retrouve dans des rites, des protocoles ou des spectacles constituent, sinon des « langages », du moins des systèmes de signification (R. Barthes, Le Degré zéro de l'écriture, Élém. de sémiologie, 1968 [1964], p. 79).
♦ Sémiologie littéraire, théâtrale, de l'art, du cinéma, de la peinture, etc. Étude des faits littéraires, théâtraux, cinématographiques, artistiques, etc. envisagés comme systèmes de signes. Une chose au moins est sûre: aucune sémiologie du son, de la couleur, de l'image ne se formulera en sons, en couleurs, en images. Toute sémiologie d'un système non-linguistique doit emprunter le truchement de la langue, ne peut donc exister que par et dans la sémiologie de la langue (É. Benvéniste, Probl. de la ling. gén., II, Sémiologie de la lang., 1974 [1969], p. 60).Il faut rappeler la condition fondamentale de toute sémiologie picturale: l'indissociabilité du visible et du nommable comme source du sens (Encyclop. univ.t. 141972, p. 863).
c) CARTOGR. Sémiologie graphique. ,,Étude des signes graphiques, de leurs propriétés et de leurs rapports, avec les éléments d'information qu'ils expriment`` (George 1984).
3. [Chez Hjelmslev, p. oppos. à sémiotique] Système signifiant non scientifique. Hjelmslev, tout en gardant le terme de Saussure, le dote d'une définition précise: il entend par sémiologie la métasémiotique scientifique dont la sémiotique-objet n'est pas scientifique (Greimas-Courtés1979).
4. [Dans la ling. de G. Guillaume] Système des signifiants. V. sémiologique B.
Rem. Sémiologie se trouve concurrencé, dans certaines accept. par sémiotique (supra B 2). Cette concurrence relève essentiellement de deux filiations théoriques: celle de F. de Saussure qui avait formé le projet d'une sémiologie et celle de Ch. S. Peirce qui utilise le terme de « semiotics » trad. par sémiotique. Toutefois, si la limite entre sémiologie et sémiotique est mal fixée (sauf dans la théorie glossématique de Hjelmslev), il s'agit là de deux domaines en cours de constitution: pour certains (R. Barthes) la sémiotique s'applique à un système particulier, la sémiologie étant une science générale qui regroupe diverses sémiotiques; pour d'autres, au contraire, la sémiotique suppose un domaine d'étude plus large que celui de la sémiologie.
REM.
Séméiologie, subst. fém.,var. rare (sauf dans l'accept. méd.). a) Méd. Guyon a fixé les règles de l'examen physique des reins et a précisé la séméiologie de ces deux grands symptômes urinaires qui se montrent dans la plupart des affections chirurgicales des reins, l'hématurie et la pyurie (Ce que la Fr. a apporté à la méd., 1946 [1943], p. 215).b) Commun. Ce qu'il y a de plus profond dans l'histoire spirituelle de l'humanité c'est la compréhension du signe, et toute grande philosophie est une séméiologie; découvrir le chiffre du monde et pouvoir ainsi en révéler le langage, tel est l'objet du désir fondamental de l'homme (Lacroix, Marxisme, existent., personn., 1949, p. 47).
Prononc. et Orth.: [semjɔlɔ ʒi]. Ac. 1762: séméïologie; 1798-1878: -méio-; 1935: -méio-, -mio-. Étymol. et Hist. 1. 1752 séméïologie, sémiologie méd. « symptomatologie » (Trév.); 2. a) 1916 « science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale » (Sauss., loc. cit.); b) 1967 en partic. sémiologie graphique (J. Bertin, Sémiologie graphique. Les diagrammes. Les réseaux. Les cartes [titre]). Formé du gr. σ η μ ε ι ̃ ο ν « signe » et λ ο ́ γ ο ς « discours » (v. -logie).
DÉR.
Sémiologue, subst.,commun. Spécialiste de sémiologie. Le sémiologue (...) dira (...) à quel niveau du système sémantique de la Mode, l'économie et la sociologie rejoignent en pertinence sémiologique: au niveau de la formation du signe vestimentaire par exemple, ou à celui des contraintes associatives (tabous) ou à celui du discours de connotation (R. Barthes, Le Degré zéro de l'écriture, Élém. de sémiologie, 1968 [1964], p. 170).− [semjɔlɔg]. − 1reattest. 1964 id.; de sémiologie par substitution de l'élém. -logue* à l'élém. -logie*.
BBG. − Engler (R.). Sémiologies saussuriennes. 2. Le Canevas. Cah. F. Sauss. 1980, n o34, pp. 4-16. − Greimas (A. J.). Cah. Lexicol. 1965, n o6, p. 111. − Guiraud (P.). La Sémiologie. Paris, 1971, 128 p. − Martinet (J.). Clefs pour la sémiologie, Paris, 1973, 243 p. − Mounin (G.). Introd. à la sémiologie. Paris, 1970, 251 p. − Nattiez (J.-J.). De la sémiologie à la sémantique. Cah. LIng. Montréal. 1973, n o2, pp. 219-240; Le point de vue sémiologique. Cah. Ling. Montréal. 1975, n o5, pp. 50-73. − Sign, language, culture. Signe, language, culture. Ed. A. J. Greimas, R. Jakobson... The Hague, Paris, 1970, p. 13-27. − Wunderli (P.). Sémantique und Sémiologie. Vox rom. 1971, t. 30, n o1, pp. 14-31.
DOCUMENT cnrtl LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
PROPRIOCEPTION |
|
|
| |
|
| |

PROPRIOCEPTION
Les gens sont couchés sur le sol qui imite une façade d'immeuble parisien, un miroir tenu au-dessus d'eux donne l'impression qu'ils escaladent une vraie façade lors du festival Futur en Seine 2012.Artiste : Leandro Erlich La proprioception (formé de proprio-, tiré du latin proprius, « propre », et de [ré]ception), ou sensibilité profonde, désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps, sans avoir recours à la vision1.
Elle fonctionne grâce à près de trente millions de récepteurs sensoriels, appelés propriocepteurs, présents dans les muscles, les articulations, les ligaments, les tendons, la peau, et les fascias. Ils adressent des signaux qui transitent par les nerfs sensitifs vers la moelle épinière, puis vers le cervelet (proprioception inconsciente) et le cerveau (proprioception consciente2,3), les renseignant sur la tonicité des muscles et la position exacte des différentes parties du corps1,4,5. Ces centres nerveux réagissent en contractant ou relâchant certains muscles afin de réguler le tonus postural et pour réaliser les mouvements désirés. Les propriocepteurs font donc partie des mécanismes de contrôle de l’exécution du mouvement, de la régulation de l'équilibre du corps et de sa localisation dans l'espace2. La proprioception fait partie de la somesthésie.
La proprioception permet l'élaboration d'un schéma corporel statique et dynamique qui se construit avec l'âge et s'affine avec l'expérience4,6,7. Imaginer une action active les mêmes circuits neuronaux que son exécution, l'imagerie motrice est utilisée dans les domaines du sport et de la rééducation. Des recherches récentes montrent un lien très étroit entre proprioception et émotions, qui est exploré pour traiter certains troubles mentaux comme la dépression8.
De rares patients sont totalement privés de proprioception à la suite d'une neuropathie, on parle alors de déafférentation1,9, d'autres naissent avec une mutation du gène PIEZO2 impliqué dans la proprioception, à l'origine d'importants troubles musculosquelettiques10. Plus couramment, quand la proprioception donne des informations erronées en l'absence de lésion, des symptômes très divers peuvent apparaître, on parle alors de dysproprioception4. Différentes pathologies provoquent des déficits proprioceptifs, pour lesquels il n'existe pas encore de réelle prise en charge1,11.
La proprioception a été d'abord caractérisée chez les humains. Le terme fut proposé par Charles Scott Sherrington en 1900 et 1906. La proprioception s'observe aussi chez les animaux, vertébrés et invertébrés. Plus récemment, une proprioception a été découverte chez les plantes12,13,14.
Physiologie de la proprioception
Muscles, tendons, articulations, ligaments, peau, et fascias possèdent une innervation sensitive propre. Leurs récepteurs sensoriels (notamment fuseaux neuromusculaires2 et organes neurotendineux) sont appelés « éléments proprioceptifs », car ils réagissent non pas à une excitation venant de l'extérieur (comme les éléments extérocepteurs des cinq sens), mais à une excitation provenant de l'organe lui-même. C’est donc une sensibilité très profonde du corps à lui-même15.
* Ces récepteurs sont des mécanorécepteurs appelés propriocepteurs, qui peuvent détecter lorsque les tissus sont étirés ou subissent des tensions et des pressions. Les influx nerveux qui y naissent apportent aux centres du névraxe (système nerveux central) des renseignements perçus ou non par la conscience, sur le degré de tonus ou de contraction des muscles ou sur les positions relatives des différents segments du corps1. • Les fuseaux neuromusculaires sont présents dans la zone charnue des muscles, ils donnent des informations sur la longueur du muscle et la vitesse de ses variations. Leur sensibilité a la particularité d’être variable et peut être contrôlée par le système nerveux central. Notre cerveau peut les rendre plus ou moins sensibles en fonction du contexte dans lequel une action est exécutée, il est à l’origine d’un réglage très fin de cette sensibilité musculaire5.
* Les organes tendineux de Golgi se trouvent aux jonctions musculotendineuses, ces récepteurs sensoriels sont sensibles lorsqu'ils sont étirés.
• Au niveau des capsules et des ligaments articulaires se trouvent les corpuscules de Pacini et de Ruffini, qui fournissent des informations sur la position et le mouvement des articulations. Les récepteurs de Ruffini sont sensibles à la direction et à l’amplitude du mouvement, tandis que les corpuscules de Pacini détectent les changements rapides de position articulaire16. Le problème de la conduction des influx sensitifs a été particulièrement difficile à élucider, pour plusieurs raisons : si les influx d'origine profonde ou superficielle (proprioceptifs ou extéroceptifs) sont conduits en bloc à la moelle par les nerfs spinaux, il n'en est plus de même dans la moelle : les différents influx y sont véhiculés par des faisceaux différents selon la qualité de sensation.
Avec l’avènement de l’IRM, la fin du xxe siècle a permis la découverte de deux voies de conduction des influx proprioceptifs vers le cortex cérébral et cérébelleux. La proprioception générale arrive au cerveau par deux voies distinctes qui collaborent sans cesse17 : une voie consciente qui va vers le cortex somesthésique primaire et est à l’origine d’une perception consciente2,3 ; et une voie inconsciente qui va vers le cervelet, elle n’engendre pas de perception consciente et est à l’origine d’une régulation motrice inconsciente18,16,19. La voie de la proprioception consciente est utilisée quand nous préparons ou réalisons un mouvement volontaire conscient (exemple : réaliser un enchaînement de pas de danse pour la première fois)18. Elle est utilisée lors de chaque nouvel apprentissage, elle est à la base du schéma corporel17. Mais cette information proprioceptive est relativement lente en raison du temps de conduction le long des neurones pour arriver jusqu’au cortex somesthésique primaire. Elle ne peut suffire pour un contrôle rapide des mouvements automatiques, les mouvements que nous exécutons sans avoir besoin de réfléchir, qui ont été acquis du fait de l’évolution de notre espèce ou de l’apprentissage (exemples : locomotion basique, gestes sportifs automatisés grâce à la répétition)18. La majorité des informations proprioceptives sont inconscientes20, elles permettent au cervelet une adaptation motrice très rapide. Certains réflexes spinaux relèvent aussi de la proprioception inconsciente, les message nerveux s’arrêtent au niveau de la moelle épinière pour permettre une réaction d’urgence de protection (exemple : réflexe myotatique)18,16.
La proprioception crânio-faciale provient des muscles innervés par le nerf trijumeau, il conduit notamment la proprioception du visage21, la proprioception oculaire et les informations proprioceptives de certains muscles de la mastication, dont ceux de la langue qui est impliquée dans la régulation de l'équilibre postural22. Les afférences sensorielles trigéminales (informations émanant des récepteurs sensitifs du nerf trijumeau) jouent un rôle dans la stabilisation de la posture et du regard. Une modification de ces afférences peut avoir des répercussions sur le maintien de l'équilibre postural23,24.
Sensibilité proprioceptive consciente[modifier | modifier le code]
Les faisceaux graciles (ou de Goll) et cunéiformes (ou de Burdach) sont formés par les fibres longues de cellules en T qui montent sans relais sur toute la hauteur de la moelle jusqu'aux noyaux de Goll et Burdach dans le bulbe, avant de gagner le thalamus, puis le cortex somesthésique primaire. Ils transportent les messages qui viennent des muscles, des tendons, des ligaments ainsi que des capsules articulaires, des fascias et de la peau ; messages qui sont à l'origine de la sensibilité proprioceptive consciente. La sensibilité tactile discriminative emprunte aussi ces voies19,25.
Les fibres de ces faisceaux ne se croisent pas dans la moelle mais dans le bulbe : si les extrémités nerveuses à gauche sont coupées, il y aura perte de sensibilité à gauche.
Sensibilité proprioceptive inconsciente[modifier | modifier le code]
Les faisceaux cérébelleux direct et croisé transportent les influx issus des fuseaux neuromusculaires, des organes tendineux de Golgi et des récepteurs articulaires, en provenance du tronc et des membres19. Ils ne donnent pas lieu à des sensations conscientes, car leurs afférences n'arrivent pas jusqu'au cortex. Les deux faisceaux ont un premier relais spinal, puis ils se projettent au niveau du cervelet et permettent à cet organe d'intervenir sur les réactions motrices en régulant le tonus musculaire, la coordination des mouvements automatiques et l'équilibre26.
Proprioception oculaire[modifier | modifier le code]
Chaque globe oculaire possède six muscles oculomoteur (MOM) qui réalisent une perception proprioceptive, permettant au cerveau de connaître l'emplacement du globe oculaire dans son orbite27. Ce sont des muscles striés

, précis, rapides, très résistants à la fatigue. Les fibres qui les composent sont parmi les plus fines de l'organisme. Comme pour les autres muscles de l’organisme, on retrouve dans les MOM des fuseaux neuro-musculaires disposés parallèlement aux fibres musculaires. Dans les tendons, les organes tendineux de Golgi sont remplacés par des terminaisons spécifiques musculo-tendineuses, les palissades de Dogiel28. Les informations proprioceptives oculaires sont dirigées vers le cerveau par le nerf trijumeau : les fibres émanant des propriocepteurs oculaires quittent les nerfs oculomoteurs à la sortie de l’orbite, elles rejoignent, à l'intérieur de la boîte crânienne, la branche ophtalmique du nerf trijumeau et font relais dans le ganglion de Gasser avant de rejoindre le noyau mésencéphalique et spinal du nerf trijumeau27.
Le cerveau utilise les informations rétiniennes, la décharge corollaire de la commande oculomotrice et les informations proprioceptives musculaires pour positionner correctement l'œil dans l'orbite28,29. Les informations rétiniennes sont insuffisantes pour une perception précise de l’emplacement d'un l’objet dans l'environnement, car une même projection rétinienne peut correspondre à des emplacements différents dans l’espace visuel, selon la direction du regard30. Chez l’homme, les études réalisées par l’équipe de Daniela Baslev à l’Université de St Andrews (GB) ont démontré le rôle de la proprioception dans l’attention visuelle et son importance dans la correction des imperfections du regard31,32,33,29. Ces travaux confirment que la proprioception oculaire et l’activité visuelle (traitement de l’image) sont en interaction permanente. Une perception visuelle de qualité est dépendante de la proprioception oculaire et vice et versa34.
Le nerf trijumeau conduit la proprioception oculaire, mais aussi une grande partie des informations sensitives de la bouche et les informations proprioceptives de certains muscles de la mastication28. C'est pourquoi il est possible de modifier la perception visuelle en changeant la perception orale35,36.
Génétique[modifier | modifier le code]
En 2021, Ardem Patapoutian a reçu le prix Nobel de médecine pour sa découverte de récepteurs impliqués dans la mécanosensation, nommés PIEZO1 et PIEZO2 (du grec piezo, signifiant « pression »), le second étant le principal senseur du toucher et de la proprioception37. Des mutations du gène PIEZO2 entraînent des anomalies squelettiques chez l'humain, notamment scoliose et dysplasie de la hanche. Une équipe Israélienne a montré que la protéine PIEZO2 exprimée dans les neurones proprioceptifs est essentielle pour l’intégrité du squelette : elle permet de réguler le développement et la fonction du squelette, en particulier l'alignement de la colonne vertébrale, la réparation des fractures osseuses et la morphogenèse des articulations38.
En 2022, Niccolò Zampieri et son équipe ont publié dans la revue Nature Communications leur découverte de marqueurs génétiques uniques aux neurones propriocepteurs localisés dans les ganglions rachidiens qui contrôlent les muscles du dos, de la région abdominale et des jambes. Les neurones propriocepteurs du dos sont caractérisés par l'activation des gènes Tox et Epha3, ceux des abdominaux par l'activation de C1ql2, et ceux des membres postérieures, Gabrg1 et Efna5. Ces chercheurs ont aussi montré que ces gènes sont déjà actifs chez l’embryon et le restent ensuite au moins un certain temps après la naissance, ce qui signifie qu'il existe des marqueurs génétiques fixes qui décident si un neurone propriocepteur innervera les muscles de l'abdomen, du dos ou des membres postérieurs39,40.
Un autre gène impliqué dans la proprioception a été découvert en 2023 par l'équipe de recherche de Elazar Zelzer : le gène ASIC2 qui est un élément clé de la sensibilité proprioceptive et un régulateur de l’alignement de la colonne vertébrale41.
Schéma corporel[modifier | modifier le code]
La proprioception est essentielle pour construire le schéma corporel, puis le mettre à jour tout le long de la vie42.
Au troisième trimestre de la grossesse, les mouvements que le fœtus réalise durant son sommeil actif contribuent à la construction d’un réseau cérébral de base lui permettant de comprendre quelle partie de son corps bouge et comment elle a été en contact avec la paroi utérine. Il affute sa proprioception bien avant la naissance, comme si ses mouvements dans l’utérus le préparaient à la vie à l’extérieur. Ceux-ci lui permettent de mettre en place les échafaudages neuronaux sur lesquels son cerveau va ensuite construire des couches plus complexes43,44,45,46.
À la naissance, le schéma corporel du bébé est encore très pauvre ; il a une très faible conscience de son corps, de son volume, de la place qu'il occupe dans l'espace, il ne fait pas la différence entre lui et le monde qui l'entoure6. Ce sont ses mouvements et ses interactions avec son environnement qui vont lui permettre de se construire petit à petit une représentation mentale de son corps (notamment via la proprioception consciente vers le cortex somesthésique primaire) et des mouvements qu'il peut réaliser7,47. En collaboration avec d'autres sens, notamment la vue et le système vestibulaire, la proprioception joue un rôle essentiel dans l'élaboration de ces représentations mentales . En effet, la motricité permet dès la naissance le dialogue entre le bébé et son milieu. Cette interaction est rendue possible grâce au couplage précoce réalisé entre la perception qu’il a de son environnement au travers de ses sens, et les actions qu’il engage pour interagir avec lui7. Les informations que lui fournissent ses sens provoquent une réponse approximative de son système moteur qui ordonne un mouvement. Le cerveau calcule alors la différence entre le mouvement qu’il avait planifié à la suite des informations transmises par ses sens et celui qu’il a réellement exécuté́. Pour réaliser cette opération, il utilise plus particulièrement les retours sensoriels de la vue et de la proprioception, à la suite de l'action. S'il trouve une différence, elle est prise en compte par le cerveau qui ajuste les commandes motrices pendant qu'il réalise le geste, pour l'améliorer. À force d’allers-retours entre système sensoriel et moteur, ce circuit, le « couplage perception-action », développe et consolide un réseau neuronal approprié à la réalisation des gestes désirés. L’apprentissage de la marche en est une très bonne illustration. Au début le bébé fait des mouvements très approximatifs, tombe, puis à force de répétitions, il améliore ses gestes et finit par marcher. Le circuit sensorimoteur de la marche s’est inscrit dans son cerveau48,49. Le couplage entre la perception et l’action est à la base de la construction de ses représentations sensorimotrices50.
Les représentations mentales du corps, et du corps en action, s'acquièrent avec l'âge et s'affinent avec la répétition de gestes et d'expériences très diverses4,7. L’adolescence est une autre étape décisive de cette construction, en plus accélérée. Le corps change, grandit, s’étoffe, et en raison de ces bouleversements rapides, la multitude de nouvelles informations proprioceptives génère une nouvelle carte corporelle6. À l’âge adulte, le schéma corporel est mature, mais il est constamment mis à jour en fonction de nos expériences et des changements que subit notre corps : nouvelle pratique sportive, prise de poids, blessure, etc6,7. Si une partie du corps est immobilisée à la suite d'une blessure, il perd de sa finesse et une rééducation est nécessaire pour le restaurer et éviter une blessure ultérieure6,51. Sous l'effet de l'entraînement, il peut être amené à des sommets comme chez les danseurs professionnels, les musiciens, ou les sportifs de haut niveau4,52,53.
À l'inverse, des déficits proprioceptifs apparaissent avec le vieillissement et expliquent en partie les difficultés observées dans la vie quotidienne des personnes âgées : nombre de récepteurs musculo- tendineux et articulaires en baisse et forte perte du nombre de capteurs proprioceptifs au niveau du pied en particulier, ce qui a un impact considérable sur l’équilibre1,54.
Des rééducations en psychomotricité ou en kinésithérapie permettent d'améliorer les représentations mentales du corps chez les patients présentant un trouble du schéma corporel.
Il est recommandé à toute personne de maintenir, ou d'améliorer, sa proprioception avec de l’activité physique, quel que soit son âge et en l'adaptant à son profil1,54.
Troubles des apprentissages[modifier | modifier le code]
Le développement des représentations sensorimotrices est en lien avec la mise en place des fonctions exécutives telles que l’anticipation, l’adaptation et l’apprentissage, depuis l’enfance et jusqu’à la fin de l’adolescence55. Une sous-utilisation de la sensorimotricité peut être à l’origine de déficits en cascade qui vont avoir un impact sur l’ensemble des apprentissages. Une atteinte des représentations internes est de plus en plus évoquée dans le cadre des troubles des apprentissages42. Un consensus émerge actuellement sur l’existence d’un trouble de ces représentations chez les enfants souffrant de dyspraxie7,56,57, elles commencent à être explorées dans la dyslexie58.
En Belgique, des chercheurs testent chez les enfants dyspraxiques le port de gilet lestés à certains endroits, comme les bras, pour améliorer leur proprioception et les aider à mieux maîtriser le fonctionnement fin de leurs membres. Cette prise en charge semble montrer des résultats dans leurs apprentissages, notamment dans celui de l’écriture, qui est très problématique chez ces enfants59.
En France, le Pr Christine Assaïante, dont le laboratoire étudie le rôle de la proprioception dans l'élaboration du schéma corporel, plaide pour une évaluation systématique de la sensorimotricité des enfants dans le cadre des troubles des apprentissages, même en l’absence de plainte, afin de mettre en place le plus rapidement possible des rééducations permettant de renforcer les représentations mentales du corps des enfants concernés42.
Apprentissages[modifier | modifier le code]
Des études récentes ont montré que les représentations mentales du corps sont également liées aux compétences scolaires, notamment linguistiques et mathématiques. En effet, l’apprentissage du vocabulaire60,61, comme des mathématiques62, s’ancre au départ dans les expériences sensorielles et motrices de notre corps49. En France, des chercheurs réalisent actuellement une étude pour savoir si un entraînement physique et sensoriel des enfants, dès la maternelle, pourrait améliorer leur représentation de leur corps, et par-delà leurs compétences en mathématiques et en syntaxe53. Selon eux, cette approche précoce pourrait aussi réduire le risque de dyspraxie sévère, améliorer les capacités motrices et sensorielles de ces enfants et favoriser leur plein épanouissement63.
Fonctions[modifier | modifier le code]
La proprioception peut être comparée à un GPS qui s’appuie sur les représentations mentales de notre corps et nous permet de percevoir précisément celui-ci à chaque instant, en nous donnant des signaux de localisation. Grâce à elle, le cerveau peut déterminer la position, la vitesse et la direction de tous nos segments corporels. La proprioception va donc guider efficacement nos mouvements et pas uniquement en l’absence de vision1. Elle joue aussi un rôle fondamental dans la localisation spatiale sensorielle2 et dans la perception multisensorielle4.
Contrôle moteur et postural[modifier | modifier le code]
Pour maintenir l'être humain en équilibre, lui permettre de tenir debout et de se mouvoir, le système nerveux central prend en compte les informations provenant de plusieurs organes des sens. Les yeux scannent constamment l' environnement à la recherche de verticalité et d’horizontalité (nous recherchons des lignes de repères, car nous tenons debout en formant une espèce d’angle droit avec le centre de gravité). Le système vestibulaire contribue à la sensation de mouvement, à l’équilibre et permet au cerveau de connaître l’inclinaison du corps en utilisant la gravité comme référentiel. La proprioception l'informe de la position des différentes parties du corps et des récepteurs pressionnels très sensibles, situés sous la plante des pieds, le renseignent aussi sur l’inclinaison du corps6,64,65.
Quand ces différents systèmes transmettent des informations concordantes entre elles, le cerveau peut établir une cohérence de toutes les informations qu’il reçoit. Les centres nerveux réagissent en contractant ou relâchant certains muscles afin de réguler le tonus musculaire, pour assurer l’équilibre du corps et réaliser les mouvements désirés. En revanche, la non-concordance des informations sensorielles est à l’origine de symptômes désagréables, comme le vertige, l'agoraphobie ou la cinétose64,65,66.
Localisation spatiale[modifier | modifier le code]
Au-delà de son rôle mieux connu dans le contrôle du mouvement, la proprioception joue un rôle fondamental dans la manière dont notre cerveau gère les informations provenant de nos autres sens, notamment celles de la vue, pour nous permettre de nous situer dans notre environnement. Elle collabore toujours avec nos autres organes des sens et influence fortement leur travail en donnant constamment au cerveau l’indication de leur place respective dans le corps. Le Pr Jean Pierre Roll et son équipe ont modifié expérimentalement, par des vibrations mécaniques donnant au cerveau une illusion de mouvement, la proprioception des muscles des yeux, du cou ou même de la cheville d’un sujet maintenu immobile. Ces stimulations proprioceptives ont provoqué chez lui l’illusion du déplacement de la cible visuelle qu'il fixait, alors même que ni ses yeux, ni son corps ne bougeaient67. La proprioception musculaire fonctionne en chaîne68 et peut influencer l’interprétation par le cerveau de ce que nous voyons, elle est au centre des phénomènes neurologiques qui nous permettent de situer les stimuli sensoriels dans l’espace. Le Pr Roll a résumé ainsi le résultat de ces recherches, dans la revue Intellectica2 :
« Comment pourrions-nous localiser une cible visuelle dans l’espace sans que le système nerveux soit précisément informé du lieu où se trouve le corps et, notamment, l’œil? […] La rétine est portée par un ensemble de segments corporels mobiles et emboîtés que sont successivement l’œil, la tête, le tronc et les jambes : les signaux proprioceptifs, issus de toute la chaîne des muscles mobilisant ces segments, « disent » à tout instant au cerveau quelle est l’attitude ou quels sont les mouvements du corps, et lui permettent le calcul de la position absolue de la rétine dans l’espace. L'ensemble des informations issues des muscles, depuis ceux des pieds qui ancrent le corps sur le sol jusqu'à ceux des yeux qui ouvrent le corps sur le monde (qu'avec R Roll nous avons nommé "chaîne proprioceptive") est indispensable à la connaissance, à chaque instant, de notre position dans l'espace. »
Ainsi, la proprioception nous permet de localiser les informations sensorielles dans l'espace et d'y situer notre corps, elle est « un sens premier, celui qui donne sens à nos autres sens »2.
Perception multisensorielle[modifier | modifier le code]
Le cerveau reçoit en permanence une multitude d’informations sensorielles de nos organes des sens extéroceptifs, qui captent les informations de notre environnement ; mais aussi de nos sens intéroceptifs, qui lui apportent des renseignements sur nos sensations corporelles et sur l'état interne de notre corps. Toutes ces sensations ne sont pas conscientes, le cerveau les regroupe, les trie et les fusionnent pour ne faire parvenir à notre conscience que celles qui sont utiles à l’action en cours ou envisagée et générer ainsi une perception unifiée de notre corps et du monde qui nous entoure (on parle alors d'intégration multisensorielle). Cette intégration des informations sensorielles permet notamment de faire émerger le sentiment de propriété corporelle, c'est-à-dire qu'un de nos membres fait bien partie de notre corps69.
La proprioception est le lien spatial entre tous nos organes des sens et nous permet de localiser précisément les informations sensorielles dans l’espace2. Elle intervient donc dans le choix des sensations qui sont retenues par le cerveau pour élaborer une perception adaptée à l’action34. La proprioception joue un rôle important dans la perception multisensorielle et une dysfonction proprioceptive peut entraver le bon déroulement de l’intégration multisensorielle4,70.
En France, le Dr Patrick Quercia et son équipe ont testé le rôle de la proprioception dans l'intégration multisensorielle d'enfants témoins et dyslexiques. Ils ont montré qu'en modifiant leur proprioception oculaire, ils provoquaient l'apparition de pertes visuelles transitoires à l'écoute de différents sons, mais aussi en utilisant des stimulations proprioceptives à différents endroits du corps. Cet effet était considérablement plus important dans la population d’enfants dyslexiques71,72,73.
Illusions corporelles[modifier | modifier le code]
Les illusions sensorielles occupent une place importante dans la recherche en neurosciences, car elles permettent de mieux comprendre les différents processus animant le cerveau et la manière dont il interprète les signaux transmis par nos sens. Les illusions corporelles mettant en jeu la proprioception ont été beaucoup utilisées par les chercheurs pour comprendre le fonctionnement de ce sens2. Ces illusions montrent aussi les prouesses dont est capable le cerveau pour résoudre des conflits sensoriels et ouvrent la voie à des perspectives thérapeutiques visant à leurrer le cerveau pour l'obliger à recalibrer ses représentations mentales du corps, quand elles sont erronées (membre fantôme, lésion cérébrale, anorexie, etc.)74.
Illusion de Pinocchio[modifier | modifier le code]
Cet illusion a été imaginée par des chercheurs qui ont utilisé des vibrations au niveau des tendons du bras d'un sujet ayant les yeux fermés, ces stimulations proprioceptives lui donnant l'illusion que son bras était en extension alors qu'il n'avait pas bougé. Puis il lui ont demandé de toucher son nez et ont déclenché l'illusion de mouvement, il a alors senti son bras s'allonger et son nez grandir d'autant. Le cerveau, dont le premier rôle est d'assurer la survie, aime la cohérence des informations provenant de ses sens. Dans l'illusion Pinocchio, il est confronté à des informations contradictoires : d'un côté, il sent le bras s'étendre, et de l'autre il continue de sentir le doigt en contact avec le nez. Pour résoudre ce conflit, le cerveau produit alors l'illusion que le nez s'est allongé74.
Illusion de la main en caoutchouc[modifier | modifier le code]
En 1998, Matthew Botvinick et Jonathan Cohen publient dans la revue Nature une expérience corporelle mettant en jeu un conflit entre la vision, le toucher et la proprioception : l'illusion de la main en caoutchouc. Un participant est assis devant une table sur laquelle repose une main en caoutchouc à l'endroit où pourrait être la sienne, alors que sa véritable main est caché derrière en panneau. Le participant observe le chercheur qui caresse avec un pinceau la main en caoutchouc. Dans le même temps, le chercheur caresse exactement de la même manière la main dissimulée à sa vue. Au bout d’un moment, le sujet dit avoir la sensation que la fausse main lui appartient. Cet effet peut être si fort que le sujet devient moins capable d’utiliser sa main, comme si le cerveau ne la considérait plus comme faisant partie de son corps. Dans cette expérience, face à des stimuli visuels et tactiles qui lui disent une chose et une information proprioceptive qui lui en dit une autre, le cerveau tente de réduire ce conflit en donnant raison au toucher et à la vision, qui semblent dans ce cas précis prédominer69,75.
Imagerie motrice[modifier | modifier le code]
L’imagerie motrice se définit comme la représentation mentale d’une action, sans qu’elle ne soit exécutée réellement. Imaginer une action active les mêmes circuits neuronaux que son exécution, cependant un processus d’inhibition motrice est actif pour éviter que la représentation mentale ne débouche sur l’exécution du geste. L’imagerie motrice rappelle les sensations générées par le mouvement réel et se construit en s’appuyant sur la proprioception, qu'elle soit musculaire ou articulaire, et sur les informations vestibulaires76.
L’imagerie motrice a montré des bénéfices dans le domaine de la motivation et de la confiance en soi, mais elle est principalement utilisée dans le domaine sportif76. Elle favorise l’acquisition et la correction de techniques sportives, sans toutefois remplacer la pratique physique qui reste le moyen le plus efficace de s’améliorer. L’entraînement par imagerie motrice étant simple à mettre en place, il permet aux sportifs d’améliorer leurs performances sans risquer le surentraînement et leur permet de continuer à s’entraîner quand ils sont blessés77.
L’imagerie motrice est aussi utilisée en rééducation. Des protocoles de recherche cherchent à évaluer si imaginer un mouvement en complément d’une rééducation kinésithérapeutique pourrait aider des patients paralysés à recouvrer leurs fonctions motrices. Les premiers résultats sont encourageants77.
Enfin, l’imagerie motrice est utilisée en recherche pour explorer la qualité des représentations internes de l’action d’un sujet, la qualité de ses représentations sensorimotrices. De nombreuses études en imagerie motrice ont montré une atteinte de ces représentations chez l’enfant dyspraxique78,79, elles commencent à le montrer aussi chez l’enfant dyslexique58 et chez certains adultes dyslexiques78.
Proprioception et émotions[modifier | modifier le code]
La recherche a montré récemment que la proprioception musculaire peut varier en fonction de nos émotions. Les chercheurs ont découvert que les récepteurs musculaires sont plus excitables en présence d’émotions positives ou négatives, comme de joie ou de tristesse. Le rôle de ces récepteurs est d’informer sur le mouvement en cours, mais ils ont aussi pour rôle de l’assister. Souvent, une émotion déclenche une action et l'augmentation de la sensibilité musculaire va faciliter la réalisation des mouvements qui sont générés par les émotions5.
Des chercheurs se sont intéressés à l’impact de l’injection de toxine botulique dans le front de personnes dépressives. En paralysant temporairement et réversiblement le muscle corrugateur (région comprise entre les sourcils), ils ont constaté qu’ils amélioraient l’état de leurs patients. Pour eux, cet effet repose sur le fait que la paralysie des muscles de la zone frontale, qui expriment avant tout des émotions négatives telles que la tristesse en cas de dépression, entraîne une interruption des afférences proprioceptives générées par ces émotions entre le visage et le cerveau. Le Botox, en interrompant la transmission de ces messages, empêcherait ainsi l’entretien de l’humeur dépressive. Ces chercheurs ont introduit le concept de « Proprioception Emotionnelle ». Cette piste est explorée pour traiter certaines formes de dépression80,81, mais aussi dans d'autres troubles mentaux caractérisés par un excès d'émotions négatives8.
Dans une autre étude, le Botox injecté dans le front des participantes a affecté la manière dont elles interprétaient les émotions des visages qui leur étaient présentés sur des photos. L’ IRM a montré que l’activité cérébrale de ces femmes était altérée dans certaines zones du cerveau impliquées dans la perception des émotions, notamment l'amygdale. Ces résultats concordent avec l’hypothèse du feedback facial, selon laquelle les gens reflètent instinctivement les expressions faciales dans le but d’identifier et d’éprouver l’émotion exprimée devant eux. Les chercheurs notent que la paralysie temporaire des muscles faciaux causée par le Botox entrave la capacité d’une personne à refléter les émotions exprimées devant elle, modifiant ainsi l’activité de son cerveau lorsqu’elle tente d’interpréter les émotions82. Lors d'une autre expérimentation, l'injection de Botox a modifié la manière dont les participants percevaient les émotions en lisant un texte. Si l'injection ciblait le muscle corrugateur du front, la compréhension des émotions négatives était altérée ; si l’injection était réalisée autour de la bouche, ce sont les émotions positives qui étaient moins bien perçues83.
Notre visage reflète nos émotions, mais nos expressions faciales peuvent aussi influer sur nos émotions, car le cerveau est toujours à la recherche de ce qui est appelé la congruence corps-esprit. Si l’émotion que nous exprimons avec notre visage ne correspond pas à notre état d’esprit réel (par exemple si nous affichons un visage détendu alors que nous sommes stressés), le cerveau commence à générer ce qui est appelé une migration d'humeur pour adapter l’humeur à l’information proprioceptive des muscles du visage. Le même phénomène se produit avec certaines postures corporelles que le cerveau associe à un état émotionnel : si le corps adopte une posture caractéristique de la tristesse, comme une posture voûtée, le cerveau commence à activer les mécanismes neuronaux caractéristiques de la tristesse. Nous pouvons avoir une influence sur nos émotions en prêtant plus attention à notre corps47.
Déficits proprioceptifs[modifier | modifier le code]
La proprioception peut être altérée en raison de causes diverses, dont certaines sont déjà bien identifiées. L'offre de soin est encore très restreinte, notamment du fait de la méconnaissance de ce sens, néanmoins la recherche explore des pistes de traitement dans différentes affections1.
Déafférentation[modifier | modifier le code]
De rares patients totalement privés de proprioception à la suite d’une neuropathie, pathologie du système nerveux - on parle alors de déafférentation - ont permis à la recherche de mieux comprendre le rôle de ce sens, dont il est difficile de simuler l'absence, contrairement à d'autres sens comme la vision ou l'audition (en fermant les yeux ou en se bouchant les oreilles)1,4,9. Cette impossibilité à simuler une absence de proprioception participe à la méconnaissance de ce sens1.
Le rôle de la proprioception devient évident en observant la motricité des patients déafférentés. Chez ces sujets, quand la lésion survient, la commande motrice reste possible (envoi d'un ordre du cerveau vers le muscle), mais ces patients sont au départ comme paralysés, incapables de faire un mouvement. Ils ne sentent plus leur corps, ils ne savent plus où sont leurs bras et leurs jambes, ni quelle est la position de leur corps20. Après un long entraînement, ces patients sortent petit à petit de leur paralysie, à condition de contrôler leurs mouvements du regard1,20. Néanmoins, se tenir debout et marcher demeurent souvent impossible en raison du risque de chute, la majorité d'entre eux doit utiliser un fauteuil roulant. Ces patients peuvent réapprendre à saisir des objets, mais leur dextérité reste limitée et chaque geste leur demande beaucoup de temps et d'attention. Sans proprioception, réussir un mouvement, le répéter et l'automatiser est presque impossible, car la vision ne permet pas de compenser complètement la perte de proprioception pour assurer un contrôle moteur normal1.
Mutation du gène PIEZO 2[modifier | modifier le code]
De très rares patients naissent avec une mutation importante impliquant un déficit fonctionnel du gène PIEZO2, qui code pour une protéine sensible à la pression, impliquée dans la proprioception et le toucher. En plus de présenter une scoliose très sévère, ils sont atteints de malformations des hanches, des doigts et des pieds. Ils rencontrent des problèmes d'équilibre, des difficultés pour marcher, ainsi que pour contrôler leurs mouvements. Ces patients manquent de conscience corporelle, ils ne parviennent plus à marcher et à contrôler leurs mouvements quand on les prive de la vue. Ils sont également moins sensibles à certaines formes de toucher (ex : ils ne sentent pas les vibrations d’un diapason). Malgré tout, leur système nerveux se développe correctement et ces patients semblent compenser en partie leurs difficultés en s’appuyant fortement sur la vision et leurs autres sens10,52,84,85.
Des études ont montré que d'autres mutations du gène PIEZO2, avec une fonction augmentée, peuvent avoir divers effets sur la protéine PIEZO2, pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques génétiques84, notamment l'arthrogrypose distale de type 586, le syndrome de Gordon et le syndrome de Marden-Walker87.
Membre fantôme[modifier | modifier le code]
Quand des personnes se retrouvent paralysées ou perdent un membre à la suite d'une blessure ou d'une amputation, elles perdent définitivement les sensations proprioceptives de cette partie de leur corps. Elles peuvent cependant continuer à percevoir une sensation confuse de l'existence de ce membre, ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme. Les sensations fantômes peuvent survenir sous la forme de sensations proprioceptives passives de la présence du membre ou de sensations plus actives telles que la perception d'un mouvement, d'une pression, d'une douleur, etc. Il existe diverses théories concernant l’étiologie des sensations et de l’expérience des membres fantômes. L'une d’elles est le concept de « mémoire proprioceptive », selon lequel le cerveau conserve une mémoire des positions spécifiques du membre et qu'après l'amputation, il y a un conflit entre le système visuel, qui voit réellement que le membre est manquant, et les représentations internes du corps qui se souviennent encore du membre en tant que partie fonctionnelle du corps88. Un traitement étonnant pour la douleur du membre fantôme consiste à placer le membre restant devant un miroir de manière à tromper le cerveau en lui faisant croire que le membre manquant est bien vivant. L’implication et la concentration du patient sont indispensables, il doit se concentrer et imaginer que son membre manquant bouge, s'il est passif, aucun résultat n’est obtenu89 (cf. Proprioception et imagerie motrice).
Dysproprioception[modifier | modifier le code]
La proprioception peut dysfonctionner sans qu'il y ait de lésion, on parle alors de Syndrome de Dysfonction Proprioceptive (SDP) ou de dysproprioception4,6,22,90. Cette dysfonction affecte alors les trois fonctions principales de la proprioception : le contrôle postural, la localisation spatiale et la perception multisensorielle4. La proprioception étant un sens très diffus, disséminé dans tout l'organisme, les symptômes d'une dysproprioception sont extrêmement variés. Ils peuvent se manifester par des douleurs musculaires et ostéoarticulaires chroniques, des sensations vertigineuses, des maladresses praxiques, une dysgraphie ou encore des troubles des apprentissages comme la dyspraxie et la dyslexie4. La dysproprioception peut affecter la proprioception oculaire et engendrer des difficultés dans le repérage spatial et la perception visuelle4.
C’est en 1979, à Lisbonne, que le Dr Henrique Martins Da Cunhà, médecin rééducateur portugais, a décrit pour la première fois un tableau clinique complexe lié à une dysfonction de la proprioception, qu’il appellera « Syndrome de Déficience Posturale (SDP)». Aujourd'hui, des cliniciens et des chercheurs poursuivent les recherches sur le sujet. À la lumière des connaissances établies sur les fonctions de la proprioception, ils ont affiné l’examen clinique et le traitement du SDP, ils préfèrent désormais parler de Syndrome de Dysfonction Proprioceptive (SDP), ou de dysproprioception. Selon eux, le Syndrome de Dysfonction Proprioceptive est à l’origine non seulement d’une asymétrie du tonus postural, mais aussi de troubles de la localisation spatiale sensorielle et de troubles perceptifs associés, visuels et auditifs, secondaires au trouble de localisation spatiale, qu'il faut aussi corriger91. La prise en charge de la dysproprioception est pluridisciplinaire et peut impliquer différents professionnels selon les besoins du patient92: ophtalmologues, médecins généralistes, orthodontistes, orthoptistes, podologues, ostéopathes, ou kinésithérapeutes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de préciser les critères diagnostics du SDP et pour établir l’efficacité de cette prise en charge91.
Les dysfonctions proprioceptives sont encore difficilement diagnostiquées et le parcours médical des patients qui en souffrent est souvent long et chaotique6.
Dyslexie[modifier | modifier le code]
Une prise en charge proprioceptive de la dyslexie fait l’objet de recherche en France au sein de l’INSERM depuis plusieurs années, emmenée par le Dr Patrick Quercia. Dans cette approche, il est considéré que l’origine de la dyslexie est une dysperception proprioceptive. Il ne faut donc pas se limiter à une rééducation orthophonique, la dyslexie n’étant qu’un symptôme d’un ensemble dysfonctionnel plus vaste, mais proposer une correction globale de la dysproprioception4. Dans ce but, il est proposé aux enfants dyslexiques : 1/ des verres de lunettes avec prismes, pour réguler la tension des muscles oculomoteurs, 2/ des ALPH (petites surépaisseurs de résine colées sur les dents) pour améliorer la proprioception de la bouche, 3/ le port de semelles proprioceptives (dites posturales) pour mieux contrôler l’équilibre musculaire postural, 4/ des exercices respiratoires portant essentiellement sur la récupération d’une bonne respiration abdominale, 5/ le maintien de bonnes positions pour le travail scolaire et l'endormissement4,91,70. Il est toujours recommandé d’associer à cette prise en charge une rééducation orthophonique4. Ce traitement proprioceptif de la dyslexie a été souvent décrié et plus souvent encore ignoré par la communauté scientifique4.
En 2016, l'INSERM a évalué l'efficacité et la dangerosité du traitement proprioceptif de la dyslexie. Bien qu'ils y évoquent « des témoignages de succès du traitement », les auteurs du rapport ont conclu qu’en raison de travaux de recherche encore insuffisants «à ce jour, les données scientifiques disponibles ne permettent pas de conclure à l’efficacité du traitement proprioceptif dans la prise en charge de la dyslexie», mais «les données de sécurité étant rassurantes il n’y a pas d’éléments pour contre-indiquer le recours à cette prise en charge si elle est souhaitée». Ils ont néanmoins constaté une aggravation des troubles de la lecture dans 10% des cas dans une des premières études, mais ont souligné qu'elle pouvait être due à l'évolution naturelle de la dyslexie. Ce rapport a recommandé la poursuite des recherches, ajoutant que ce challenge concernait aussi la rééducation orthophonique, les méthodes traditionnelles de rééducation étant encore insuffisamment évaluées91,93. En 2019, dans son magazine, l’INSERM a présenté les travaux du Dr Patrick Quercia dans la dyslexie comme un des nouveaux domaines de recherche concernant les troubles des apprentissages36. En 2021, lui et son équipe de recherche ont montré pour la première fois, dans une étude publiée dans Scientific Reports, que les dyslexiques ont un trouble proprioceptif, ceci supportant le rôle causal de troubles sensoriels dans la dyslexie94.
Syndrome d'Ehlers-Danlos[modifier | modifier le code]
Les personnes atteintes du Syndrome d’Ehlers-Danslos type hypermobile souffrent, parmi d'autres symptômes, d’une dysproprioception sévère95,96. En effet, cette maladie du tissu conjonctif provoque un déficit fonctionnel du collagène, dans lequel se trouvent de nombreux propriocepteurs qui envoient alors au système nerveux central des informations erronées, les sensations corporelles ne parviennent pas ou sont déformées et trompeuses. Elles occasionnent des subluxations

d’articulation, une grande maladresse, des chutes, etc. Des prises en charge non médicamenteuses sont proposées pour améliorer la proprioception de ces patients : vêtements compressifs sur mesure97, utilisation d’orthèses semi-rigides sur mesure qui limitent l’hypermobilité articulaire, kinésithérapie ou encore séances de psychomotricité pour améliorer le schéma corporel.
Trouble du traitement sensoriel[modifier | modifier le code]
Le trouble du traitement sensoriel (ou SPD, pour Sensory processing disorder) désigne un trouble correspondant à une difficulté ou à une incapacité du système nerveux central à traiter adéquatement les flux d'informations sensorielles arrivant au cerveau, lequel ne peut alors fournir de réponses appropriées aux exigences de l'environnement. Les personnes atteintes de SPD peuvent traiter inadéquatement tout ou partie des "stimuli" sensoriels : visuels, auditifs, olfactifs (odeur), gustatifs (goût), tactiles (toucher), vestibulaires (équilibre), proprioceptifs et intéroceptifs (sens corporels internes).
Ce trouble est présent chez de nombreuses personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique (TSA)98et/ou d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)99.
La question de savoir si le SPD est un trouble indépendant, ou s'il représente les symptômes observés de divers autres troubles connus (ou inconnus) est encore en débat100.
La thérapie d'intégration sensorielle (TIS) ou Sensory integration therapy (SIT en anglais) a été développée dans son modèle initial par l'ergothérapeute, docteur en psychologie et neurosciences Anna Jean Ayres, et publiée dans les années 1970101. Cette prise en charge, principalement proposée par des ergothérapeutes, vise à aider les enfants ayant des difficultés de traitement de l'information sensorielle, et plus précisément à traiter le trouble de l'intégration sensorielle. Elle se concentre sur trois principaux systèmes sensoriels : vestibulaire, proprioceptif et tactile.
La théorie d'intégration sensorielle d'Ayres a été et reste fréquemment critiquée. Mais depuis les années 2010, des études basées sur une méthodologie améliorée laissent penser que des preuves de l'utilité des approches proposés par Ayres sont en train d'émerger, au moins pour le soutien aux profils autistiques102.
Pathologie[modifier | modifier le code]
Différentes affections peuvent engendrer des déficits proprioceptifs : traumatisme des nerfs, de la moelle épinière ou du cerveau, Accident Vasculaire Cérébral, sclérose en plaques103, maladie de Parkinson, carence en vitamine B12, obésité, etc., impactant fortement la qualité de vie de ces patients1,54. Ces déficits sont à l'origine de symptômes plus ou moins handicapants comme des troubles de la concentration, de l'équilibre, de la coordination, de l'orientation, etc.54 Mais il n’existe pas encore de spécialiste de la proprioception clairement identifié, ni de protocole pour quantifier l’acuité proprioceptive et la prendre en charge, il n’y a pas non plus de moyen d’évaluer l’évolution du déficit proprioceptif à la suite d’une rééducation1. Néanmoins, des prises en charge adaptées aux différents types de patients commencent à voir le jour pour les aider à prendre conscience de leur corps, comme un travail de rééducation chez un kinésithérapeute54. Des neuroprothèses sont aussi à l’étude dans certaines pathologies, pour rétablir la communication entre les membres et le système nerveux central11.
Proprioception des vertébrés et des invertébrés[modifier | modifier le code]
La plupart des animaux possèdent plusieurs sous-types de propriocepteurs, qui détectent des paramètres cinématiques distincts, tels que la position des articulations, la tension et le mouvement des segments corporels. Bien que tous les animaux mobiles possèdent des propriocepteurs, la structure des organes sensoriels peut varier selon les espèces (par exemple, les vibrisses ou "moustaches" du chien104).
La plupart des vertébrés possèdent trois types fondamentaux de propriocepteurs : les fuseaux neuromusculaires, qui sont intégrés dans les muscles squelettiques, les organes tendineux de Golgi, qui se trouvent à l'interface des muscles et des tendons, et les récepteurs articulaires, qui sont des mécanorécepteurs à bas seuil intégrés dans les capsules articulaires. De nombreux invertébrés, tels que les insectes, possèdent également trois types de propriocepteurs de base avec des propriétés fonctionnelles analogues105. Les neurones chordotonaux codent pour la position et la vitesse des membres106, les sensilles campaniformes sont sensibles à la pliure de l'exosquelette107 ,108et les plaques ciliées, un champ de poils situé dans les articulations, détectent le mouvement relatif des segments des membres grâce à la déviation des poils cuticulaires associés109.
L'ensemble des signaux proprioceptifs sont transmis au système nerveux central, où ils sont intégrés aux informations provenant d'autres systèmes sensoriels, tels que le système visuel et le système vestibulaire, pour créer une représentation globale de la position du corps dans l'espace, de ses mouvements et de ses accélérations. Chez de nombreux animaux, le retour sensoriel des propriocepteurs est essentiel pour stabiliser la posture du corps et coordonner ses mouvements.
Proprioception oculaire des vertébrés et des invertébrés[modifier | modifier le code]
Tous les vertébrés possèdent six muscles responsables des mouvements de l'œil, même ceux dont la motricité oculaire est réduite à sa composante réflexe. On observe dans ces six muscles extra-oculaires des récepteurs sensibles à l'étirement, dont la forme varie selon les espèces : fuseaux neuro-musculaires, terminaisons libres, terminaisons « en palissade ». L'ensemble des régions du cerveau où se projettent ces fibres suggère que ces informations proprioceptives sont impliquées dans les fonctions visuelles et pré-oculomotrices27. Chez le chat nouveau-né, la section du nerf trijumeau, qui véhicule les informations proprioceptives des muscles extra-oculaires, a un impact énorme sur son développement visuel : perturbation de l'architecture des structures du cortex qui permettent la perception de l'orientation des lignes dans l'espace, gêne dans l'apparition d'une bonne vision en relief et dans le développement d'une dominance oculaire normale, etc.34,110.
Les Invertébrés constituent un phylum très hétérogène en ce qui concerne leur système visuel, leurs capacités perceptives et leurs mouvements oculaires. Il ne semble pas y avoir de contrôle proprioceptif de leurs mouvements oculaires27.
DOCUMENT wikipedia LIEN
Pour lire la suite, consulter le LIEN ...
|
| |
|
| |
|
 |
|
structuralisme |
|
|
| |
|
| |
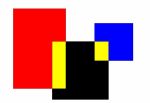
structuralisme
(de structural)
Consulter aussi dans le dictionnaire : structuralisme
Courant de pensée des années 1960, visant à privilégier d'une part la totalité par rapport à l'individu, d'autre part la synchronicité des faits plutôt que leur évolution, et enfin les relations qui unissent ces faits plutôt que les faits eux-mêmes dans leur caractère hétérogène et anecdotique. (Le structuralisme a connu sa forme la plus complète dans l'anthropologie sociale pratiquée par Lévi-Strauss.)
Le structuralisme comme mouvement idéologique
Le structuralisme se présente comme une théorie, voire une méthode, plus que comme une philosophie. Il s'adresse à certaines disciplines des sciences humaines et a connu dans les années 1960 un effet de mode. Certaines d'entre ces sciences, sous l'influence du positivisme, tendent à s'émanciper de la philosophie, considérée jusqu'alors comme le tronc commun des sciences humaines. Ainsi, la psychologie, marquée par le béhaviorisme et le gestaltisme, la sociologie, par le fonctionnalisme, la linguistique, qui avait déjà auparavant constitué un domaine à part s'évadent du nid de la philosophie. Ferdinand de Saussure, un théoricien hors pair, donne à la recherche linguistique une méthode d'analyse à la fois systématique et concrète qui inspirera les chercheurs d'autres disciplines.
Le structuralisme français s'est développé principalement en anthropologie : il est surtout tributaire des travaux de Claude Lévi-Strauss (1908-2009), qui d'ailleurs s'est imprégné de ceux des linguistes Sapir, Bloomfield et Jakobson. Le succès de Lévi-Strauss a poussé nombre de chercheurs français à s'intéresser au nouveau mouvement et à flirter avec lui. Ce fut le cas en histoire, à la suite des travaux de Georges Dumézil (1898-1986) – notamment en référence avec la structure en trois éléments des fonctions sociales et religieuses dans la société indo-européenne – et de ceux de Fernand Braudel (1902-1985). L'école marxiste française a été également tentée de se rapprocher du structuralisme, avec Louis Althusser (1918-1990), et Jacques Lacan (1901-1981) l'introduisit en psychanalyse, en référence à sa thèse selon laquelle « l'inconscient est structuré comme un langage ».
Révélateur est le propos du psychologue suisse Jean Piaget (1896-1980), selon lequel « le structuralisme est une méthode, non pas une doctrine » (le Structuralisme, 1968). Piaget rappelle que la structure est faite de trois composantes : 1° la totalité, qui lie chaque élément qui la compose à tous les autres ; 2° la transformation, qui fait que les processus de transformation obéissent à une loi externe (comme l'enfant qui passe du stade sensori-moteur au stade des opérations formelles, chaque stade constituant lui-même cette totalité, de laquelle il sort à l'étape suivante) ; 3° l'autoréglage, qui fait que les permutations dans la structure sont possibles à partir des lois qui la régissent. C'est d'ailleurs en vertu de cette définition que Piaget utilise le terme de groupe pris au sens logico-mathématique.
Michel Foucault (1926-1984) est peut-être le seul qui a fait de ce mouvement un instrument de combat philosophique dans les sciences humaines, avec pour effet de vider l'humain de sa chair, en principe pour mieux le saisir. Dans les Mots et les Choses (1966), il considère la mort de l'homme et l'effacement du sujet comme le point d'aboutissement des sciences humaines ; c'est ce que permet l'optique « structurale », qui considère la structure dans tout fait humain, psychologique, social, etc., comme ayant une réalité, non tangible, certes, mais effective et rendue intelligible par l'organisation logique que suppose la structure. Foucault est à peu près seul à aller aussi loin dans cette voie.
La critique du mouvement en donne une définition restrictive mais qui annonce sa fin ; par exemple Jacques Derrida (1930-2004, dans De la grammatologie et L'Écriture et la différence (1967), reproche à l'école structuraliste de suivre Saussure et de faire par là du « phonocentrisme ». Il l'accuse de privilégier dans la langue sa forme verbale et « sonore » et de mettre au deuxième plan sa forme écrite, en faisant de l'écriture « le signe d'un signe », un signe au deuxième degré. Il avait en effet compris quelles allaient être les limites de l'analyse structurale, notamment en linguistique – Chomsky s'en affranchira, signant la vraie mort du structuralisme.
En dehors de la linguistique et de l'anthropologie, c'est surtout la critique littéraire, avec les travaux de Roland Barthes et de Gérard Genette, qui fera date dans l'histoire du structuralisme, les autres secteurs, comme l'histoire, la marxologie ou la psychologie ne s'y rattachant que le temps d'une mode passagère.
Le structuralisme dans la littérature et la critique littéraire
On doit à Lévi-Strauss et à Jakobson une étude du poème les Chats de Charles Baudelaire ; cette étude parue en 1962 est le texte fondateur du structuralisme appliqué à la littérature. Le texte littéraire est considéré par la critique structuraliste comme une manifestation de la langue ; on l'étudie à l'aide des structures (réseaux) servant à l'analyse linguistique, qu'elles soient d'ordre grammatical, syntaxique, rhétorique, phonétique ou autre. Le texte est perçu non comme une entité unique et originale, mais comme le point de convergence de tous ces réseaux de signification. Michael Riffaterre (1924-2006) a introduit dans la pensée structuraliste la notion de stylistique, définie comme une étude linguistique des « effets du message », c'est-à-dire comme une prise en compte des effets du texte sur le lecteur (Essais de stylistique structurale, 1971). Pour Riffaterre, le lecteur a un rôle actif : il doit « interpréter » le texte. En effet, il ne s'agit pas seulement pour le lecteur de faire apparaître les différents réseaux qui le constituent, il faut aussi que ce lecteur fasse appel à sa culture et à son expérience pour faire exister le texte. Par là il ne suffit plus de considérer le texte comme un nœud de réseaux que l'on peut analyser : il devient de plus une réalité sensible, incertaine, qui n'est jamais définitive, chaque lecteur ayant de lui une vision différente.
Roland Barthes (1915-1980) a été le chef de file de cette « nouvelle critique » qui allait appliquer aux textes littéraires les méthodes du structuralisme textuel. Après avoir étudié les signes, les symboles et les mythes de la société contemporaine (Mythologies, 1957 ; Système de la mode, 1967), Barthes a appliqué aux textes littéraires les procédés de l'analyse structurelle (Essais critiques, 1965 ; S/Z, 1970, etc.), et en premier lieu aux tragédies de Racine. Dans son ouvrage Figures III (1972), Gérard Genette (né en 1930) a lui aussi appliqué aux œuvres littéraires (particulièrement aux récits) les méthodes d'analyse structurale qu'il emprunte à la linguistique. L'originalité de sa méthode est d'avoir mis l'accent sur l'étude de la temporalité. Il s'est notamment intéressé à la notion de « présent de la narration ». Dans Palimpsestes (1982), il a défini l'intertextualité comme l'ensemble des relations qu'ont entre elles les citations, les références, les allusions plus ou moins explicites qui s'établissent entre les textes littéraires. Le critique littéraire a pour mission d'étudier cette intertextualité. Pour Genette, en effet, le texte littéraire est un « palimpseste », c'est-à-dire un manuscrit dont on a effacé le premier texte pour réécrire par-dessus : de la même manière, il faut regarder le texte littéraire comme créé d'une part à partir des événements vécus par l'auteur, mais bien davantage encore à partir de ses lectures. Le dernier structuraliste littéraire est sans doute le sémioticien Algirdas Lucien Greimas (1917-1992), auteur d'une Sémantique structurale (1966).
Le structuralisme en linguistique
Introduction
Un certain nombre de recherches convergentes ont marqué l'histoire de la linguistique dans le début du xxe s. et on a pu les considérer comme annonçant le grand mouvement du structuralisme.
La doctrine structuraliste en linguistique
Dans les années 1920, la linguistique se définit comme un domaine de recherche particulier à l'intérieur du mouvement positiviste et scientifique des sciences humaines (en allemand Geistwissenschaften). La linguistique est alors sous l'influence de deux hommes : Ferdinand de Saussure (1857-1913), dont le Cours de linguistique générale (1916) vient de dégager la notion de langue, par différence avec le langage, et qui oppose langue et parole ; et Edward Sapir (1884-1939), qui a posé pour la typologie des langues des critères formels et non plus historiques, et qui, dans cette perspective, oppose le pattern (« structure ») et la réalité parlée. Saussure avait proposé dès les années 1900 une hypothèse générale sur la nature et le fonctionnement du langage ; Sapir, indépendamment de Saussure, avait établi plusieurs distinctions qui annoncent le structuralisme, comme celle entre phonologie et phonétique, synchronie et diachronie.
Le principe fondamental du structuralisme peut être énoncé comme un principe d'immanence, en fonction duquel un énoncé réalisé ne peut être analysé qu'à partir de ses propriétés internes. Cela implique qu'on ne peut recourir à des analyses externes, historiques par exemple. L'étymologie en particulier ne sert à rien dans un énoncé du genre « le garçon mange la soupe à huit heures » : peu importe que « mange » vient d'un mot latin du genre manducat, que « soupe » vienne du francique suppa, qui est de la famille du gothique supon, « assaisonner », etc. Ce qui compte, c'est l'étude synchronique, « qui s'occupera des rapports logiques et psychologiques reliant les termes coexistants et formant système, tels qu'ils sont aperçus par la même conscience collective », et l'étude diachronique, « qui étudiera au contraire les rapports reliant les termes successifs non aperçus par une même conscience collective et qui se substituent les uns aux autres sans former système entre eux ». Cela a pour conséquence de remettre l'analyse linguistique au plan de l'énoncé même, et de refuser d'en sortir.
Ce même principe impose de plus d'établir une coupure radicale entre l'énoncé produit et les différents participants de la communication linguistique. Seul compte l'énoncé réalisé ; les motivations psychologiques de l'émetteur, les composants situationnels dans lesquels il est produit doivent être éliminés dans l'analyse. Pour décrire une langue, il faut partir d'un corpus constitué d'énoncés produits par un « locuteur natif » de la langue en question. Ces énoncés doivent être homogènes, provenir d'un locuteur représentatif de sa communauté linguistique.
La distinction entre langue et parole fait de la langue l'ensemble du corpus tel qu'il vient d'être défini et de la parole une réalisation particulière à partir de la langue. La langue est donc un ensemble clos, sur lequel on peut appliquer plusieurs procédures d'analyse pour dégager les unités de langue et les règles de combinaison entre ces unités.
Des oppositions importantes ont été dégagées par Saussure ; il pose en effet que la langue est un fait social, tandis que la parole est un fait individuel, et que la langue est un fait de mémoire, alors que la parole est un fait de création. Chomsky reprendra cette distinction en la généralisant sous la forme de la distinction compétence et performance.
Le fonctionnement de la langue suppose un principe essentiel au structuralisme, à savoir la nécessaire existence d'un ensemble de règles régissant les rapports entre ces unités. L'apport décisif du structuralisme est d'avoir redéfini la notion de valeur. La valeur de l'unité linguistique n'est ni réductible à son aspect de signifié (c'est-à-dire à son contenu de signification), ni à son aspect de signifiant (c'est-à-dire à sa forme acoustique, ou graphique). La valeur est liée au rapport entre le signifiant et le signifié, rapport qui constitue un élément original dans tout système linguistique. Cela oblige à définir chaque unité linguistique par opposition aux autres unités linguistiques, et met la négativité au cœur de leur nature ; comme le dit Saussure : « Leur plus exacte caractéristique est d'être ce que les autres ne sont pas. »
On définit les unités d'un système linguistique en opposition les unes avec les autres. Dans l'exemple déjà cité (« le garçon mange la soupe à huit heures »), l'important est qu'à le garçon puisse être substitué un autre item de la même classe que lui, du genre « la fille », « l'homme » ; à mange la soupe, un autre groupe de mots du genre « boit du lait » ; à soupe, un autre mot du genre « une pomme ». L'analyse structurale définit donc des unités substituables. Cet exemple permet de constater que deux opérations ont été mises en œuvre : la segmentation et la substitution. L'analyse structurale vise à délimiter les unités au travers de leurs relations. Les relations qui unissent les unités sont de deux types : les unes définissent les rapports existant entre chaque élément de l'énoncé (par exemple le garçon mange), les autres définissent les éléments en fonction de leur place dans l'énoncé, c'est-à-dire la classe des éléments susceptibles d'apparaître à chaque place de l'énoncé au complet (par exemple soupe, pomme, ou encore mange, dévore). Les relations du premier type sont dites syntagmatiques, les secondes, du type paradigmatique. Cette optique conduit à faire de la description linguistique un ensemble de procédures organisé en niveaux, qui, chacun, permettent de classer les éléments en unités spécifiques distinctes. Ainsi, un phonème se définit au niveau phonologique, le morphème au niveau morphologique. Chaque unité peut se substituer avec des unités de même niveau et chaque unité s'intègre dans une unité de niveau supérieur, dont elle est un constituant. Par exemple, les phonèmes /p/ et /r/ dans un contexte qui serait du genre /-a/ ou /-i/ : on a ainsi les unités phonétiques /pa/ et /ra/ ; en même temps /p/ et /r/ sont constitutifs des morphèmes /pas/ et /rat/ ou encore /pi/ et /riz/.
Le linguiste français Émile Benveniste (1902-1976), qui se rattache au courant structuraliste, définit quatre niveaux d'analyse : le niveau des traits distinctifs, le niveau phonologique, le niveau morphologique et le niveau phrastique. Pour bien situer ce modèle d'analyse, il faut reprendre la définition fondamentale du constituant immédiat telle que l'a formulée le linguiste américain Leonard Bloomfield (1887-1949). L'analyse en constituants immédiats est une méthode de décomposition des phrases qui consiste à isoler les segments qui « constituent immédiatement » chaque phrase, la phrase étant l'élément le plus vaste considéré (on pourrait en prendre de plus vastes : le paragraphe, le discours ou encore le chapitre, le livre, etc.). Puis on définit les segments qui constituent immédiatement ceux qui viennent d'être dégagés, et ainsi de suite jusqu'aux morphèmes et aux phonèmes. On obtient de la sorte une structure hiérarchisée dans laquelle chaque niveau s'intègre au niveau supérieur. Dans l'analyse de Benveniste, on remarque que, entre deux niveaux, par exemple du trait distinctif au morphème, les constituants de l'unité sont constituants de l'unité supérieure : le phonème est un constituant immédiat du morphème. En revanche, les morphèmes sont bien des constituants de la phrase, mais ils n'en sont pas les constituants immédiats. Il y a donc des éléments intermédiaires entre le niveau morphologique et le niveau phrastique.
Les écoles structuralistes de linguistique
La plus importante, celle qui initie le mouvement, est le cercle de Prague, fondé en 1926 à l'initiative de Vilém Mathesius et dominé par deux linguistes russes, Nicolaï Sergueïevitch Troubetskoï (1890-1938) et Roman Jakobson (1896-1982), qui passera aux États-Unis en 1941 et deviendra américain. Le premier se spécialise et fonde la phonologie. Le second cherche à intégrer les thèses du cercle de Prague dans un ensemble cohérent impliquant les modalités de fonctionnement du langage.
Une autre école est celle du cercle de Copenhague, autour duquel naviguent des linguistes comme Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965) et Viggo Brøndal (1887-1942). Hjelmslev est le premier structuraliste qui pose le problème d'une sémantique générale en postulant un isomorphisme entre le plan du signifiant et le plan du signifié.
Enfin l'école américaine est florissante. On peut y distinguer les noms d'Edward Sapir, de Leonard Bloomfield et de Zellig Sabbetai Harris (1909-1992).
Le structuralisme en linguistique s'est trouvé dépassé dans les années 1960 par la naissance du générativisme.
Le structuralisme en anthropologie
Introduction
Le mouvement s'est lui aussi distingué dès sa naissance par une critique de la méthode historicisante des écoles anthropologiques antérieures, le diffusionnisme et l'évolutionnisme. Il a donné naissance à deux mouvements distincts, le structuro-fonctionnalisme anglo-saxon et le structuralisme de Lévi-Strauss.
Le structuralisme anglo-saxon en anthropologie et en sociologie
Deux anthropologues dominent le structuralisme anglo-saxon : Bronisław Malinowski (1884-1942) et Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955). Avec eux, l'anthropologie quitte les bibliothèques et se lance sur le terrain, va voir les sociétés « archaïques » contemporaines, qui vivent à l'écart de la « civilisation », et essaie, à partir de cette observation, de dégager leurs principes d'organisation et de fonctionnement, et non plus de reconstituer de manière hypothétique leur passé. La méthode est dite structuraliste dans la mesure où elle suppose que chaque société constitue un système, un ensemble d'éléments interdépendants, comme la parenté, la culture, la religion, l'économie, la technique, qui n'acquièrent de sens qu'en fonction les uns des autres. L'anthropologie se fixe pour tâche de découvrir les relations qui existent entre eux. En fait, il faut également qualifier cette approche de fonctionnaliste, car elle vise à définir également la fonction que remplit chaque élément dans l'ensemble social où il se trouve. On a pu rattacher cette optique à la doctrine organiciste des sciences naturelles : en effet, elle aboutit à expliquer les institutions sociales par les fonctions qu'elles remplissent, et les fonctions par les besoins naturels qu'elles satisfont, aussi bien individuels que collectifs.
Pour Radcliffe-Brown, les structures concrètes constituent la matière première de l'observation anthropologique, l'ordre immédiatement observable, et les structures générales, « abstraites », qui les organisent, constituent des modèles qui permettent de les comprendre. Il y a donc une communauté de nature entre les deux types de structures pour Radcliffe-Brown, les unes et les autres s'étayant réciproquement. Cette approche n'est pas recevable par Lévi-Strauss, et c'est sur ce point, comme on le verra, que sa conception va diverger avec l'école anglo-saxonne.
Les Américains vont s'attacher à définir avec plus de précision que leurs confrères britanniques les problèmes méthodologiques, et axer la recherche sur un domaine plus généralisable que celui fourni par les seules données ethnographiques, la sociologie. C'est ce que tente le sociologue Talcott Parsons (1902-1979). Il définit la structure comme une disposition stable échappant aux fluctuations de son environnement, en opposition avec la fonction, qui est l'effort continuel de l'adaptation de la structure aux changements. Structure et fonction sont donc étroitement liées dans le système social : elles permettent de comprendre son organisation et sa dynamique. Mais tout cela n'est aux yeux de Parsons qu'un système conceptuel destiné à fournir un cadre à l'action. L'élément basique à partir duquel toute société est construite n'est pas l'individu, mais l'action. Toute action implique des corrélats à partir desquels elle se construit ; ces corrélats sont des normes, des symboles ou encore des valeurs. Les corrélats de l'action sont construits à partir des conditions structurelles antinomiques, au nombre de cinq, en face desquelles se trouve tout acteur. Ce sont : 1° affectivité/neutralité affective ; 2° altruisme/égocentrisme ; 3° universalisme/particularisme ; 4° qualité/accomplissement ; 5° spécificité/diffusion. Ce modèle permet d'expliquer les actions et les rôles des individus. Par exemple, l'interaction entre l'agent de police et l'individu est neutre, altruiste, universaliste (commandée par des principes généraux), orientée vers l'accomplissement, et spécifique (limitée à une situation particulière). On peut imaginer toutes sortes d'autres combinaisons des alternatives fondamentales. Ainsi les exigences fonctionnelles auxquelles répond l'action s'accomplissent dans la réalisation de l'objectif, l'adaptation, le maintien des modèles de valeur, et l'intégration. Parsons relie ainsi le schéma fonctionnel et le schéma structurel, ce qui lui permet d'expliquer toutes les formes possibles de l'action sociale.
On a critiqué le structuro-fonctionnalisme de Parsons, en lui reprochant son caractère à la fois trop rigide, trop général et trop particulier, excluant nombre de situations sociales de ses capacités d'explication, et donc son caractère trop limité pour constituer un modèle, d'autant que sa démarche s'accompagne d'un formalisme rudimentaire.
Le structuralisme anthropologique de Lévi-Strauss
Lévi-Strauss a découvert le structuralisme avec les linguistes américains, notamment Jakobson. Il a cherché à en faire une méthode aussi rigoureuse que celle qui est à l'œuvre dans les sciences exactes. Il l'a notamment opposé au fonctionnalisme, dont les relents de finalisme lui paraissaient suspects. L'explication structurale est autosuffisante : il s'agit de partir des phénomènes pour remonter à leur structure cachée, par l'intermédiaire de modèles.
La structure est définie par Lévi-Strauss comme un ensemble de rapports invariants (corrélatifs ou antithétiques) qui expriment l'organisation du système. Selon ses termes, « la notion de structure sociale ne se rapporte pas à la réalité empirique, mais aux modèles construits d'après celle-ci ». Elle n'est donc pas observable directement, mais elle constitue le réel rendu intelligible sous forme logique, le modèle. Le modèle est un système symbolique qui permet d'accéder à la structure. Certains modèles appartiennent à une catégorie strictement logique, comme ceux que Lévi-Strauss utilise dans les Structures élémentaires de la parenté (1949) ; d'autres sont constitués de simples propositions ayant entre elles des rapports d'opposition, de corrélation, ou de génération. Ce sont ceux qu'on va retrouver dans sa série Mythologiques (1964-1971). Il existe des modèles conscients et des modèles construits, supposés inconscients : les premiers sont ceux que met en œuvre le système social de chaque peuple, les seconds sont ceux que (re)construit ou retrouve le chercheur qui étudie le peuple. Le structuralisme lévi-straussien repose sur quelques principes simples : 1° le principe d'immanence, qui fait que tout objet d'étude doit être regardé comme un système clos, dans son état actuel ; 2° la primauté du tout sur les parties ; les éléments de chaque ensemble n'ont pas de signification pris isolément, mais ne se conçoivent que dans leurs rapports réciproques ; 3° la primauté des rapports entre les éléments sur les éléments eux-mêmes. Par exemple, les mythes amérindiens mentionnent un arbre comme le prunier ou le pommier. Or ils ne sont pas substituables en tant qu'arbres, l'arbre n'a rien d'un support symbolique ; l'analyse montre que c'est la fécondité du prunier qui intéresse l'Indien, tandis que dans le pommier c'est la puissance et la profondeur des racines. L'univers du mythe, du conte, est analysable en paires d'oppositions, chaque élément est un « faisceau d'éléments différentiels » ; 4° la logique binaire est au point de départ de l'analyse mythologique ; mais elle inclut la complémentarité, la supplémentarité, la symétrie, et surtout la transformation.
Le structuralisme a atteint avec Lévi-Strauss un sommet de perfection qu'il ne dépassera pas ; son analyse des mythes amérindiens demeure un modèle du genre. Mais en même temps, il a signé l'arrêt de mort de ce grand mouvement : face aux sociétés figées, l'analyse structurale a montré son efficacité, mais elle paraît tout à fait insuffisante à l'égard des sociétés complexes, telles que celle dans laquelle nous vivons.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Stanislas Dehaene, les neurosciences et l'école |
|
|
| |
|
| |
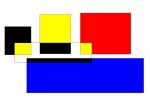
SANTÉ
Stanislas Dehaene, les neurosciences et l'école
Par Elena Sender le 10.01.2018 à 10h04
Lecture 6 min.
Ce spécialiste des sciences cognitives est à la tête du nouveau conseil scientifique pour l'éducation nationale officiellement lancé le 10 janvier 2018. Retrouvez le portrait que Sciences et Avenir avait consacré à Stanislas Dehaene.
NOMINATION. Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer installe ce 10 janvier 2018 un nouveau conseil scientifique de l’éducation nationale. Ce conseil, au pouvoir consultatif, est dirigé par Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, un de nos plus grand spécialistes des neurosciences cognitives. Ayant réalisé des travaux majeurs sur les mathématiques, le langage, il est particulièrement attaché à la communication des données des sciences cognitives aux parents et aux enseignants. Notamment via un site, Mon cerveau va à l’école.
Des petites lunettes et un enchevêtrement de chiffres sous une tête chauve. Voici comment les dessinateurs aiment à représenter Stanislas Dehaene, 52 ans, pionnier de la recherche sur les bases cérébrales du calcul et de la lecture. Son bureau est niché derrière l’étrange sinusoïde d'acier — une onde cérébrale figurée — de Neurospin, le centre de recherche de pointe du CEA situé à Saclay (Essonne). C’est ici, dans un modeste bureau où un triptyque de Marilyn accroché au mur toise des équations tracées sur un tableau blanc, que ce chercheur hors pair pourrait bien découvrir un jour les secrets de la conscience.
Stanislas Dehaene a toujours aimé les chiffres. Brillant élève en mathématiques, il quitte son Nord natal à 17 ans à peine pour intégrer l'École normale supérieure (ENS) de Paris. "Dès la première semaine, j’ai compris que je voulais résoudre des problèmes expérimentaux et étudier le cerveau ! Je rêvais de créer une intelligence artificielle", explique-t-il. Son père, chercheur reconnu pour ses travaux sur l’alcoolisme fœtal, féru d’expérience scientifique, n’y est probablement pas étranger. À l’ENS, le jeune homme se rapproche donc de Jacques Mehler, pionnier des sciences cognitives, qui entretient alors un vif débat avec Jean-Pierre Changeux, l’un des neurobiologistes les plus réputés au monde, professeur au Collège de France. "Pour résoudre notre différend, qui portait sur l’apport de la neuroscience à la psycho-linguistique, nous avons décidé de travailler ensemble et de prendre pour cela un étudiant en commun", se souvient Jean-Pierre Changeux. C’est ainsi qu’un matin, l’étudiant Dehaene est convoqué par le maître. "Stanislas a retenu mon attention parce qu’il avait une formation mathématique et une grande vivacité d’esprit", note-t-il. Affaire conclue !
Entre modèles théoriques et psychologie expérimentale
L’étudiant "très intimidé mais aux anges" va désormais naviguer entre la psychologie expérimentale enseignée par Mehler et les modèles théoriques en neurobiologie de Changeux. Il profite de cette confrontation pour se forger ses propres convictions : « J’étais persuadé que leurs conceptions évolueraient radicalement le jour où l’on pourrait observer les fonctions cognitives dans le cerveau. » L’histoire va lui donner raison. En 1988, le psychologue américain Michael Posner démontre que l’on peut visualiser des réseaux de reconnaissance des mots en utilisant le PET scan (tomographie par émission de positon), un examen d’imagerie médicale. "Un breakthrough [une percée] extraordinaire !" Dès lors, la véritable épopée scientifique de Stanislas Dehaene commence.
Pour Stanislas Dehaene, les robots pourront accéder à la conscience
L’explorateur a besoin de compagnons d’aventure. Stanislas Dehaene va ainsi, au fil des années, s’entourer de collaborateurs fidèles. Vingt-cinq ans après, ce sont quasiment toujours les mêmes. "Quand les chercheurs sont bons, on les garde !" Il embarque avec lui Laurent Cohen, neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L’ami — "avec qui j’ai appris à naviguer en voilier, à travers le monde" — va lui donner accès au graal : les patients. "Il m’a fait rencontrer des cas cliniques très particuliers, comme des lésions cérébrales qui provoquaient des acalculies [perte de l’intuition du nombre]." À coups d’expérimentations et d’imagerie, ils vont alors décrypter peu à peu les circuits cérébraux impliqués dans le calcul. Puis, pour ce boulimique de lecture qui dit dévorer "tout ce qui [lui] tombe sous la main, Nabokov, Borges, Perec, Proust mais aussi de la BD et la science-fiction", le passage des nombres aux mots va de soi. Il révèle alors les bases cérébrales de la lecture et enfin de l’écriture et se lance lui-même dans la rédaction de livres à succès. Dans les années 2000, Lionel Naccache, autre neurologue de la Pitié-Salpêtrière, monte à bord. Ensemble, ils réalisent les premières images cérébrales de l’invisible : le traitement subliminal des chiffres et des mots. Une révolution, qui ouvre les portes de la conscience.
Son but ultime : découvrir le "code neuronal"
"Découvreur", "créatif", ces adjectifs qu’on lui attribue souvent lui conviennent. "Pionnier sans doute, j’ai souvent eu la chance de pouvoir ouvrir de nouvelles voies. Car tout est possible avec l’imagerie cérébrale !" Il la compare à un télescope "que l’on peut pointer n’importe où dans le ciel". Au risque, il l’admet, de se disperser. "Il a très bien réussi, mais il ne faut pas qu’il se laisse séduire par sa réussite, taquine son mentor Jean-Pierre Changeux. Comme le disait Francis Ponge “le plus difficile pour le poète est de suivre son goût”."
Son goût, pour l’heure, c’est l’étude du sommeil et des liens entre langage et conscience. "Il s’est produit quelque chose dans le cerveau humain au cours de son évolution qui lui a donné accès à un niveau plus profond de représentation du monde, des autres et de soi-même. Cela l’a fait accéder à la conscience", avance Stanislas Dehaene. Un "code neuronal" nouveau serait ainsi apparu brutalement. "J’ai encore vingt ans devant moi pour le découvrir !", ajoute-t-il.
D’où viennent nos perceptions, nos sentiments, nos illusions, nos rêves ? Où s’arrête le traitement mécanique de l’information et où commence la prise de conscience ? L’esprit humain est-il suffisamment ingénieux pour comprendre sa propre existence ? Autant de questions explorées par Stanislas Dehaene dans son livre Le Code de la conscience publié aux éditions Odile Jacob.
Un coup d’œil à sa montre. Le chercheur revêt manteau et feutre noirs. Il a le pas rapide et l’agenda serré. Dans le hall, il montre avec fierté l’emplacement du département dédié à la recherche sur le cerveau du bébé, royaume de la pédiatre Guislaine Dehaene, son épouse. Et la mère de ses trois fils, "deux polytechniciens et un ingénieur". Que l’aîné se soit spécialisé dans les modèles mathématiques du cerveau et de l’apprentissage l’enchante. "On ne parle pas que cerveau à la maison, je vous assure !", ajoute-t-il en riant. On a du mal à le croire.
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
