|
| |
|
|
 |
|
L'ANALYSE MUSICALE |
|
|
| |
|
| |

L' ANALYSE MUSICALE.
L'analyse musicale est essentiellement destinée aux candidats préparant des examens ( BAC , CAPES , AGREGATION ...) , ainsi qu'aux élèves désirant étudier la COMPOSITION .
L' ANALYSE MUSICALE commence par l'étude des oeuvres du XIIeme siècle ( chant grégorien , monophonie , ARS NOVA ) et se poursuit par l'étude des oeuvres du XXeme siecle.
Les périodes comprises entre ces deux pôles sont toutes étudiées :
- LA RENAISSANCE
- LA PERIODE BAROQUE
- LA PERIODE CLASSIQUE
- LA PERIODE ROMANTIQUE
- LA PERIODE IMPRESSIONNISTE
- LA PERIODE MODERNE
- LA PERIODE CONTEMPORAINE
|
| |
|
| |
|
 |
|
LA FORME SONATE |
|
|
| |
|
| |

sonate
(genre)
Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la musique ».
Le terme de sonate a une longue histoire. Sa première utilisation pour désigner une pièce de musique instrumentale (sonate étant dans cette acception très générale entendu par opposition à cantate = pièce vocale) remonte au xiiie siècle : dans le texte sacré Vida de Santa Douce on parle de « Mens que sonavan la rediera sonada de matinas ». Au cours du xvie siècle, il est réservé exclusivement aux pièces pour luth. Du xiiie siècle à nos jours, il fait partie de la terminologie musicale la plus répandue, mais désigne des formes musicales assez différentes par leurs structures, leurs particularités stylistiques ou leur inscription dans la vie musicale.
La sonate baroque (env. 1585-1750)
Le terme « sonata » (ou « suonate », « sonnada ») désigne à cette époque une pièce instrumentale et s'avère particulièrement fréquent dans les tablatures de luth (espagnoles ou italiennes). Le terme « sonata » (de « sonare », jouer, sonner/klingen, tönen) s'oppose aux termes « canzona » et « cantata » (de « cantare », chanter/singen), sans que les principes compositionnels soient différents : les tablatures de luth d'O. Petrucci (1509) sont à la fois « per cantar e sonar ». Les sonates sont à l'origine des versions instrumentales de pièces vocales : au xvie siècle, les termes « canzona » et « sonata » recouvrent la même forme musicale, qu'on peut jouer ou chanter ; en 1572, N. Vicentino parle de « canzon da sonar », c'est-à-dire de chanson qui suppose une exécution instrumentale. L'appartenance de la sonate à la musique purement instrumentale est un phénomène relativement tardif. Les « sonates » orchestrales avec un ou plusieurs chœurs chez G. Gabrieli, ses Sacrae simphoniae ou ses Canzoni e sonate à 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 et 22 voix constituent des genres spécifiques particulièrement importants pour l'école vénitienne de la fin du xvie siècle.
Au cours de la première moitié du xviie siècle, la « canzona » instrumentale, plutôt rapide et avec traits polyphoniques, fait partie, comme deuxième mouvement, de la sonata da chiesa du cycle. Au début du xviie siècle, la théorie musicale établit une distinction entre canzone et sonates selon la formation (vocale ou instrumentale) et les traits stylistiques mouvement rapide et joyeux pour les canzone, caractère solennel et somptueux pour les sonates (M. Praetorius, Syntagmatis Musici [1615, 1618-19]).
Mais dans la pratique musicale jusqu'aux années 1750, les termes de sonata, concerto et sinfonia sont souvent confondus, et utilisés au même titre pour désigner des œuvres instrumentales assez différentes par leurs traits stylistiques et leurs particularités formelles. Ces problèmes ne sont pas à l'époque objet de réflexion théorique.
Le Dictionnaire de S. de Brossard de 1701 donne une définition de la sonate relativement proche de la pratique de l'époque classique : l'auteur souligne l'importance de l'invention émotive, harmonique, rythmique et contrapuntique, sans que le compositeur soit « assujetti aux règles générales du contrepoint » ; la sonate est destinée à une formation instrumentale comportant de une à huit voix ; la formation très répandue est celle d'un (ou deux) violon(s) avec basse continue. Le même auteur distingue aussi la sonata da camera, constituée d'une introduction lente et d'une série de danses, de la sonata da chiesa, qui comporte des mouvements lents et des mouvements rapides, souvent contrapuntiques. Au cours du xviiie siècle, le terme sonate perpétue la tradition de la sonata da chiesa (cf. les Sonates de Bach), tandis que la tradition de la sonata da camera, qui relève davantage de la musique de cour, se poursuit avec les dénominations suite, partita, ouverture à la française ou ordre (cf. les Partitas ou les Suites de Bach, par exemple).
Les formations instrumentales de la sonate à l'époque baroque sont fort diverses. Le baroque du début du xviie siècle se spécialise dans la sonate pour instrument seul avec basse continue et dans la sonate pour ensemble de cordes avec basse continue (cf. les Sonates de A. Corelli, P. Locatelli, J. Schenk, D. Buxtehude). Les sonates pour instrument seul sans basse continue (à l'exception des sonates assez nombreuses pour luth) sont relativement rares (cf. les Sonates pour orgue d'A. Banchieri, pour violon solo de H. Biber, pour clavecin de G. Del Buono). La sonate en trio, très répandue à l'époque, fait appel à un ensemble instrumental assez flexible qui dépend directement des possibilités concrètes du jeu. Elle est en principe pour 2 instruments « mélodiques » (2 violons, ou violon et flûte, par exemple), un instrument chargé de la basse continue (clavecin, par exemple), et un instrument à cordes grave (viole, violoncelle) chargé de renforcer cette basse continue, ce qui, paradoxalement, donne un total non pas de trois, comme le terme « en trio » semblerait l'indiquer, mais de quatre instruments. Cette flexibilité se retrouve dans des formations plus grandes, comportant des cordes, des vents, des théorbes, des luths, des guitares et orgue (ou clavecin). La tradition vocale des sonates de l'école vénitienne se perpétue dans la musique de M. Neri, F. Cavalli, G. Legrenzi.
La sonate baroque est caractérisée par la présence obligatoire de la basse continue, et est faite de motifs relativement courts et souvent répétés, sur une pulsation rythmique et harmonique rapide et continue, ayant recours à des procédés polyphoniques relativement simples. Domine la sonate à plusieurs mouvements (cf. les Sonates d'A. Corelli, F. M. Veracini, J. S. Bach, G. Tartini, J.-M. Leclair). Les mouvements sont contrastés par leur mètre (mouvement ternaire-mouvement binaire), leur style d'écriture (texture polyphonique-texture homophone), leur tempo (lent-rapide). La tendance générale est celle d'une réduction du nombre des mouvements (de 4 à 5 au début de l'époque baroque vers 3 à 4 au xviiie siècle). La structure formelle du cycle est très souvent modelée sur celle de la sonata da chiesa, ce qui donne une succession de quatre mouvements : lent-rapide-lent-rapide (cette succession est typique des sonates en trio d'A. Corelli) : le premier mouvement est d'habitude un allegro de rythme binaire, le deuxième une forme bipartite avec une texture polyphonique relativement simple, le troisième une sarabande solennelle, et le quatrième une gigue ternaire rapide, sans que les dénominations de ces danses deviennent celles des divers mouvements (ce qui au contraire fait loi dans les suites et les sonates « da camera »).
La structure en trois mouvements (rapide-lent-rapide, ou bien lent-rapide-rapide) est fréquente chez G. Tartini, C. W. Gluck, ou G. P. Telemann. La cohérence du cycle provient entre autres de son unité tonale. Les débuts des mouvements peuvent en outre être fondés sur des formules mélodiques et métrorythmiques similaires (cf. les Sonates d'A. Corelli) ; les mouvements peuvent avoir le même schéma formel et le même fondement harmonique. La structure la plus fréquente est la forme bipartite asymétrique, liée à l'origine aux danses de la suite (allemande, courante, sarabande, gigue, etc.).
Les titres ou programmes verbaux à contenu sémantique sont rares dans la sonate baroque (les Histoires bibliques de J. Kuhnau ou les Apothéoses de F. Couperin forment autant d'exceptions).
La sonate baroque fut un genre dominant au début du xviie siècle, d'abord en Italie du Nord, puis en Autriche, en Allemagne, en Angleterre et en France. Presque tous les compositeurs de l'époque baroque, à l'exception de C. Monteverdi, G. Frescobaldi, H. Schütz ou J.-B. Lully, qui néanmoins comptent parmi les plus connus, ont écrit des sonates pour diverses formations instrumentales.
On en trouve de nombreuses chez G. Gabrieli, G. B. Fontana, B. Marini, M. Neri, G. Legrenzi, A. Stradella, G. B. Vitali, G. Torelli, A. Corelli, G. B. Bassani, T. Albinoni, A. Vivaldi, B. Marcello, F. Veracini, G. Tartini, P. Locatelli, F. Geminiani, F. Durante, G. B. Martini, G. Pergolesi, mais aussi de J. A. Reinken, D. Buxtehude, H. Biber, G. Muffat, J. Pachelbel, J. J. Fux, J. Kuhnau, G. P. Telemann, J. Mattheson, J. S. Bach, G. F. Haendel, H. Purcell, Ch. W. Gluck, F. Couperin, J.-M. Leclair, etc. Elles permettent de suivre de près les transformations de l'écriture musicale et de la pensée formelle qui devaient mener au classicisme.
La sonate classique (env. 1735-1820)
La définition de la sonate classique comme forme musicale dotée de particularités thématiques harmoniques et formelles spécifiques ne devait intervenir que très tard, au cours des années 1840-1850, en plein romantisme. Les théoriciens de l'époque classique se bornèrent à souligner la variété expressive de la sonate en fonction des milieux et des sociétés (J.-J. Rousseau, J. G. Sulzer), à noter l'importance des relations tonales à distance (J. G. Portmann), et à insister sur les similitudes de caractère entre la sonate, l'ouverture et la symphonie (H. C. Koch), sans négliger pour autant leurs différences. Pour Koch, la symphonie, en tant que sonate pour orchestre, d'une part dispose d'un thématisme plus vaste et plus complexe que la sonate instrumentale, et, d'autre part, comporte davantage de relations thématiques à distance et davantage de continuité dans son déroulement global (Versuch einer Einleitung zur Komposition, 1782-1793). [→ SONATE (FORME)).]
Les critiques violentes lancées contre la profusion de la sonate (cf. l'Encyclopédie) posèrent en fait le problème de la place de la musique purement instrumentale par rapport à la musique vocale.
Alors que la sonate baroque avait été étroitement liée à l'évolution des instruments à cordes, l'histoire de la sonate classique fut largement celle des instruments à clavier : à partir des années 1760 (rappelons que le piano-forte de B. Cristofori date de 1709), un très grand nombre de sonates sont écrites exclusivement pour ce nouvel instrument. Le passage du clavecin au piano-forte coïncida largement, au xviiie siècle, avec le passage de la sonate baroque ou préclassique à la sonate classique. Les indications données dans les partitions des années 1750, « pour clavecin ou piano » (« cembalo o pfte »), se transforment en « pour piano ou clavecin » (« pfte o cembalo ») dans les partitions de sonates des années 1770.
Vers la fin du xviiie siècle le clavecin disparut des partitions en tant que substitut possible du piano, ce qui ne manqua pas de se traduire sur le plan de l'écriture et de la pratique compositionnelle.
La sonate pour instrument solo (cordes ou vents) avec piano se répandit, elle aussi, largement à la même époque, avec cette différence par rapport à l'époque baroque que l'instrument à clavier, émancipé de son rôle de basse continue, devint le plus important des deux, puisqu'on eut affaire à deux véritables solistes. Les premiers exemples en ce sens, compte non tenu de pages telles que les Pièces en concert de Rameau (1743), datent des années 1760 (cf. les sonates de P. Giardini, D. Pellegrini, L. Boccherini).
À citer également les sonates pour piano à quatre mains de J. C. Bach et Mozart, ou pour deux instruments de Pleyel (deux violons), Haydn (violon et alto) ou Mozart (basson et violoncelle). Dans la tradition des ensembles baroques variables, la sonate « accompagnée » pour piano, très répandue au xviie siècle, ajoutait parfois à la partie de piano une partie d'instrument ad libitum (violon, violoncelle ou instrument à vent) relativement facile à jouer. Cette pratique d'exécution et d'édition répondait aux besoins d'une vie musicale assez active, à laquelle participaient volontiers des musiciens non professionnels.
Jusque vers 1770, Haydn appela divertimentos ce que nous considérons actuellement comme des sonates pour clavier. De même, il appela jusqu'en 1795 « sonates pour piano-forte avec accompagnement de violon et de violoncelle » ce que nous considérons actuellement comme des trios. De même, la Sonate op. 47 (pour R. Kreutzer, 1805) de Beethoven porta encore la dénomination « Sonata per il pianoforte e un violino obbligato ». La Sonata per il clavicembalo o forte-piano con violino e violoncello (K 502, 1786) de Mozart est en fait un trio avec partie soliste pour les trois instruments.
La sonate du début du classicisme comportait le plus souvent trois mouvements : rapide-lent-rapide. Cette structure est la plus fréquente chez Haydn et Mozart, et reste dominante chez Beethoven. Dans ces sonates à trois mouvements, l'ordre et la nature des mouvements peut varier. Chez Mozart, l'ordre vif-lent-vif domine nettement. Il y a davantage de variété chez Haydn : vif-lent-vif, mais aussi vif-menuet-vif, vif-lent-menuet, lent-menuet-vif, lent-vif-menuet. La succession « italienne » en deux mouvements (deux mouvements rapides ou bien rapide-modéré), fréquente dans les sonates des compositeurs italiens (D. Alberti, L. Boccherini), se retrouve chez Haydn et Beethoven.
Ce dernier transposa également dans plusieurs de ses sonates la structure « symphonique » en quatre mouvements (vif-lent-menuet [ou scherzo]-vif). Ses successeurs (Schubert, Schumann, Weber, Brahms) devaient le suivre largement sur ce point. On retrouve également cette structure chez Jan Ladislas Dusík, moins chez Muzio Clementi ou Johann Nepomuk Hummel. Comme Hummel dans sa sonate en fa mineur op. 20, Beethoven utilisa comme finale de sonate la forme fuguée (cf. Hammerklavier)
Tous les compositeurs de l'époque classique en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France ou en Angleterre ont écrit des sonates pour diverses formations. Parmi les plus connus : D. Scarlatti, G. B. Sammartini, D. Alberti, P. Nardini, G. Sarti, G. Pugnani, L. Boccherini, J. Nyslivecek, G. C. Wagenseil, L. Mozart, J. Stamitz, C. Stamitz, A. Filtz, I. Pleyel, F. X. Richter, W. F. Bach, C. P. E. Bach, J. C. Bach, C. G. Neefe, P. Gaviniès, G. B. Viotti, M. Clementi, E.-N. Méhul, J. Haydn, W. A. Mozart et L. van Beethoven.
La sonate romantique après Schubert
Après Schubert, la sonate pour piano est un genre qui inspire de moins en moins de grands cycles de vingt ou de trente œuvres, et qui, plus encore que la symphonie, se fait rare, est pratiqué au coup par coup, les compositeurs produisant rarement plus de deux ou trois sonates, et faisant de chacune un cas particulier. Il est vrai qu'en même temps se développent de nouvelles formes pianistiques, qui ont en commun de privilégier la formule du recueil, de l'album qu'il soit simple juxtaposition, comme avec les nombreux cycles d'études, de fantaisies, de romances sans paroles, de nocturnes, etc., ou bien au contraire savante mosaïque conçue comme un tout (Carnaval de Schumann, ou Préludes de Chopin). Face à ces formes fluides et variées, la sonate, avec ses trois ou quatre mouvements dont on respecte généralement le moule, fait figure de genre figé et sérieux. Comme la symphonie, elle aura tendance à évoluer, dans les mains de certains, vers la conception cyclique, où l'on recherche une unité thématique entre les différents mouvements.
Parmi les sonates pour piano du xixe siècle, citons les trois sonates de Chopin (ut mineur, 1828 ; si bémol mineur, 1839, avec la Marche funèbre ; si mineur, 1844), plutôt rhapsodiques d'esprit, et guère animées par des préoccupations d'unité thématique ; les trois sonates op. 1, op. 2, et op. 5 de Brahms, à tendance cyclique ; les trois sonates de Schumann (op. 11 en fa dièse mineur, 1835, sous-titrée Florestan et Eusebius ; op. 14 en fa, 1836, sous-titrée Concert sans orchestre, et d'esprit cyclique ; op. 22 en sol mineur, 1835-1838, auxquelles il faut ajouter trois sonatines). Plus tardivement, mais dans cette même lignée, la sonate op. 7 pour piano de Grieg.
Mais le chef-d'œuvre de la sonate romantique est une pièce qui ne répond en rien au modèle formel de la sonate classique, et qui renouvelle complètement le genre : il s'agit de la grande sonate en si mineur de Franz Liszt (1853), œuvre cyclique d'une seule coulée, malgré ses moments contrastés, et apogée d'une certaine dramaturgie de la forme en constante réinvention, que l'on trouve déjà en germe chez Beethoven. Le travail architectural passionné qui y est à l'œuvre témoigne bien que le moule formel traditionnel en quatre mouvements, s'il convient encore très bien à la symphonie (laquelle a toutes les ressources de l'orchestre, et l'ampleur de sa forme pour se renouveler), paraît désormais un peu caduc, poussif, et manquant de souplesse, pour le genre de la sonate pour piano seul. Quel que soit l'intérêt des sonates de Chopin et de Schumann, on y sent fréquemment une certaine raideur, dont Liszt s'est libéré par un total bouleversement du genre.
En revanche, la sonate pour piano et violon, genre plus léger, voire mondain, puisqu'il offre des possibilités concertantes et se prête à une rhétorique de dialogue entre les deux instruments, se continue avec aisance chez Schumann (deux sonates), Brahms (trois sonates op. 78 en ré mineur, op. 100 en la majeur, op. 108 en sol majeur), Grieg (trois sonates op. 8, op. 13, op. 45), Dvořák, etc. Le genre voisin de la sonate pour violoncelle et piano est illustré par Brahms (op. 38 et op. 99), Schumann (une sonate), Chopin, Grieg, etc. On citera aussi les deux sonates pour clarinette et piano de Brahms, les six sonates pour orgue de Mendelssohn, et les douze sonates pour violon et guitare de Paganini (lequel appelle également « sonates » certaines de ses œuvres pour violon et orchestre).
La sonate moderne et contemporaine
Dans l'évolution plus récente du genre, on peut distinguer deux facettes, qui ont différemment évolué : soit la sonate en tant que forme définie par ses trois ou quatre mouvements et par son plan proche de celui de la symphonie ; soit la sonate comme genre consistant à mettre en valeur, à faire sonner un instrument généralement accompagné par le piano et faisant la démonstration de ses possibilités (sonates pour violon, violoncelle, mais aussi pour instruments à vent, ces dernières se développant au xxe siècle particulièrement).
Sonate pour piano seul
L'évolution de la sonate pour piano vers une conception plus sérieuse, construite et méditée (par opposition à la littérature pianistique « pittoresque » ou « impressionniste » se développant parallèlement), se confirme à la fin du xixe siècle et au xxe siècle. Les sonates pour piano isolées et denses d'Alban Berg (op. 1, 1907-1908), de Béla Bartók (1926), de Paul Dukas (1900), dont Debussy salua l'« émotion hermétique », de Georges Auric (op. 32), considérée par certains comme son chef-d'œuvre, et, bien plus tard, la grande sonate d'Henri Dutilleux (1949), sont des pièces très construites et volontaristes, où l'auteur a mis la part la plus sérieuse et la plus essentielle de son inspiration. En revanche, ces deux compositeurs-pianistes que sont Scriabine, avec ses dix sonates, et Prokofiev, avec ses onze sonates (dont l'admirable Septième) les deux dernières ayant été laissées inachevées en 1953 , sont presque les seuls, dans l'époque moderne, à se lancer dans de grands cycles. On citera aussi les deux sonates de Stravinski, dont celle pour piano seul (1924), explicitement inspirée par le travail architectural des sonates de Beethoven, mais aussi la Sonate pour deux pianos, 1943-44 les deux sonates de Rachmaninov, les deux de Chostakovitch, et la Sonata canonica écrite par Luigi Dallapiccola.
Quand l'ambition se fait plus modeste, on parle de sonatine, comme chez Maurice Ravel, Maurice Emmanuel, ou encore Sibelius. Quant aux trois sonates de Pierre Boulez, elles sont des étapes dans un processus de prise en compte, puis de destruction du moule traditionnel. La deuxième, écrite en 1950, aux dires de son auteur, est conçue comme une dissolution systématique des formes classiques attachées à chaque mouvement de la sonate classique (forme sonate du premier mouvement, mouvement lent, forme scherzo, forme canonique et fuguée pour le dernier mouvement), et Boulez signale cette œuvre comme la dernière où il fait référence aux modèles traditionnels. La troisième sonate, sous-titrée Formants, reconstruit sur cette destruction le projet d'une œuvre à multiples parcours, dont l'auteur s'est expliqué dans son article Aléa (on peut en jouer les segments dans différents ordres).
Quant à la Sonate pour deux pianos et percussion de Bartók, elle mérite ce titre par la tension formelle qui parcourt ses trois mouvements ; car il est courant que la sonate moderne se limite à trois mouvements, et non à quatre, pour obtenir un effet de concentration de pensée accrue.
Sonate pour piano et violon
On connaît les sonates françaises de Saint-Saëns (op. 75 et op. 102), de Fauré, de D'Indy, de Roussel, de Dukas, mais la plus célèbre et la plus « pensée », échappant au bavardage concertant, est la grande sonate cyclique en la majeur de César Franck (1886), où le travail d'engendrement des thèmes et d'évolution de la forme à partir de cellules d'intervalles génératrices est poussé extrêmement loin.
Chez Franck, la préoccupation formelle prime sur toute autre. D'autres sonates sont plutôt l'occasion de confronter ces deux entités, le violon et le piano, dans leur différence, qu'on met en évidence au lieu de la réduire : ainsi dans la sonate de Ravel (où l'auteur a voulu accuser l'incompatibilité des instruments) et peut-être dans les deux de Bartók (1921-22), remarquables en ce que les deux instruments n'y mettent pas en commun leurs motifs, et ont chacun des thèmes propres. On citera encore les deux sonates de Prokofiev (1938-1946 et 1944) la seconde étant une transcription de sa sonate pour piano et flûte , les deux d'Arthur Honegger, les trois de Darius Milhaud, les sept de Max Reger, les cinq de Martinů, sans oublier celles de Gabriel Pierné, Leoš Janáček, William Walton, Delius, etc.
Quant à la sonate pour violon et piano de Debussy (1915-1917), elle ne peut être citée qu'en la rattachant à ce cycle de six sonates que l'auteur voulait réaliser, et qu'interrompit sa mort : il n'en écrivit que trois, les deux autres étant la sonate pour piano et violoncelle, et la sonate pour flûte, alto et harpe : il est clair qu'il s'agit ici non de ressusciter ou de régénérer une forme, mais surtout de faire sonner des instruments solistes, dans un esprit de vagabondage formel et de légèreté.
Sonate pour violon seul
Glorieusement illustré par Jean Sébastien Bach, ce genre sévère a connu une certaine renaissance au xxe siècle avec les œuvres de Béla Bartók (1945), Prokofiev, Hindemith, Max Reger, Honegger, Migot, etc.
Formules diverses
Le violoncelle a été associé au piano dans la sonate déjà citée de Claude Debussy, mais aussi par Vincent d'Indy, Georges Migot, Hindemith, Prokofiev, Britten, Martinů, et utilisé en solo dans les sonates de Kodály et Sauguet.
La sonate pour flûte, comme les autres genres de sonates pour instruments à vent, est généralement traitée comme un genre aimable et rêveur avec les sonates et sonatines pour flûte et piano de Prokofiev, Poulenc, Dutilleux, Sauguet, Ibert, et même la Sonatine de Pierre Boulez.
Aujourd'hui, la sonate en tant que forme est, à quelques exceptions près, plutôt délaissée : si des œuvres d'avant-garde en prennent le titre (Sonate baroque, d'Alain Savouret, pour bande magnétique, et Sonata pian'e forte, de Gilbert Amy), c'est à un degré second, comme référence de genre et de forme complètement transposée et repensée.
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LA SYMPHONIE |
|
|
| |
|
| |

LA SYMPHONIE
Dans son sens principal, le terme de symphonie désigne le plus important genre orchestral, avec le concerto, de la musique occidentale à partir du xviiie siècle ; le plus représentatif aussi, puisque la symphonie beethovénienne a été dans toute la planète l'ambassadrice privilégiée de cette musique.
Caractéristiques
La symphonie est caractérisée par :
l'emploi de l'orchestre comme ensemble-masse, sans qu'il y ait opposition permanente d'un soliste à cette masse ; les solos dans les symphonies sont en principe des « prises de parole » isolées, au nom et au bénéfice de l'ensemble dont ils se détachent ;
un plan en 4 mouvements, disposés selon le moule de la sonate classique : allégro de forme sonate, précédé ou non d'une courte introduction lente ; mouvement lent, adagio ou andante ; menuet ou scherzo dansant à trois temps ; finale rapide de forme sonate, ou rondo-sonate ; on a parfois appelé, pour cette raison, la symphonie une sonate pour orchestre ;
des proportions qui, après Haydn, « fondateur » de la symphonie au sens moderne, et à partir de Beethoven, tendent (à de notables exceptions près il est vrai) à être de plus en plus importantes (une heure et demie chez Mahler, voire deux heures chez Messiaen).
Étymologiquement, le terme de symphonie dérive du grec symphonia (sun, « avec » ; phônê, « son »), « union de sons », « harmonie », « accord », « consonance » et aussi « concert ». Il a pris par métonymie une foule de sens, désignant tantôt un instrument (dans l'Antiquité une sorte de tambour et au Moyen Âge, sous le nom de « chifonie » ou « chifoine » la vielle à roue ou un autre instrument basé sur le même principe), tantôt la masse de l'orchestre lui-même, tantôt une intervention purement instrumentale ou orchestrale au sein d'une œuvre vocale sacrée (motet) ou profane (opéra), et enfin, à partir du xviie siècle, différents genres musicaux d'abord peu définis, dont le point commun était d'employer le ou les instruments sans la voix ni le texte, qu'il s'agisse de suites instrumentales (Symphonies pour les soupers du roy, de Michel Richard Delalande), de pièces polyphoniques pour instruments seuls (les sinfonie de Rossi et Banchieri) ou même de pièces instrumentales en solo (sinfonia au début d'une partita pour clavecin de Jean-Sébastien Bach). La symphonie moderne ne s'est trouvée qu'au milieu du xviiie siècle, mais il est curieux de noter qu'elle s'est définie d'abord par l'exclusion de la voix et du texte, et que celui qui l'a portée le plus haut, Beethoven, est aussi celui qui a fini par y réincorporer, dans sa 9e, le texte et la voix. Comme si la symphonie avait toujours conservé un rapport secret avec la voix humaine et la musique dramatique, fût-ce sous la forme de l'exclusion ou de la sublimation.
Au xviie siècle, le dictionnaire de musique de Brossard définit la symphonie comme une « composition pour les instruments », et, dans celui de Jean-Jacques Rousseau on lit que « le mot symphonie s'applique à toute musique instrumentale, tant à des pièces qui ne sont destinées que pour les instruments, comme les sonates et les concertos, qu'à celles où les instruments se trouvent mêlés avec les voix, comme dans nos opéras et dans plusieurs autres sortes de musique ».
On fait dériver la symphonie au sens moderne, c'est-à-dire la « sonate pour orchestre » dont Haydn a stabilisé le moule, de genres tels que l'ouverture d'opéra à l'italienne, avec ses 3 mouvements vif-lent-vif, jouée avant le lever du rideau, ou que l'ouverture d'opéra à la française fixée par Lully, également à 3 parties, mais dans l'ordre inverse : lent (pointé)-vif (fugué)-lent. De l'ouverture à la française, la symphonie aurait gardé le principe d'une introduction lente au premier mouvement rapide, enchaînée directement à lui. Les genres de la suite, du concerto et de la sonate instrumentale ont également contribué à la naissance de la forme symphonique.
Naissance de la symphonie classique
Le xviiie siècle voit d'une manière générale l'émancipation des formes instrumentales en dehors du cadre religieux ou dramatique, c'est-à-dire en dehors de la voix, du texte et du rite. Parallèlement à la symphonie, et en rapports étroits avec elle, naquit et se développa la salle de concerts. On sait l'importance qu'eut en France et en Europe la fondation d'une institution comme le Concert spirituel, grande consommatrice de pièces instrumentales, et en particulier de symphonies : ces pièces, destinées au début à être exécutées avant les grands motets, attirèrent peu à peu l'intérêt. Au Concert spirituel furent jouées les symphonies d'auteurs français comme Charles-Henri Blainville (né en 1711), Louis-Gabriel Guillemain, François Martin (1727-1757), Joseph Touchemoulin (1727-1801), Jean-Baptiste Miroglio, et plus tard celles de François Joseph Gossec (1734-1829), auteur d'une quarantaine de symphonies qui purent le faire passer pour un Haydn français. La plupart de ces symphonies françaises sont encore en 3 mouvements.
Les origines de la symphonie de concert sont aussi à chercher en Italie, du côté des sinfonie (pluriel de sinfonia) émancipées de leur fonction de préludes d'opéras, mais surtout de l'autre côté du Rhin : d'abord à Vienne, avec les symphonies en 3 ou en 4 mouvements de ces prédécesseurs ou contemporains de Haydn que furent G.-M. Monn (1717-1750), Wagenseil (1715-1777), Carlo d'Ordonez (1734-1786), Michael Haydn (1737-1806), Johann Baptist Vanhal (1739-1813) ou Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799). Il est vrai que l'époque consommait les symphonies comme aujourd'hui le public consomme des films, et Barry S. Brook, dans une étude sur la symphonie française à l'époque, compte environ 1 200 symphonies différentes exécutées à Paris entre 1750 et 1800.
Mais c'est surtout à Mannheim que l'on a voulu localiser la naissance de la symphonie moderne. De l'école de Mannheim, il semble à présent que l'on ait surestimé le rôle, même s'il ne fut pas mince. Les précurseurs et les modèles de Haydn sont en effet à rechercher à Vienne, et non à Mannheim. L'orchestre de Mannheim, assez important en effectifs, et dont le premier chef fut Johann Stamitz, permit à la symphonie de trouver un certain équilibre formel et orchestral (→ FORME SONATE).
Il faut signaler aussi, en Allemagne et en Angleterre, les symphonies de J. H. Hasse (1699-1783), de Johann-Gottlieb Graun (1698-1771), Karl-Henrich Graun (1701-1759), de J.-M. Molter (1695-1765), sans oublier celles des quatre fils de Jean-Sébastien Bach.
Dans toute cette activité symphonique européenne, s'affirment, malgré les différences notables quant au nombre et à la nature des mouvements, à la forme, à l'orchestration et au statut donné au genre, quelques constantes : raffinement de l'écriture orchestrale, des nuances et des procédés d'exécution ; enrichissement de la palette, avec des instruments à vent plus individualisés, sortant parfois de leur rôle de doublure ou de soutien harmonique pour tenir une partie propre ; allégement progressif de la basse continue. Ainsi, l'orchestre assouplit ses articulations et assoit sa formule de base : la naissance du genre de la symphonie s'accompagne de celle de l'orchestre symphonique au sens moderne.
Le plan de la symphonie
La naissance de la symphonie moderne est généralement associée à l'ajout d'un 4e mouvement venant se glisser entre le mouvement lent central et le mouvement rapide final de l'ouverture à l'italienne de coupe vif-lent-vif, donc à l'intérieur d'une forme traditionnelle tripartite conservée par le concerto, et qui en soi témoignait d'une belle symétrie. Mince conquête, en apparence, que ce petit menuet issu de la suite, avec son trio central, son rythme simpliste et son inspiration aimable : comment put-il contribuer à engendrer une forme nouvelle ? En cassant et en décentrant la symétrie vif-lent-vif, il donna à la symphonie ses bases modernes. Succédant à la gravité ou au charme mélodique du mouvement lent, le menuet vint affirmer un besoin de mouvement et de légèreté tout en aidant le finale à reprendre dans une dimension plus sérieuse et plus ambitieuse. En faisant « tampon » entre les langueurs du mouvement lent et la brillance du finale, le menuet ou le scherzo permettent à l'auditeur de respirer, et aux mouvements qui le précèdent et le suivent de s'étendre l'un et l'autre, de se raffiner, et de devenir infiniment plus complexes. On peut dire que le finale de symphonie ne conquit son indépendance, son ambition, sa largeur de perspectives qu'à la faveur du « détour » apporté par le 3e mouvement détour qui, en l'éloignant encore plus du premier mouvement, lui permit de renouer avec lui un lien plus fort, plus large. Quand 2 mouvements vifs se tendent la main par-delà un seul mouvement lent, comme dans le concerto, on débouche sur une simple complicité entre gens d'action, sans grand enjeu, pour une partie gagnée d'avance : souvent, l'allégro final d'une forme tripartite ne peut que viser court. Mais quand 2 mouvements, et non un seul, séparent le premier et le dernier, et que l'un de ces 2 mouvements est nettement léger le finale ne peut que viser plus loin et plus haut. Il doit en effet contrebalancer un échafaudage déjà lourd et complexe de 3 mouvements contrastés dont les forces convergent en lui.
La symphonie conserva en outre des liens secrets avec l'opéra, puisqu'elle est issue, notamment, de l'ouverture d'opéra. Le finale de symphonie se joue sur une scène plus vaste, plus encombrée de péripéties, que le finale de concerto, et ne peut plus compter, pour s'imposer, sur un simple effet de contraste et de dynamisme. Tout cela n'est, bien sûr, qu'une tendance, une potentialité, et il s'en faut de beaucoup que tous les finales de symphonies soient aussi ambitieux. Mais, dans certains finales de symphonies très plaisantes se contentant de prolonger sur une allure binaire et vive la gaieté ternaire du menuet-scherzo (cf. la 6e Symphonie de Schubert), on ressent, qu'on le veuille ou non, une certaine impression de redondance. À moins que, comme dans l'Italienne de Mendelssohn, ne soit jouée la carte du « toujours plus vite, plus brillant ». Ainsi, le finale tend à être placé sous le signe du « plus » : plus brillant, plus rapide, plus étonnant, plus savant. L'œuvre de Mozart (cf. la symphonie Jupiter) et celle de Joseph Haydn comptent déjà de ces finales placés sous le signe du triomphe et de la surenchère. Mais c'est évidemment avec Beethoven et surtout avec ses successeurs que le finale acquiert cette fonction dans la symphonie moderne.
Un autre problème de plan est celui de la place respective des 2 mouvements centraux, le mouvement lent et le menuet-scherzo. Une innovation de plus en plus fréquente, à partir de la 9e Symphonie de Beethoven, consiste à intervertir l'ordre habituel pour placer le scherzo en deuxième position. On en voit bien la raison dans le cas précis de la Neuvième, où l'adagio est traité comme une longue méditation introductive au finale. Un scherzo placé immédiatement après cet adagio viendrait en effacer la tension, et la dépenser sous la forme d'une excitation légère. Il devint d'ailleurs plus difficile, au xixe siècle, de réussir un finale rapide immédiatement précédé d'un scherzo. La variante introduite par Beethoven fut donc assez souvent reprise, car elle est propice aux vastes finales dramatiques venant exploser après la lenteur recueillie d'un adagio. De même, mis en deuxième position, le scherzo introduit souvent un élément terrestre et mondain, voire païen et dionysiaque, après lequel le mouvement lent apparaîtra d'autant plus recueilli et plus grave. C'est donc encore une fois ce mouvement intermédiaire de « divertissement » (au sens pascalien) qu'est le scherzo qui, selon son emplacement avant ou après le mouvement lent, conditionne l'équilibre ou plutôt le déséquilibre général. Ceci dans la mesure où étant facteur de dissymétrie et de déséquilibre, le scherzo ou le menuet devient du même coup facteur d'ouverture, d'inquiétude et d'expansion, par opposition à la symétrie satisfaite et fermée du concerto classique, à peine remise en cause pendant des siècles. À noter également que, grâce à ses menuets-scherzos, la musique symphonique put honorer ses racines populaires.
Entre les 4 parties de la symphonie, quel que soit leur ordre, il y a une répartition des fonctions, avec des dominances : dominance de la forme et de l'affirmation tonale dans le premier mouvement ; dominance de l'élément mélodique et lyrique pour le mouvement lent ; dominance de la pulsation rythmique pour le scherzo ou le menuet. Que reste-t-il alors au finale ? Une dimension théâtrale, rhétorique et dramaturgique, par sa fonction même, donnant à la forme son point d'aboutissement, peut-être son sommet, ou à défaut son issue.
Quand Debussy salue l'effort de Beethoven pour faire, avec sa 9e Symphonie, éclater le moule de la symphonie, et qu'il considère le genre comme usé et épuisé après cette tentative, connaît-il les créations de Bruckner et de Mahler ? On ne le dirait pas, car c'est sur la symphonie « cyclique » type César Franck et la symphonie « sur un thème folklorique » type Dvořák que portent ses sarcasmes : « Une symphonie est construite généralement sur un choral que l'auteur entendit tout enfant. La première partie, c'est la présentation habituelle du « thème » sur lequel l'auteur va travailler ; puis commence l'obligatoire dislocation… ; la deuxième partie, c'est quelque chose comme le laboratoire du vide… ; la troisième partie se déride un peu dans une gaieté toute puérile, traversée par des phrases de sentimentalité forte ; le choral s'est retiré pendant ce temps-là c'est plus convenable ; mais il reparaît et la dislocation continue, ça intéresse visiblement les spécialistes, ils s'épongent le front… » (écrit en 1902).
Évidemment, Mendelssohn est le premier visé, avec sa symphonie Réformation, que Debussy n'aimait pas. En fait, la symphonie s'est montrée plus vivace, beaucoup plus susceptible de renouvellement qu'il ne l'a dit.
Haydn et Mozart
Officiellement, Haydn est le « père de la symphonie » au sens moderne, c'est lui qui, par ses 104 ou plutôt 106 symphonies cataloguées, écrites de 1757 environ à 1795, a, le premier, donné au genre ses lettres de noblesse. Il s'est, le premier, révélé comme ayant « l'esprit symphonique », cet esprit pouvant se définir comme la faculté de fusionner divers éléments en un tout organique, de maintenir le sens du mouvement et d'exercer sur lui un contrôle continu, de maintenir la musique active ou du moins en activité latente, à tous les niveaux, de suggérer un sens de l'espace tendant vers l'infini et à dimension épique (tout cela par le biais de la forme sonate et d'une conception neuve de la tonalité). On distingue dans la production symphonique de Haydn plusieurs étapes avec notamment les symphonies Sturm und Drang, les 6 Parisiennes et les 12 Londoniennes (nos 93 à 104), ces dernières étant considérées comme le plus haut stade de la pensée symphonique de Haydn. Elles sont les plus proches de la symphonie à venir de Beethoven et de Schubert. Selon certains (cf. Pierre Barbaud), ces œuvres récupèrent et vulgarisent le travail formel accompli dans les quatuors (recherche d'unité thématique fondée sur de courts motifs générateurs, écriture savante), tandis que, pour d'autres, il y a là une richesse d'inspiration qui, en dehors de toute question de proportions extérieures, leur donne l'ampleur et la profondeur de pensée des constructions beethovéniennes.
Le corps des quelque 50 symphonies de Mozart, écrites de 1764 à 1788, n'est pas aussi réputé, pas aussi décisif dans l'évolution du genre (un phénomène inverse se produisit pour celui du concerto pour piano). Les très grandes pages de Mozart pour la symphonie ne sont que d'admirables cas particuliers, tandis que ses concertos forment un ensemble avec un trajet. On a parlé de la « docilité » de Mozart à la forme symphonique. Les 3 dernières symphonies, celles de 1788, sont sublimes, mais il est difficile d'en dégager une essence commune. Elles présentent des audaces et une liberté d'inspiration incontestable, mais ce sont toujours 1 ou 2 mouvements qui se détachent du tout, qui donnent le ton de l'ensemble : l'allégro initial dans la 40e Symphonie en sol mineur, et son menuet ; et, pour la Jupiter, le dernier mouvement. Il semble que Mozart ne s'investisse pas totalement dans la forme symphonique et qu'elle lui reste organiquement extérieure.
Les paradoxes beethovéniens
Les 9 symphonies de Beethoven, créées de 1800 à 1824, ont si fort marqué le genre qu'il n'a plus été possible de faire une symphonie sans en tenir compte dans un sens ou dans l'autre.
Elles sont dans la musique occidentale ce qui parle le plus immédiatement au public le plus large. Il n'est pas jusqu'à leur numérotation qui n'ait acquis une résonance magique. Est-ce à dire qu'elles ont mis au point un modèle, un canon unique de la symphonie ? Justement pas. C'est leur variété qui fascine, à l'intérieur du modèle haydnien, jamais remis en cause de façon fondamentale, pas même dans la 6e Symphonie (Pastorale), ni même dans la 9e (« avec chœurs »). C'est leur autorité comme ensemble, et leur variété dans les tons qui en fait quelque chose d'unique. On peut y trouver en germe toutes les directions prises ultérieurement par la symphonie : la Pastorale préfigure les symphonies descriptives (Richard Strauss) et en même temps les symphonies cosmiques et évocatrices de tableaux naturels de Mahler. Dans la 9e Symphonie, il y a la symphonie mahlérienne avec chœurs et solistes, ainsi que le principe cyclique d'un thème prépondérant amené par la récapitulation des thèmes précédents. Dans cette même œuvre, l'inversion du scherzo par rapport à l'adagio est un geste formel qui sera beaucoup imité, en particulier par Mahler dans sa 6e. La 8e annonce les symphonies néoclassiques, néohaydniennes et vivaces (cf. la Symphonie classique) de Prokofiev. L'Héroïque préfigure toutes les symphonies guerrières, nationales et conquérantes de Dvořák ou Tchaïkovski. Inversement, on peut trouver le germe de la Fantastique de Berlioz dans différentes symphonies de Beethoven : la Scène aux champs rivalise avec la Pastorale, le principe cyclique avec thème conducteur découle un peu de la 5e.
Il y a un côté démonstratif, oratoire, dans la façon dont ces symphonies travaillent la forme : le travail des motifs ne peut être caché, dissimulé, comme dans les ricercari à l'ancienne manière, faits pour l'amateur ; il est, au contraire, affiché, souligné, dramatisé, créant par lui-même la matière d'un drame. Chez Beethoven, l'architecture apparaît en pleine lumière, alors qu'auparavant on cherchait plutôt à la dissimuler. Le travail formel s'exhibe donc avec une certaine impudeur, et les thèmes sont souvent susceptibles de se réduire à une cellule de base rythmique très identifiable : les « quatre coups du destin » dans la 5e Symphonie, le rythme noire-deux croches dans l'adagietto de la 7e, etc.
La symphonie après Beethoven : Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms
Ces quatre compositeurs regroupés sous l'étiquette « romantique » ont composé des symphonies dans la suite directe de leur grand prédécesseur, et chacun a résolu à sa manière le problème de cette paternité. Ainsi, Schubert passait de son vivant, comme on sait, pour un petit maître dans une petite forme : le lied. Peu de gens s'attendaient à ce qu'il donnât des symphonies grandioses et architecturées. Lui-même ne semblait pas s'en juger capable au début, car ses 6 premières symphonies connues sont de proportions modestes et, à part la Tragique, c'est-à-dire la 4e, qui a des accents beethovéniens, renvoient plutôt à Mozart et au Beethoven des 2 premières symphonies. Ces 6 premières symphonies sont des œuvres attachantes, délicieuses, mais très circonscrites et policées dans leur forme, sans ce côté éperdu que Schubert mettait dans ses sonates pour piano et certains de ses quatuors. Mais, après la fameuse Inachevée, classée 8e, la 9e, dite la Grande Symphonie en ut (1825-26), redécouverte elle aussi après la mort de Schubert et saluée par Schumann, réalise complètement l'assimilation du genre : c'est une longue symphonie, mais de ton schubertien. Elle trouve son souffle, non en haussant sa voix ou en s'acharnant sur un travail de forme paralysant, mais en suivant son cours, aussi ductile, aussi coulante qu'une œuvre pour piano.
Œuvres de synthèse, les 5 symphonies de Mendelssohn (si on laisse de côté ses 12 symphonies pour cordes de prime jeunesse [1821-1823]) veulent réconcilier la référence descriptive et évocatrice, ou le message religieux, avec la logique et la fermeté d'une forme classique, comme pour faire la jonction entre le projet romantique de type berliozien et un souci de néoclassicisme. Ainsi, le propos « touristique » des symphonies Italienne et Écossaise n'empêche pas ces œuvres de garder des proportions et une forme sévèrement tenues. La symphonie Réformation est un des premiers exemples de la symphonie « à choral » dont se moque Debussy, mais dont Bruckner devait porter très haut l'inspiration. Et la symphonie avec chœurs Lobgesang est une œuvre festive qui, inévitablement, louche vers la 9e de Beethoven. Un des plus grands soucis de Mendelssohn, avec la retenue orchestrale, reste l'« unité », la cohésion, le souci cyclique qui fait de l'œuvre « un ensemble étroitement noué » : c'est ainsi que l'Écossaise doit s'exécuter d'une traite.
Ce même projet néoclassique de fermer la symphonie sur elle-même est à l'œuvre dans les 4 symphonies de Robert Schumann, qui n'est pas toujours le romantique échevelé qu'on croit : autant, au piano, il se donne toute licence de forme, autant, à l'orchestre, il est respectueux de la tenue formelle de la symphonie, et de son caractère de continuité et de gravité. Il y a évidemment de l'originalité et de la grandeur dans la conception cyclique de la 4e Symphonie en ré mineur entreprise en second, et achevée la dernière, et destinée à être, comme l'Écossaise de Mendelssohn, exécutée d'une traite. On en retient cependant une certaine grisaille et le même sentiment d'obsession tourmentée et laborieuse que dans l'Écossaise ; mais le travail formel a quelque chose d'une machine qui tourne à vide. Ce n'est pas un hasard si les très grandes symphonies postbeethovéniennes sont celles où le compositeur risque tout, se donne tout entier, comme c'est le cas pour Bruckner et Mahler, qui ont investi tout leur travail de compositeur sur ce genre.
Même les belles symphonies de Brahms gardent un côté laborieux et démonstratif qui a fait parler à leur propos d'« inutile beauté ». Brahms a longtemps attendu avant de s'attaquer à la symphonie. Bien sûr, aucune des 4 qu'il composa n'a de programme, ni ne contrevient au modèle classique en 4 parties. Curieusement, dans leur solidité formelle et leur couleur compacte, elles ont parfois plus de séduction, de largeur, d'abandons, de surprises, que les symphonies de Schumann une fois franchi le cap de la 1re Symphonie en ut mineur, qui semble portée à bout de bras par le souci de faire bonne figure à côté de Beethoven, car c'est bien à propos du finale de cette œuvre et de son thème en ut majeur, sorte de pastiche de l'Hymne à la joie savamment amené, qu'on peut légitimement parler de beauté creuse et suffisante. Dès la 2e Symphonie, Brahms se laisse souvent aller au romantisme et à la liberté de ses intermezzi pour piano.
Après Beethoven : Berlioz et Liszt
D'autres compositeurs prirent la suite de Beethoven en considérant implicitement le moule classique comme n'offrant plus de ressources neuves, et en cherchant à ouvrir la symphonie à la liberté. Berlioz et Liszt furent de ceux-là. On sait comment Hector Berlioz s'arrangea pour écrire 4 symphonies dont aucune ne se ressemble, et dont aucune n'est conforme au modèle traditionnel (la Fantastique en 1830 ; Harold en Italie, en 1834 ; Roméo et Juliette en 1839 ; et la Symphonie funèbre et triomphale en 1840). La notion de symphonie devient alors un fourre-tout très utile pour innover, pour expérimenter, à l'abri d'un titre propre à rassurer les foules… et les organisateurs de concerts.
Liszt, admirateur de Berlioz, reprit à ce dernier la forme symphonique libre à programme, avec la Dante-Symphonie (1854) et surtout la Faust-Symphonie (1854-1857), qui annonce les grandes symphonies autobiographiques de Mahler. On rattache souvent au modèle berliozien de la symphonie à programme les deux symphonies descriptives de Richard Strauss, Sinfonia domestica (1904) et Alpensymphonie (Symphonie des Alpes, 1915), sortes de grands dioramas pittoresques qui tiennent en effet plus de la tradition descriptive française que du projet lisztien, lequel est plus dramatique, voire religieux.
L'ultrasymphonie : Anton Bruckner et Gustav Mahler
Nous appelons « ultrasymphonie » la symphonie brucknérienne et mahlérienne, parce qu'elle poursuit le genre en le faisant passer dans une dimension plus large, celle, presque, d'un opéra, d'un parcours dramatique complet et, comme disent les Allemands, « abendfüllend » (« remplissant une soirée »). À part cela, les deux compositeurs ont des démarches et des styles très différents. Bien que très développées, les symphonies de Bruckner conservent les 4 parties classiques, avec un scherzo situé généralement en troisième position, et adoptent pour les mouvements extrêmes une forme sonate élargie et raffinée (avec en général 3 thèmes au lieu de 2). Leur orchestration est grandiose, mais fuit les effets pittoresques et descriptifs. Elles sont concentrées sur elles-mêmes.
Bruckner apparaissait néanmoins à ses contemporains, et non sans raisons, comme un musicien compliqué, névrotique, obscur et wagnérien. Il élabora, en effet, une musique très modulante, raffinée de forme, extrêmement abrupte et pathétique et souvent remise sur le métier. Il porta la nouveauté au sein de la symphonie classique, dont il distendit le modèle en le respectant, la forme ancienne n'ayant pas, contrairement à ce que d'autres pensaient, tout dit avec Beethoven.
À l'opposé, Gustav Mahler voulut étendre ses symphonies aux dimensions du monde, en particulier en y intégrant la voix. Des 9 (ou 10) symphonies achevées, 4 seulement comprennent une importante partie vocale et/ou chorale (2e, 3e, 4e, 8e), mais on peut dire que toutes suivent un « programme » métaphysique et autobiographique, explicite ou implicite. Adorno les a judicieusement comparées à des romans. Reste en outre le cas particulier du Chant de la terre. On connaît la définition personnelle que Mahler en donnait : « Le terme symphonie signifie pour moi : avec tous les moyens techniques à ma disposition, bâtir un monde » (1895) ; et sa boutade au jeune Bruno Walter : « C'est inutile de regarder le paysage, j'ai tout mis dans ma 3e Symphonie » (1896). Il y a souvent plus de 4 mouvements, et l'ordre traditionnel est rarement respecté, Mahler adoptant le genre de la symphonie comme le plus propre à faire accepter par le public des conceptions musicales et stylistiques tout à fait singulières.
Mahler et Bruckner composèrent tous deux après Wagner et d'après Wagner ; ils prennent en compte le phénomène wagnérien dans son énormité, en tirent des inspirations de forme, d'orchestration, d'écriture (travail des motifs), et eurent le même réflexe de ne pas chercher à lutter contre lui sur le terrain où il s'était affirmé : l'opéra. Bruckner distendit le modèle de la symphonie de l'intérieur, dans son tissu même ; Mahler introduisit dans ce tissu des corps étrangers. Le genre s'avéra pour ces deux compositeurs, non pas un ersatz d'opéra, un pis-aller, mais plutôt un magnifique « lieu de projection », à la fois riche, stable, et susceptible d'expansion infinie.
La symphonie française
On aurait pu penser que les Français auraient revendiqué l'exemple de liberté donné par Berlioz. Par un chassé-croisé assez typique, ce fut au contraire Liszt qui s'inspira de Berlioz, tandis que les Français semblent avoir eu à cœur de prouver qu'ils s'entendaient aussi bien que les Allemands à faire de belles symphonies, dans les règles et les proportions classiques : ainsi, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Lalo, Chausson, Paul Dukas, Albéric Magnard, etc. C'est néanmoins la Symphonie en ré mineur de César Franck (1886-1888) qui reste la plus jouée. On a là un admirable exemple de symphonie cyclique, dans laquelle le principe de « retour du thème » ne sonne pas le creux, et où tous les mouvements sont soudés par une affinité profonde.
Les 4 symphonies d'Albert Roussel relèvent d'une solide et talentueuse inspiration néoclassique et sont peut-être parmi les plus spécifiquement françaises du répertoire, dans leur mélange de vivacité, de concentration et de rigueur.
La symphonie « nationale » : Russie, Europe centrale, etc
De manière inattendue et logique, le genre à la fois très codifié et très populaire de la symphonie a servi à des compositeurs issus de pays « excentriques » par rapport à la vieille Europe (Russie, Europe centrale, pays scandinaves, etc.) pour se faire introduire et reconnaître non seulement dans leurs propres pays, mais aussi dans les milieux musicaux de cette vieille Europe. Ces symphonies inspirées par le modèle formel classique prennent souvent une estampille nationale et officielle par l'utilisation de thèmes folkloriques empruntés à la tradition du pays. Ainsi, on fait coup double : on donne à la musique populaire et à la tradition qu'elle représente ses « lettres de noblesse », et, en même temps, on réalise une sorte d'appropriation nationale d'un genre, pour la plus grande gloire de la patrie. Beaucoup de ces symphonies « nationales » et héroïques ne le sont que par l'apparition d'un ou de plusieurs thèmes du fonds populaire, passés à la moulinette d'un même style savant international ; mais, pour énoncer ces thèmes, elles adoptent un ton altier, un ton de proclamation, qui donne au moindre motif une allure de déclaration d'indépendance ou de patriotisme. Or, le ton « national » que l'orchestre peut prendre est le même pour tous les pays. Debussy s'est moqué avec esprit de cette veine « folklorique », qui, pourtant, a aidé bien des cultures nationales à s'affirmer et à se faire respecter, en passant l'examen de passage de la symphonie réglementaire.
« La jeune école russe, dit Debussy, tenta de rajeunir la symphonie en empruntant des idées aux thèmes populaires : elle réussit à ciseler d'étincelants bijoux ; mais n'y avait-il pas là une gênante disproportion entre le thème et ce qu'on l'obligeait à fournir de développements ? Bientôt, cependant, la mode du thème populaire s'étendit sur tout l'univers musical : on remua les moindres provinces, de l'est à l'ouest ; on arracha à de vieilles bouches paysannes des refrains ingénus, tout ahuris de se retrouver vêtus de dentelles harmonieuses. Ils en gardèrent un petit air tristement gêné ; mais d'impérieux contrepoints les sommèrent d'avoir à oublier leur paisible origine. » Cette remarque est pertinente pour une œuvre folklorisante un peu empruntée comme la Symphonie sur un chant montagnard français de Vincent d'Indy. En revanche, pour la jeune école russe ou toute autre jeune école nationale, Debussy se trompe en affectant de croire que c'était pour « rajeunir la symphonie » que les compositeurs de ces pays empruntaient des thèmes à leur culture populaire alors que c'était plutôt pour appuyer leur jeune talent et leur propre culture sous l'autorité d'un genre ancien et respecté.
Glinka parla cependant de la difficulté de marier la musique populaire à la technique allemande du développement. Tchaïkovski, dans ses 6 symphonies, évolua de la symphonie folklorisante à la symphonie autobiographique. On doit également des symphonies basées sur des thèmes populaires russes à Rimski-Korsakov, Borodine, Balakirev, Glazounov et plus tard Rachmaninov.
En Tchécoslovaquie, Smetana incorpora le folklore national dans sa Symphonie triomphale (1853), et Dvořák ne composa pas moins de 9 symphonies entre 1865 et 1893, avec, en particulier, des scherzos et des mouvements lents portant souvent une inspiration populaire. Les pays scandinaves eurent également leurs symphonistes nationaux, comme le Suédois Franz Berwald, les Danois Niels Gade et Carl Nielsen, et surtout le Finlandais Jean Sibelius, qui, avec ses 7 symphonies données entre 1899 et 1924, s'imposa comme un des principaux rénovateurs du genre. En Grande-Bretagne, un des pays qui, au xxe siècle, a le plus cultivé la symphonie, il faut citer avant tout les 2 d'Elgar, les 9 de Vaughan Williams, les 4 de Michael Tippett, les 5 de Peter Maxwell Davies.
Bien que composées au xxe siècle, on peut situer dans la continuité des écoles nationales les créations symphoniques de Prokofiev et de Chostakovitch. Le premier composa 7 symphonies, dont la première, la Symphonie classique (1916-17), rend un hommage à Haydn en forme de pastiche. Les suivantes évoluent d'un modernisme tonitruant (cf. la 3e) jusqu'à une inspiration populaire et dynamique représentée par les 3 dernières.
Quant à Chostakovitch, pour qui la symphonie était « le plus complexe de tous les genres et le plus accessible à l'oreille des masses », il en écrivit 15, où se retrouvent toutes les vocations extramusicales du genre.
Retour à la symphonie pure
On s'est aussi préoccupé de refaire de la symphonie un genre de « musique pure », de l'arracher aux longueurs mahlériennes, aux confessions et aux messages. Il est significatif de voir comment Schönberg et, surtout, Webern ont fait porter sur la symphonie, comme genre symptôme, leur effort de concentration et de resserrement : qu'il s'agisse des 2 Symphonies de chambre de Schönberg ou de la très incisive et transparente Symphonie op. 21 (1928) d'Anton Webern, pur et bref exercice d'écriture sérielle, où l'orchestre réduit est atomisé en parties solistes. Dans un style tout différent, Hindemith a poursuivi le même propos, qui était de redonner à la symphonie sa dignité de genre objectif construit sur une forme, non sur des idées. Après la guerre, en Allemagne, Karl Amadeus Hartmann et Hans Werner Henze ont continué dans cette voie, et compte non tenu de la Symphonie de psaumes et des Symphonies d'instruments à vent, dont le titre se réfère au sens ancien du terme, Stravinski a réalisé avec sa Symphonie en ut (1940) et sa Symphonie en trois mouvements (1945) des œuvres ostensiblement néoclassiques et objectives, dégagées de tout message comme de tout romantisme. Mais l'immense production de la symphonie « américaine » atteste que pour ce jeune pays, comme pour les Tchèques, la symphonie est une façon de se relier au tronc commun de la musique occidentale. À côté de la symphonie néoclassique, on y trouve des symphonies d'esprit mahlérien comme celles de Charles Ives. On peut citer aussi celles de Walter Piston, Samuel Barber, Aaron Copland, William Schumn, etc., et pour l'Amérique du Sud, celles de Carlos Chavez, Heitor Villa-Lobos, de Vagn Holmboe pour le Danemark, de Hilding Rosenberg pour la Suède, de Melartin, Klami, Englund, Kokkonen, Sallinen, Rautavaara, Aho, Kaipainen pour la Finlande, etc.
La symphonie française moderne
Ni Debussy, ni Ravel, ni Fauré n'ont laissé de symphonies : le genre était sans doute pour eux trop conventionnel et usé. Mais il fut repris et illustré par des compositeurs du groupe des Six : Darius Milhaud, fidèle à son optique méditerranéenne, compose des symphonies d'un style assez délié et il ose même en faire plus de 9, affrontant l'interdit auquel ni un Tchèque comme Dvořák ni un Finlandais comme Sibelius n'avaient osé déroger. On ne lui doit pas moins de 12 symphonies pour grand orchestre et 6 symphonies pour orchestre de chambre. Quant à Arthur Honegger, il s'est recréé dans ses 5 symphonies sa propre tradition, intégrant librement les références germaniques sous une forme ramassée en 3 mouvements seulement. C'est de cette tradition humaniste que s'est réclamé Marcel Landowski pour ses 3 symphonies, dont Jean de la Peur (1949), tandis que Serge Nigg, lui, dans sa Jérôme Bosch-Symphonie (1960), s'est référé au poème symphonique. La Turangalila-Symphonie (1946-1948) d'Olivier Messiaen, avec son orchestre colossal et ses 10 mouvements, pourrait être d'un Mahler français contemporain. On peut citer aussi les 13 symphonies de Georges Migot (1919-1967), les 5 d'André Jolivet (1953-1964), les 7 de Jean Rivier, celles d'Henri Barraud, Georges Hugon, Jacques Chailley, Jean Martinon, Alain Bancquart, etc.
Parmi les symphonies françaises contemporaines les plus célèbres et les plus personnelles se distinguent celles d'Henri Dutilleux, qui prouve que la forme et le nom de « symphonie » sont encore capables d'inspirer les œuvres les plus variées et les plus personnelles. L'époque moderne n'a pas tué la symphonie. On peut citer, par exemple, la Sinfonia, de Luciano Berio (1968), qui se défend d'être une symphonie alors qu'elle en présente bien des caractères. La vitalité de la symphonie montre que ce genre est à la fois forme et esprit, au carrefour de la musique « pure » et de la musique « à idées », genre synthétique où la musique occidentale a trouvé un lieu de projection sans égal.
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
XENAKIS |
|
|
| |
|
| |
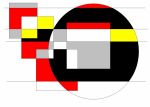
Iannis Xenakis est né en 1922 (ou 1921), à Braïla (Roumanie), au sein d’une famille grecque. Il passe sa jeunesse à Athènes, où il achève des études d’ingénieur civil et s’engage d’abord contre l’occupation allemande, puis contre l’occupation britannique (guerre civile). En 1947, après une terrible blessure et une période de clandestinité, il fuit la Grèce et s’installe en France, où il travaille pendant douze ans avec Le Corbusier, en tant qu’ingénieur, puis en tant qu’architecte (Couvent de la Tourette, Pavillon Philips de l’Expo universelle de Bruxelles de 1958 – où fut donné le Poème électronique de Varèse – célèbre pour ses paraboloïdes hyperboliques).
En musique, il suit l’enseignement d’Olivier Messiaen et, dans un premier temps, emprunte une voie bartókienne qui tente de combiner le ressourcement dans la musique populaire avec les conquêtes de l’avant-garde (les Anastenaria, 1953). Puis, il décide de rompre avec cette voie et d’emprunter le chemin de l’« abstraction » qui combine deux éléments : d’une part, des références à la physique et aux mathématiques ; d’autre part, un art de la plastique sonore. Les scandales de Metastaseis (1953-1954) et de Pithoprakta (1955-1956), qui renouvellent l’univers de la musique orchestrale, le hissent au niveau d’alternative possible à la composition sérielle, grâce à l’introduction des notions de masse et de probabilité, ainsi que de sonorités faites de sons glissés, tenus ou ponctuels. C’est également l’époque de ses premières expériences de musique concrète ou, entre autres, il ouvre la voie du granulaire (Concret PH, 1958). Son premier livre, Musiques formelles (1963), analyse ses applications scientifiques – qui vont des probabilités (Pithoprakta, Achorripsis, 1956-1957) à la théorie des ensembles (Herma, 1960-1961) en passant par la théorie des jeux (Duel, 1959) – ainsi que ses premières utilisations de l’ordinateur (programme ST, 1962).
Durant les années soixante, la formalisation prend de plus en plus l’allure d’une tentative de fonder la musique (au sens de la crise des fondements en mathématiques), notamment avec l’utilisation de la théorie des groupes (Nomos alpha, 1965-1966) ou encore la distinction théorique « en-temps/hors-temps » (article « Vers une métamusique », 1965-1967) – on pourrait trouver un équivalent architectural de la question des fondements dans le projet de la Ville cosmique (1965). En revanche, avec Eonta (1963-1964), c’est le modèle du son qui est parachevé. Ce sont des œuvres (libres) telles que Nuits (1967), qui lui font acquérir une très large audience, en même temps que les pièces spatialisées (Terretektorh, 1965-1966, Persephassa, 1969) : le public découvre que la formalisation et l’abstraction vont de pair avec un aspect dionysiaque prononcé, où la musique se conçoit comme phénomène énergétique. La décennie suivante est marquée par l’envolée utopique des Polytopes (Polytope de Cluny, 1972-1974, Diatope, 1977), prémices d’un art multimédia technologique caractérisé par des expériences d’immersion. Avec les « arborescences » (Erikhthon, 1974) et les mouvements browniens (Mikka, 1971), Xenakis renoue avec la méthode graphique qui lui avait fait imaginer les glissandi de Metastaseis, méthode qu’il utilise également dans l’UPIC, premier synthétiseur graphique, avec lequel il compose Mycènes alpha (1978). Les années soixante-dix se concluent avec l’utilisation extensive de la théorie des cribles (échelles). Ceux-ci, appliqués aux rythmes, assurent un renouveau de l’écriture pour percussions (Psappha, 1975). En tant qu’échelles de hauteurs, ils témoignent, durant cette époque, de la quête d’universalité de Xenakis (le début de Jonchaies, 1977, utilise une échelle qui évoque le pelog javanais).
Le début des années quatre-vingt voit la création d’Aïs (1981), où, comme dans l’Orestie (1965-1966), le texte, en grec ancien, est source d’inspiration, mais, cette fois, avec des réflexions autour de la mort. Durant les années quatre-vingt, l’esthétique xenakienne s’infléchit progressivement. Encore marquée par les débordements énergétiques (Shaar, 1982, Rebonds, 1987-1988) ou les recherches formelles (cribles dans pratiquement toutes les œuvres, automates cellulaires dans Horos, 1986), elle devient de plus en plus sombre (Kyania, 1990). Ses dernières œuvres (Ergma, 1994, Sea-Change, 1997) évoluent dans un univers sonore très épuré et dépouillé. La dernière, composée en 1997, s’intitule d’après la dernière lettre de l’alphabet grec (O-Mega). Xenakis est mort le 4 février 2001.
© Ircam-Centre Pompidou, 2007
DOCUMENT brahms.ircam.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
