|
| |
|
|
 |
|
Le libre-arbitre, vaste illusion ? Nos actions volontaires ne dépendraient peut-être pas de notre conscience |
|
|
| |
|
| |

CERVEAU ET PSY
Le libre-arbitre, vaste illusion ? Nos actions volontaires ne dépendraient peut-être pas de notre conscience
Par Héloïse Chapuis le 06.02.2020 à 16h13
Lecture 6 min.
Le libre arbitre n'est-il qu'une vaste illusion ? Les angles philosophiques et psychologiques sur cette question n'ont cessé depuis des siècles de se succéder, de s'opposer et de se compléter. Le débat est désormais nourri par une nouvelle découverte, cette fois-ci neuroscientifique.
La conscience, le libre-arbitre, ils intriguent depuis des siècles les philosophes, qui plus récemment ont été rejoints par les psychologues et les neuroscientifiques, en quête d’en percer les secrets. Les mouvements volontaires que chacun choisi de faire et les mouvements physiologiques sur lesquels nous n’avons aucun contrôle ont inspiré un effort scientifique de mise en lumière des mécanismes cérébraux impliqués dans la prise de décision individuelle.
Ce phénomène passe par des signaux électriques parcourant l’encéphale en traversant l’immense réseau de neurones qui le constitue. Les connexions électriques régissant les mouvements volontaires sont-elles différentes de celles qui sont à l’origine des battements du cœur, des paupières, de la respiration ou des réflexes moteurs qui répondent à des stimulations extérieures ? Sommes-nous véritablement conscients et libres d’agir, ou simples sujets à des processus physiologiques et cérébraux qui, eux, prennent toutes les décisions musculaires que l’on pensait « volontaires » ? La réponse à cette question a fait l’objet d’une étude suisse publiée dans la revue Nature Communications le 6 février 2020.
Le potentiel de préparation motrice précède toujours une action volontaire
C’est en 1965 que Hans Helmut Kornhuber et Lüder Deecke découvrent le potentiel de préparation motrice (RP pour readiness potential) à l’issue d’expériences visant à mettre à l’épreuve les actions volontaires. A l’époque, les chercheurs demandent à des participants coiffés d’électrodes d’appuyer à volonté sur un bouton. L’électroencéphalogramme qui surveille l’activité électrique du cerveau repère systématiquement une augmentation des signaux environ une seconde avant la performance volontaire. Le RP devient alors le marqueur de l’action volontaire qu’il précède à chaque fois, sans exception.
C'est la question du "libre-arbitre" qui est mise à l'épreuve dans cette étude. Mais l'enjeu n'est-il pas terriblement ambitieux ? L'un des scientifiques qui a participé au projet, Bruno Herbelin, concède à Sciences et Avenir qu'il est en effet quelque peu excessif d'affirmer parvenir à définir la totalité de cette notion complexe par le simple appui sur un bouton. Certes, les participants s'en remettaient durant l'expérience à leur volonté pour déterminer a quel moment ils appuyaient, mais cette action n'englobait pas complètement l'essence du "libre-arbitre" : les participants ne pouvaient qu'appuyer sur un bouton, et rien d'autre, même s'ils en choisissaient le moment. Cette performance avait comme immense avantage de répondre à de nombreuses contraintes expérimentales : « Comme pour tout protocole experimental, il s'agit d'isoler des conditions pendant lesquelles la fonction en question (ici le libre arbitre) peut être observée de manière systématique, controlée et réplicable. Ceci est très limitant et en effet demanderait a être étendu a des conditions plus écologiques (de véritables actions du quotidien, ndlr) », explique Bruno Herbelin. Autre bénéfice de l'expérience : « Notre travail est en ligne avec les grands classiques de la recherche sur le potentiel de preparation et le libre arbitre (Kornhuber en 1965 et Libet en 1983) et nous repliquons exactement le meme protocole afin de pouvoir y apporter un element nouveau », selon Herbelin qui précise donc la volonté de compléter de précédentes découvertes en en suivant le même chemin. Et en effet, « le signal EEG observé est lié a un paramètre que les chercheurs n'avaient pas considéré a l'époque: la respiration du sujet ».
Le temps W, preuve de l’illusion du libre arbitre ?
30 ans plus tard, Benjamin Libet découvre le temps W, un moment décrit comme une « envie pressante » d’effectuer un mouvement volontaire, qui survient 200 millisecondes avant l’action elle-même. Ce temps W, manifestation de l’intention consciente de bouger, arrive juste après le RP, le courant électrique qui active les zones du cerveau impliquées dans la motricité volontaire. Ainsi, avant même la prise de décision consciente pour initier une action volontaire, le cerveau est déjà inconsciemment activé. La chronologie d’apparition du RP et du temps W témoigne de l’engagement du cerveau à engendrer une action avant même que l’individu soit conscient d’une envie d’effectuer ce mouvement.
Le potentiel de préparation est dépendant de la respiration
Olaf Blanke, auteur principal de l’étude a fait appel à 52 volontaires auxquels il a demandé de reproduire l’expérience de Kornhuber : appuyer sur un bouton lorsqu’ils le souhaitaient, en espaçant les répétitions d’au moins 8 à 12 secondes. "Nous avons explicitement demandé aux participants de ne pas utiliser de stratégies telles que le comptage de nombres (par exemple les secondes) et d'essayer d'utiliser des intervalles irréguliers pour maximiser la spontanéité de la tâche", peut-on lire dans l’étude. Sans surprise, l’électroencéphalogramme qui relevait l’activité cérébrale révéla l’apparition du RP et du temps W avant chaque initiation de mouvement.
Cependant, une ceinture autour de la poitrine qui mesurait la respiration et l’activité cardiaque apporta une nouvelle corrélation : les participants appuyaient sur le bouton pendant la phase d'expiration de leur respiration. Bien que les participants aient été entièrement libres de choisir le début du mouvement, dans les limites des contraintes expérimentales, leur modèle respiratoire, plus particulièrement la phase d’expiration, était systématiquement couplé au début de leurs mouvements volontaires, sans qu’ils s’en rendent compte.
Ce phénomène est propre aux actions volontaires, n’ayant pas été observé pendant une autre des expériences effectuées qui testait les mouvements involontaires (réponse à des stimuli extérieurs). "Une action volontaire, interne ou générée d’elle-même, est couplée avec un signal intéroceptif, en l'occurrence la respiration. Cela pourrait n’être qu’un exemple parmi d’autres de ce genre, où les actions de libre arbitre sont otages d’états corporels et du traitement des signaux internes par le cerveau. De manière intéressante, on a démontré que de tels signaux sont également important pour la conscience de soi ", résume Olaf Blanke.
Les signaux introspectifs, révélateurs de la volonté d’initier une action
L’expiration suit directement l’émission des signaux RP dans le cerveau, et cette phase de la respiration intervient systématiquement dans la performance d’une action volontaire. Pourrait-on à terme prédire quand quelqu’un va agir volontairement en surveillant ses cycles de respiration ? C’est ce que semblent espérer les scientifiques qui évoquent également dans un communiqué la possibilité d’"exploiter le mouvement du souffle pour prédire les comportements des consommateurs, comme lorsqu’on actionne un bouton". Cette découverte offre également des perspectives thérapeutiques, comme le développement d’outils pour diagnostiquer certaines pathologies du contrôle de l’action volontaire comme le syndrome de Gilles de la Tourette, les troubles obsessionnels compulsifs et la maladie de Parkinson.
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Lire les sons du langage : une aire du cerveau spécialisée dans la reconnaissance des graphèmes |
|
|
| |
|
| |

Lire les sons du langage : une aire du cerveau spécialisée dans la reconnaissance des graphèmes
COMMUNIQUÉ | 08 OCT. 2019 - 10H47 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Une étude conduite par une équipe de Sorbonne Université et du département de neurologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, dirigée par le Pr Laurent Cohen à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Sorbonne Université / CNRS / Inserm) a permis d’analyser les mécanismes de la lecture à l’œuvre chez les adultes. Les chercheurs ont identifié une région cérébrale du cortex visuel qui serait responsable de la reconnaissance des graphèmes, c’est-à-dire des lettres ou groupes de lettres transcrivant un son élémentaire de la langue parlée (phonèmes). Les résultats de cette étude et la métholodogie utilisée ont été publiés dans la revue PNAS.
Hormis les idéogrammes chinois, la quasi-totalité des systèmes de lecture ont pour principe d’écrire les sons composant les mots sous leur forme parlée. Comment fait-on donc en français pour écrire un son, par exemple le son « o » ? La réponse qui vient immédiatement à l’esprit est que ce sont les lettres qui jouent ce rôle. Ce n’est en réalité pas vraiment le cas. Prenons l’exemple du mot « chapeau », formé de quatre sons (ch + a + p + o), mais de sept lettres. En moyenne, les sons ne sont donc pas définis par une lettre, mais par plusieurs. Les linguistes utilisent le terme de graphème pour désigner l’écriture d’un son. Dans le mot « chapeau », il y a quatre sons correspondant à quatre graphèmes qui sont CH, A, P, et EAU. On constate donc que le système alphabétique repose entièrement sur ces graphèmes.
Dans une étude réalisée à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Sorbonne Université / Inserm / CNRS) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, Florence Bouhali, doctorante dans l’équipe « PICNIC – Neuropsychologie et neuroimagerie fonctionnelle », a identifié une petite région du cortex précisément responsable de la reconnaissance des graphèmes et dont le rôle dans la lecture semble a priori essentiel (figure).
Cette région est située au sein d’une vaste étendue de cortex responsable de la reconnaissance des objets en général et qui occupe le dessous de toute la partie arrière du cerveau. Elle abrite de petites zones spécialisées, mobilisées notamment dans la reconnaissance des visages ou des lieux, mais aussi des graphèmes. La région « des graphèmes » se situe dans l’hémisphère gauche, où se trouve en général tout le système du langage. Cela permet, une fois les graphèmes reconnus, d’envoyer l’information rapidement aux régions du langage, qui vont les transformer en sons (figure).
Comment les chercheurs ont-ils procédé ?
Pendant que les participants inclus dans l’étude étaient allongés dans un appareil d’IRM, des mots défilant les uns après les autres sur un écran leur étaient présentés. Ces mots étaient écrits de façon bicolore afin de mettre en valeur le découpage en graphèmes (CHAMPIGNON) ou au contraire, de le perturber (CHAMPIGNON). La région « des graphèmes » identifiée s’activait alors de façon différente selon les frontières de graphèmes définies par les couleurs.
Si l’expérience menée paraît simple, elle était en réalité plus complexe. En effet, l’importance des graphèmes n’est pas la même selon le genre de lecture : ils sont indispensables quand il s’agit de lire à haute voix un mot jamais vu (par exemple CHANDISSON), mais moins importants lorsque les participants devaient juste reconnaître en silence un mot familier (par exemple, CHAPEAU). Les chercheurs ont donc demandé aux participants tantôt de lire à haute voix, tantôt de simplement reconnaître en silence de vrais mots, mais aussi des mots inventés. La région identifiée répondait différemment à la manipulation des graphèmes selon le type de lecture.
En conduisant cette étude, l’équipe du Pr Laurent Cohen s’est penchée sur les mécanismes de la lecture chez des adultes. Or, la spécialisation du cortex visuel pour la reconnaissance des graphèmes n’existe pas à la naissance, et apparaît probablement pendant que les enfants apprennent à lire. Si elle n’a pas encore dévoilé tous ses mystères, la région des graphèmes reste un exemple frappant de la capacité du cerveau à se modifier et à s’adapter.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
structuralisme |
|
|
| |
|
| |

structuralisme
(de structural)
Consulter aussi dans le dictionnaire : structuralisme
Courant de pensée des années 1960, visant à privilégier d'une part la totalité par rapport à l'individu, d'autre part la synchronicité des faits plutôt que leur évolution, et enfin les relations qui unissent ces faits plutôt que les faits eux-mêmes dans leur caractère hétérogène et anecdotique. (Le structuralisme a connu sa forme la plus complète dans l'anthropologie sociale pratiquée par Lévi-Strauss.)
LE STRUCTURALISME COMME MOUVEMENT IDÉOLOGIQUE
Le structuralisme se présente comme une théorie, voire une méthode, plus que comme une philosophie. Il s'adresse à certaines disciplines des sciences humaines et a connu dans les années 1960 un effet de mode. Certaines d'entre ces sciences, sous l'influence du positivisme, tendent à s'émanciper de la philosophie, considérée jusqu'alors comme le tronc commun des sciences humaines. Ainsi, la psychologie, marquée par le béhaviorisme et le gestaltisme, la sociologie, par le fonctionnalisme, la linguistique, qui avait déjà auparavant constitué un domaine à part s'évadent du nid de la philosophie. Ferdinand de Saussure, un théoricien hors pair, donne à la recherche linguistique une méthode d'analyse à la fois systématique et concrète qui inspirera les chercheurs d'autres disciplines.
Le structuralisme français s'est développé principalement en anthropologie : il est surtout tributaire des travaux de Claude Lévi-Strauss (1908-2009), qui d'ailleurs s'est imprégné de ceux des linguistes Sapir, Bloomfield et Jakobson. Le succès de Lévi-Strauss a poussé nombre de chercheurs français à s'intéresser au nouveau mouvement et à flirter avec lui. Ce fut le cas en histoire, à la suite des travaux de Georges Dumézil (1898-1986) – notamment en référence avec la structure en trois éléments des fonctions sociales et religieuses dans la société indo-européenne – et de ceux de Fernand Braudel (1902-1985). L'école marxiste française a été également tentée de se rapprocher du structuralisme, avec Louis Althusser (1918-1990), et Jacques Lacan (1901-1981) l'introduisit en psychanalyse, en référence à sa thèse selon laquelle « l'inconscient est structuré comme un langage ».
Révélateur est le propos du psychologue suisse Jean Piaget (1896-1980), selon lequel « le structuralisme est une méthode, non pas une doctrine » (le Structuralisme, 1968). Piaget rappelle que la structure est faite de trois composantes : 1° la totalité, qui lie chaque élément qui la compose à tous les autres ; 2° la transformation, qui fait que les processus de transformation obéissent à une loi externe (comme l'enfant qui passe du stade sensori-moteur au stade des opérations formelles, chaque stade constituant lui-même cette totalité, de laquelle il sort à l'étape suivante) ; 3° l'autoréglage, qui fait que les permutations dans la structure sont possibles à partir des lois qui la régissent. C'est d'ailleurs en vertu de cette définition que Piaget utilise le terme de groupe pris au sens logico-mathématique.
Michel Foucault (1926-1984) est peut-être le seul qui a fait de ce mouvement un instrument de combat philosophique dans les sciences humaines, avec pour effet de vider l'humain de sa chair, en principe pour mieux le saisir. Dans les Mots et les Choses (1966), il considère la mort de l'homme et l'effacement du sujet comme le point d'aboutissement des sciences humaines ; c'est ce que permet l'optique « structurale », qui considère la structure dans tout fait humain, psychologique, social, etc., comme ayant une réalité, non tangible, certes, mais effective et rendue intelligible par l'organisation logique que suppose la structure. Foucault est à peu près seul à aller aussi loin dans cette voie.
La critique du mouvement en donne une définition restrictive mais qui annonce sa fin ; par exemple Jacques Derrida (1930-2004, dans De la grammatologie et L'Écriture et la différence (1967), reproche à l'école structuraliste de suivre Saussure et de faire par là du « phonocentrisme ». Il l'accuse de privilégier dans la langue sa forme verbale et « sonore » et de mettre au deuxième plan sa forme écrite, en faisant de l'écriture « le signe d'un signe », un signe au deuxième degré. Il avait en effet compris quelles allaient être les limites de l'analyse structurale, notamment en linguistique – Chomsky s'en affranchira, signant la vraie mort du structuralisme.
En dehors de la linguistique et de l'anthropologie, c'est surtout la critique littéraire, avec les travaux de Roland Barthes et de Gérard Genette, qui fera date dans l'histoire du structuralisme, les autres secteurs, comme l'histoire, la marxologie ou la psychologie ne s'y rattachant que le temps d'une mode passagère.
LE STRUCTURALISME DANS LA LITTÉRATURE ET LA CRITIQUE LITTÉRAIRE
On doit à Lévi-Strauss et à Jakobson une étude du poème les Chats de Charles Baudelaire ; cette étude parue en 1962 est le texte fondateur du structuralisme appliqué à la littérature. Le texte littéraire est considéré par la critique structuraliste comme une manifestation de la langue ; on l'étudie à l'aide des structures (réseaux) servant à l'analyse linguistique, qu'elles soient d'ordre grammatical, syntaxique, rhétorique, phonétique ou autre. Le texte est perçu non comme une entité unique et originale, mais comme le point de convergence de tous ces réseaux de signification. Michael Riffaterre (1924-2006) a introduit dans la pensée structuraliste la notion de stylistique, définie comme une étude linguistique des « effets du message », c'est-à-dire comme une prise en compte des effets du texte sur le lecteur (Essais de stylistique structurale, 1971). Pour Riffaterre, le lecteur a un rôle actif : il doit « interpréter » le texte. En effet, il ne s'agit pas seulement pour le lecteur de faire apparaître les différents réseaux qui le constituent, il faut aussi que ce lecteur fasse appel à sa culture et à son expérience pour faire exister le texte. Par là il ne suffit plus de considérer le texte comme un nœud de réseaux que l'on peut analyser : il devient de plus une réalité sensible, incertaine, qui n'est jamais définitive, chaque lecteur ayant de lui une vision différente.
Roland Barthes (1915-1980) a été le chef de file de cette « nouvelle critique » qui allait appliquer aux textes littéraires les méthodes du structuralisme textuel. Après avoir étudié les signes, les symboles et les mythes de la société contemporaine (Mythologies, 1957 ; Système de la mode, 1967), Barthes a appliqué aux textes littéraires les procédés de l'analyse structurelle (Essais critiques, 1965 ; S/Z, 1970, etc.), et en premier lieu aux tragédies de Racine. Dans son ouvrage Figures III (1972), Gérard Genette (né en 1930) a lui aussi appliqué aux œuvres littéraires (particulièrement aux récits) les méthodes d'analyse structurale qu'il emprunte à la linguistique. L'originalité de sa méthode est d'avoir mis l'accent sur l'étude de la temporalité. Il s'est notamment intéressé à la notion de « présent de la narration ». Dans Palimpsestes (1982), il a défini l'intertextualité comme l'ensemble des relations qu'ont entre elles les citations, les références, les allusions plus ou moins explicites qui s'établissent entre les textes littéraires. Le critique littéraire a pour mission d'étudier cette intertextualité. Pour Genette, en effet, le texte littéraire est un « palimpseste », c'est-à-dire un manuscrit dont on a effacé le premier texte pour réécrire par-dessus : de la même manière, il faut regarder le texte littéraire comme créé d'une part à partir des événements vécus par l'auteur, mais bien davantage encore à partir de ses lectures. Le dernier structuraliste littéraire est sans doute le sémioticien Algirdas Lucien Greimas (1917-1992), auteur d'une Sémantique structurale (1966).
LE STRUCTURALISME EN LINGUISTIQUE
INTRODUCTION
Un certain nombre de recherches convergentes ont marqué l'histoire de la linguistique dans le début du xxe s. et on a pu les considérer comme annonçant le grand mouvement du structuralisme.
LA DOCTRINE STRUCTURALISTE EN LINGUISTIQUE
Dans les années 1920, la linguistique se définit comme un domaine de recherche particulier à l'intérieur du mouvement positiviste et scientifique des sciences humaines (en allemand Geistwissenschaften). La linguistique est alors sous l'influence de deux hommes : Ferdinand de Saussure (1857-1913), dont le Cours de linguistique générale (1916) vient de dégager la notion de langue, par différence avec le langage, et qui oppose langue et parole ; et Edward Sapir (1884-1939), qui a posé pour la typologie des langues des critères formels et non plus historiques, et qui, dans cette perspective, oppose le pattern (« structure ») et la réalité parlée. Saussure avait proposé dès les années 1900 une hypothèse générale sur la nature et le fonctionnement du langage ; Sapir, indépendamment de Saussure, avait établi plusieurs distinctions qui annoncent le structuralisme, comme celle entre phonologie et phonétique, synchronie et diachronie.
Le principe fondamental du structuralisme peut être énoncé comme un principe d'immanence, en fonction duquel un énoncé réalisé ne peut être analysé qu'à partir de ses propriétés internes. Cela implique qu'on ne peut recourir à des analyses externes, historiques par exemple. L'étymologie en particulier ne sert à rien dans un énoncé du genre « le garçon mange la soupe à huit heures » : peu importe que « mange » vient d'un mot latin du genre manducat, que « soupe » vienne du francique suppa, qui est de la famille du gothique supon, « assaisonner », etc. Ce qui compte, c'est l'étude synchronique, « qui s'occupera des rapports logiques et psychologiques reliant les termes coexistants et formant système, tels qu'ils sont aperçus par la même conscience collective », et l'étude diachronique, « qui étudiera au contraire les rapports reliant les termes successifs non aperçus par une même conscience collective et qui se substituent les uns aux autres sans former système entre eux ». Cela a pour conséquence de remettre l'analyse linguistique au plan de l'énoncé même, et de refuser d'en sortir.
Ce même principe impose de plus d'établir une coupure radicale entre l'énoncé produit et les différents participants de la communication linguistique. Seul compte l'énoncé réalisé ; les motivations psychologiques de l'émetteur, les composants situationnels dans lesquels il est produit doivent être éliminés dans l'analyse. Pour décrire une langue, il faut partir d'un corpus constitué d'énoncés produits par un « locuteur natif » de la langue en question. Ces énoncés doivent être homogènes, provenir d'un locuteur représentatif de sa communauté linguistique.
La distinction entre langue et parole fait de la langue l'ensemble du corpus tel qu'il vient d'être défini et de la parole une réalisation particulière à partir de la langue. La langue est donc un ensemble clos, sur lequel on peut appliquer plusieurs procédures d'analyse pour dégager les unités de langue et les règles de combinaison entre ces unités.
Des oppositions importantes ont été dégagées par Saussure ; il pose en effet que la langue est un fait social, tandis que la parole est un fait individuel, et que la langue est un fait de mémoire, alors que la parole est un fait de création. Chomsky reprendra cette distinction en la généralisant sous la forme de la distinction compétence et performance.
Le fonctionnement de la langue suppose un principe essentiel au structuralisme, à savoir la nécessaire existence d'un ensemble de règles régissant les rapports entre ces unités. L'apport décisif du structuralisme est d'avoir redéfini la notion de valeur. La valeur de l'unité linguistique n'est ni réductible à son aspect de signifié (c'est-à-dire à son contenu de signification), ni à son aspect de signifiant (c'est-à-dire à sa forme acoustique, ou graphique). La valeur est liée au rapport entre le signifiant et le signifié, rapport qui constitue un élément original dans tout système linguistique. Cela oblige à définir chaque unité linguistique par opposition aux autres unités linguistiques, et met la négativité au cœur de leur nature ; comme le dit Saussure : « Leur plus exacte caractéristique est d'être ce que les autres ne sont pas. »
On définit les unités d'un système linguistique en opposition les unes avec les autres. Dans l'exemple déjà cité (« le garçon mange la soupe à huit heures »), l'important est qu'à le garçon puisse être substitué un autre item de la même classe que lui, du genre « la fille », « l'homme » ; à mange la soupe, un autre groupe de mots du genre « boit du lait » ; à soupe, un autre mot du genre « une pomme ». L'analyse structurale définit donc des unités substituables. Cet exemple permet de constater que deux opérations ont été mises en œuvre : la segmentation et la substitution. L'analyse structurale vise à délimiter les unités au travers de leurs relations. Les relations qui unissent les unités sont de deux types : les unes définissent les rapports existant entre chaque élément de l'énoncé (par exemple le garçon mange), les autres définissent les éléments en fonction de leur place dans l'énoncé, c'est-à-dire la classe des éléments susceptibles d'apparaître à chaque place de l'énoncé au complet (par exemple soupe, pomme, ou encore mange, dévore). Les relations du premier type sont dites syntagmatiques, les secondes, du type paradigmatique. Cette optique conduit à faire de la description linguistique un ensemble de procédures organisé en niveaux, qui, chacun, permettent de classer les éléments en unités spécifiques distinctes. Ainsi, un phonème se définit au niveau phonologique, le morphème au niveau morphologique. Chaque unité peut se substituer avec des unités de même niveau et chaque unité s'intègre dans une unité de niveau supérieur, dont elle est un constituant. Par exemple, les phonèmes /p/ et /r/ dans un contexte qui serait du genre /-a/ ou /-i/ : on a ainsi les unités phonétiques /pa/ et /ra/ ; en même temps /p/ et /r/ sont constitutifs des morphèmes /pas/ et /rat/ ou encore /pi/ et /riz/.
Le linguiste français Émile Benveniste (1902-1976), qui se rattache au courant structuraliste, définit quatre niveaux d'analyse : le niveau des traits distinctifs, le niveau phonologique, le niveau morphologique et le niveau phrastique. Pour bien situer ce modèle d'analyse, il faut reprendre la définition fondamentale du constituant immédiat telle que l'a formulée le linguiste américain Leonard Bloomfield (1887-1949). L'analyse en constituants immédiats est une méthode de décomposition des phrases qui consiste à isoler les segments qui « constituent immédiatement » chaque phrase, la phrase étant l'élément le plus vaste considéré (on pourrait en prendre de plus vastes : le paragraphe, le discours ou encore le chapitre, le livre, etc.). Puis on définit les segments qui constituent immédiatement ceux qui viennent d'être dégagés, et ainsi de suite jusqu'aux morphèmes et aux phonèmes. On obtient de la sorte une structure hiérarchisée dans laquelle chaque niveau s'intègre au niveau supérieur. Dans l'analyse de Benveniste, on remarque que, entre deux niveaux, par exemple du trait distinctif au morphème, les constituants de l'unité sont constituants de l'unité supérieure : le phonème est un constituant immédiat du morphème. En revanche, les morphèmes sont bien des constituants de la phrase, mais ils n'en sont pas les constituants immédiats. Il y a donc des éléments intermédiaires entre le niveau morphologique et le niveau phrastique.
LES ÉCOLES STRUCTURALISTES DE LINGUISTIQUE
La plus importante, celle qui initie le mouvement, est le cercle de Prague, fondé en 1926 à l'initiative de Vilém Mathesius et dominé par deux linguistes russes, Nicolaï Sergueïevitch Troubetskoï (1890-1938) et Roman Jakobson (1896-1982), qui passera aux États-Unis en 1941 et deviendra américain. Le premier se spécialise et fonde la phonologie. Le second cherche à intégrer les thèses du cercle de Prague dans un ensemble cohérent impliquant les modalités de fonctionnement du langage.
Une autre école est celle du cercle de Copenhague, autour duquel naviguent des linguistes comme Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965) et Viggo Brøndal (1887-1942). Hjelmslev est le premier structuraliste qui pose le problème d'une sémantique générale en postulant un isomorphisme entre le plan du signifiant et le plan du signifié.
Enfin l'école américaine est florissante. On peut y distinguer les noms d'Edward Sapir, de Leonard Bloomfield et de Zellig Sabbetai Harris (1909-1992).
Le structuralisme en linguistique s'est trouvé dépassé dans les années 1960 par la naissance du générativisme.
LE STRUCTURALISME EN ANTHROPOLOGIE
INTRODUCTION
Le mouvement s'est lui aussi distingué dès sa naissance par une critique de la méthode historicisante des écoles anthropologiques antérieures, le diffusionnisme et l'évolutionnisme. Il a donné naissance à deux mouvements distincts, le structuro-fonctionnalisme anglo-saxon et le structuralisme de Lévi-Strauss.
LE STRUCTURALISME ANGLO-SAXON EN ANTHROPOLOGIE ET EN SOCIOLOGIE
Deux anthropologues dominent le structuralisme anglo-saxon : Bronisław Malinowski (1884-1942) et Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955). Avec eux, l'anthropologie quitte les bibliothèques et se lance sur le terrain, va voir les sociétés « archaïques » contemporaines, qui vivent à l'écart de la « civilisation », et essaie, à partir de cette observation, de dégager leurs principes d'organisation et de fonctionnement, et non plus de reconstituer de manière hypothétique leur passé. La méthode est dite structuraliste dans la mesure où elle suppose que chaque société constitue un système, un ensemble d'éléments interdépendants, comme la parenté, la culture, la religion, l'économie, la technique, qui n'acquièrent de sens qu'en fonction les uns des autres. L'anthropologie se fixe pour tâche de découvrir les relations qui existent entre eux. En fait, il faut également qualifier cette approche de fonctionnaliste, car elle vise à définir également la fonction que remplit chaque élément dans l'ensemble social où il se trouve. On a pu rattacher cette optique à la doctrine organiciste des sciences naturelles : en effet, elle aboutit à expliquer les institutions sociales par les fonctions qu'elles remplissent, et les fonctions par les besoins naturels qu'elles satisfont, aussi bien individuels que collectifs.
Pour Radcliffe-Brown, les structures concrètes constituent la matière première de l'observation anthropologique, l'ordre immédiatement observable, et les structures générales, « abstraites », qui les organisent, constituent des modèles qui permettent de les comprendre. Il y a donc une communauté de nature entre les deux types de structures pour Radcliffe-Brown, les unes et les autres s'étayant réciproquement. Cette approche n'est pas recevable par Lévi-Strauss, et c'est sur ce point, comme on le verra, que sa conception va diverger avec l'école anglo-saxonne.
Les Américains vont s'attacher à définir avec plus de précision que leurs confrères britanniques les problèmes méthodologiques, et axer la recherche sur un domaine plus généralisable que celui fourni par les seules données ethnographiques, la sociologie. C'est ce que tente le sociologue Talcott Parsons (1902-1979). Il définit la structure comme une disposition stable échappant aux fluctuations de son environnement, en opposition avec la fonction, qui est l'effort continuel de l'adaptation de la structure aux changements. Structure et fonction sont donc étroitement liées dans le système social : elles permettent de comprendre son organisation et sa dynamique. Mais tout cela n'est aux yeux de Parsons qu'un système conceptuel destiné à fournir un cadre à l'action. L'élément basique à partir duquel toute société est construite n'est pas l'individu, mais l'action. Toute action implique des corrélats à partir desquels elle se construit ; ces corrélats sont des normes, des symboles ou encore des valeurs. Les corrélats de l'action sont construits à partir des conditions structurelles antinomiques, au nombre de cinq, en face desquelles se trouve tout acteur. Ce sont : 1° affectivité/neutralité affective ; 2° altruisme/égocentrisme ; 3° universalisme/particularisme ; 4° qualité/accomplissement ; 5° spécificité/diffusion. Ce modèle permet d'expliquer les actions et les rôles des individus. Par exemple, l'interaction entre l'agent de police et l'individu est neutre, altruiste, universaliste (commandée par des principes généraux), orientée vers l'accomplissement, et spécifique (limitée à une situation particulière). On peut imaginer toutes sortes d'autres combinaisons des alternatives fondamentales. Ainsi les exigences fonctionnelles auxquelles répond l'action s'accomplissent dans la réalisation de l'objectif, l'adaptation, le maintien des modèles de valeur, et l'intégration. Parsons relie ainsi le schéma fonctionnel et le schéma structurel, ce qui lui permet d'expliquer toutes les formes possibles de l'action sociale.
On a critiqué le structuro-fonctionnalisme de Parsons, en lui reprochant son caractère à la fois trop rigide, trop général et trop particulier, excluant nombre de situations sociales de ses capacités d'explication, et donc son caractère trop limité pour constituer un modèle, d'autant que sa démarche s'accompagne d'un formalisme rudimentaire.
LE STRUCTURALISME ANTHROPOLOGIQUE DE LÉVI-STRAUSS
Lévi-Strauss a découvert le structuralisme avec les linguistes américains, notamment Jakobson. Il a cherché à en faire une méthode aussi rigoureuse que celle qui est à l'œuvre dans les sciences exactes. Il l'a notamment opposé au fonctionnalisme, dont les relents de finalisme lui paraissaient suspects. L'explication structurale est autosuffisante : il s'agit de partir des phénomènes pour remonter à leur structure cachée, par l'intermédiaire de modèles.
La structure est définie par Lévi-Strauss comme un ensemble de rapports invariants (corrélatifs ou antithétiques) qui expriment l'organisation du système. Selon ses termes, « la notion de structure sociale ne se rapporte pas à la réalité empirique, mais aux modèles construits d'après celle-ci ». Elle n'est donc pas observable directement, mais elle constitue le réel rendu intelligible sous forme logique, le modèle. Le modèle est un système symbolique qui permet d'accéder à la structure. Certains modèles appartiennent à une catégorie strictement logique, comme ceux que Lévi-Strauss utilise dans les Structures élémentaires de la parenté (1949) ; d'autres sont constitués de simples propositions ayant entre elles des rapports d'opposition, de corrélation, ou de génération. Ce sont ceux qu'on va retrouver dans sa série Mythologiques (1964-1971). Il existe des modèles conscients et des modèles construits, supposés inconscients : les premiers sont ceux que met en œuvre le système social de chaque peuple, les seconds sont ceux que (re)construit ou retrouve le chercheur qui étudie le peuple. Le structuralisme lévi-straussien repose sur quelques principes simples : 1° le principe d'immanence, qui fait que tout objet d'étude doit être regardé comme un système clos, dans son état actuel ; 2° la primauté du tout sur les parties ; les éléments de chaque ensemble n'ont pas de signification pris isolément, mais ne se conçoivent que dans leurs rapports réciproques ; 3° la primauté des rapports entre les éléments sur les éléments eux-mêmes. Par exemple, les mythes amérindiens mentionnent un arbre comme le prunier ou le pommier. Or ils ne sont pas substituables en tant qu'arbres, l'arbre n'a rien d'un support symbolique ; l'analyse montre que c'est la fécondité du prunier qui intéresse l'Indien, tandis que dans le pommier c'est la puissance et la profondeur des racines. L'univers du mythe, du conte, est analysable en paires d'oppositions, chaque élément est un « faisceau d'éléments différentiels » ; 4° la logique binaire est au point de départ de l'analyse mythologique ; mais elle inclut la complémentarité, la supplémentarité, la symétrie, et surtout la transformation.
Le structuralisme a atteint avec Lévi-Strauss un sommet de perfection qu'il ne dépassera pas ; son analyse des mythes amérindiens demeure un modèle du genre. Mais en même temps, il a signé l'arrêt de mort de ce grand mouvement : face aux sociétés figées, l'analyse structurale a montré son efficacité, mais elle paraît tout à fait insuffisante à l'égard des sociétés complexes, telles que celle dans laquelle nous vivons.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LOGIQUE |
|
|
| |
|
| |
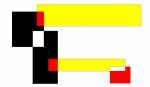
logique
(bas latin logica, du grec logikê)
Consulter aussi dans le dictionnaire : logique
Science du raisonnement en lui-même, abstraction faite de la matière à laquelle il s'applique et de tout processus psychologique.
Comparée à d'autres branches du savoir, la logique présente cette originalité qu'après avoir paru achevée, ou peu s'en faut, durant près de deux mille ans et s'être tenue, dans le cadre défini par Aristote, en position d'auxiliaire d'autres disciplines en charge de l'investigation active du réel, elle a connu, au xixe s., un nouvel et prodigieux essor qui en a fait une science à part entière. Avec une technicité accrue et un domaine dont les limites ne sauraient d'ailleurs être assignées sans discussion, elle occupe désormais, entre mathématiques et réflexion sur le langage, une place stratégique dans le réseau complexe de la pensée moderne.
Les fondations aristotéliciennes
Après Aristote, qui est le premier à dégager et à présenter rigoureusement les principes et procédures logiques, avec notamment la formalisation du syllogisme, l'école de Mégare et les stoïciens perfectionnent les méthodes d'inférence et posent le problème de la sémantique.
La scolastique médiévale affine et perfectionne la logique aristotélicienne, qui, mise à part l'importance des travaux menés par les logiciens de Port-Royal et par Leibniz, fait encore autorité, d'un point de vue formel, aux yeux de Kant – celui-ci ne concevant pas qu'elle soit susceptible d'évolution.
La logique scientifique
C'est après les travaux de B. Bolzano, de G. Boole et de G. Frege, en particulier, que la logique se sépare de la philosophie. Inventée par Boole et Augustus De Morgan (1806-1871), la logique binaire se développe. Frege est le vrai fondateur de la logique formelle.
Le problème du fondement des mathématiques est au centre des travaux de R. Dedekind, de G. Peano, de D. Hilbert, de B. Russell ; ce dernier tente, ainsi que G. Cantor et E. Zermelo, de résoudre les antinomies de la théorie des ensembles. Enfin, L. Wittgenstein, R. Carnap, A. Church, L. Lukasiewicz, K. Gödel, W. Quine et A. Tarski représentent, au xixe s., les principaux courants de la logique mathématique.
Les problèmes théoriques
La logique est formelle, ce qui signifie que les syllogismes classiques et les théorèmes de la logique moderne ne comportent pas de terme concret mais des symboles. Par exemple, un syllogisme sera imprimé par une loi logique du genre si tout A est B et si tout B est C, alors tout A est C.
La logique comme science de l'inférence correcte n'est pas tributaire de la manière propre dont un individu raisonne, de sa « psychologie ». Elle ne saurait non plus dépendre – Husserl l'a montré – d'une science expérimentale. Enfin, selon Carnap, les lois logiques, qui ne disent rien sur le monde, expriment les conventions qui règlent notre langage.
Les types de logique
La logique classique, binaire ou bivalente
On appelle « binaire » une logique qui n'admet que deux valeurs de vérité : ou une proposition est vraie ou elle est fausse.
Les logiques plurivalentes et les logiques modales
La logique binaire exclut le possible, l'éventuel, etc. On a donc construit d'autres logiques, qui font place au vrai, au faux et au possible. Puis les découvertes de la mécanique quantique (relations d'incertitude de W. Heisenberg) ont remis en question le principe de contradiction, fondement de la logique binaire.
La logique floue
Elle est née à la suite de la critique de la logique binaire et à partir de la théorie des sous-ensembles flous.
Ainsi, l'existence de la pluralité des logiques possibles relie les fondements de chacune à son objet.
Les trois axiomes de la logique classique
Le principe d'identité
Une variable ne peut pas à la fois être et ne pas être. On ne peut avoir à la fois A et non-A.
Le principe de contradiction ou de non-contradiction
Une variable ou une proposition ne peut pas être et ne pas être vraie. Ou elle est vraie ou elle est fausse.
Le principe du tiers exclu
De deux propositions contradictoires, si l'une est vraie l'autre est fausse, et vice versa.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
