|
| |
|
|
 |
|
Nouvelle découverte sur la stabilisation de nos souvenirs pendant le sommeil 17 Oct 2019 | Par Inserm |
|
|
| |
|
| |

Nouvelle découverte sur la stabilisation de nos souvenirs pendant le sommeil
17 Oct 2019 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Photo by Kinga Cichewicz on Unsplash
Des scientifiques du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CNRS/Collège de France/Inserm)1 ont démontré que les ondes delta émises pendant notre sommeil ne sont pas des périodes de silence généralisé durant lesquelles le cortex se repose, comme cela est décrit depuis des décennies dans la littérature scientifique. Au contraire, elles permettent d’isoler des assemblées de neurones jouant un rôle essentiel lors de la formation des souvenirs à long terme. Ces résultats sont publiés le 18 octobre 2019 dans la revue Science.
Pendant le sommeil, l’hippocampe se réactive spontanément en générant une activité semblable à celle de l’éveil. Il transmet alors des informations au cortex qui réagit en conséquence. Cet échange est souvent suivi par une période de silence appelée « onde delta » puis d’une activité rythmique appelée « fuseau de sommeil ». C’est à ce moment que les circuits corticaux se réorganisent pour former des souvenirs stables. Cependant, le rôle des ondes delta dans la formation de nouveaux souvenirs reste une énigme : pourquoi une période de silence vient-elle interrompre l’enchaînement entre les échanges d’information hippocampo-corticaux et la réorganisation fonctionnelle du cortex ?
La chercheuse et le chercheur co-auteurs de cet article ont regardé de plus près ce qui se passe au cours des ondes delta elles-mêmes. Ils ont découvert, avec surprise, que le cortex n’est pas tout à fait silencieux mais que quelques neurones restent actifs et s’organisent en assemblées, c’est-à-dire en de petits ensembles coactifs codant des informations. Cette observation inattendue suggère que les quelques neurones qui s’activent alors que tous les autres se taisent peuvent ainsi effectuer des calculs importants à l’abri de possibles perturbations. Et les découvertes de cette étude vont encore plus loin ! En effet, les réactivations spontanées de l’hippocampe déterminent quels neurones corticaux restent actifs pendant les ondes delta et révèlent ainsi la transmission d’informations entre les deux structures cérébrales. En outre, les assemblées activées pendant les ondes delta sont constituées de neurones qui ont été fortement sollicités lors de l’apprentissage d’une tâche de mémoire spatiale au cours de la journée. Tous ces éléments suggèrent que ces processus sont impliqués dans la consolidation de la mémoire. Pour le démontrer, les scientifiques ont provoqué, chez les rats, des ondes delta artificielles afin d’isoler soit des neurones associés aux réactivations de l’hippocampe, soit des neurones au hasard.
Résultat : lorsque les bons neurones sont isolés, les rats parviennent à stabiliser leurs souvenirs et réussissent le test spatial le lendemain.
Ces résultats engendrent ainsi une profonde révision de notre compréhension du cortex. Les ondes delta seraient un moyen d’isoler sélectivement des assemblées de neurones choisies, qui transmettent une information cruciale entre les périodes de dialogue hippocampo-cortical et de réorganisation des circuits corticaux, pour former des souvenirs à long terme.
1 Membre associé de l’Université PSL, le Collège de France mène depuis 2009 une politique volontariste d’accueil d’équipes indépendantes qui bénéficient de services techniques et scientifiques mutualisés et d’un environnement multidisciplinaire exceptionnel. Vingt-deux équipes sont actuellement hébergées au sein du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie ainsi que dans les instituts de chimie et de physique du Collège de France. Soutenu notamment par le CNRS, ce dispositif est ouvert aux chercheurs français et étrangers. Il contribue à consolider l’attractivité de Paris dans la géographie mondiale de la recherche.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Un contrôle de neurorécepteur par la lumière pour atténuer les symptômes de la douleur chronique |
|
|
| |
|
| |

Un contrôle de neurorécepteur par la lumière pour atténuer les symptômes de la douleur chronique
20 décembre 2016 BIOLOGIE SANTÉ
La douleur nous sert de précieux signal d'alarme, mais elle se transforme en véritable maladie lorsqu'elle devient chronique. Une équipe internationale, comprenant des chercheurs du CNRS et de l'Inserm1, a identifié et contrôlé un des centres associés aux douleurs chroniques. Ces travaux, publiés le 20 décembre 2016 dans Molecular Psychiatry, ont permis d'en soulager les symptômes chez des souris et de montrer la capacité du cerveau d'y remédier.
Alors qu'environ 20% de la population européenne a connu des épisodes de douleur chronique, les traitements sont efficaces chez moins de la moitié des patients. Cette maladie est pourtant associée à des modifications du système nerveux. Les chercheurs souhaitent donc comprendre comment le cerveau module la douleur physique et les désordres affectifs et cognitifs qui l'accompagnent : anxiété, perte des émotions positives, hypersensibilité à la douleur… Dans cette étude, ils se sont penchés sur l'amygdale, une région du cerveau impliquée dans la gestion de la douleur et des émotions, et sur le récepteur du glutamate de type 4 (mGlu4). Il s'agit du principal transmetteur des signaux de douleur dans le système nerveux des mammifères. Ce neurorécepteur détecte la présence du glutamate et diminue, selon les besoins, sa libération au niveau de la synapse.
Afin d'étudier ces récepteurs, les chercheurs utilisent en général un ligand capable de les activer ou de les inhiber. Ils ont innové en créant un ligand particulier photo-contrôlable, l'optogluram, dont l'action sur mGlu4 est pilotée par la lumière. L'utilisation de fibres optiques leur permet alors de contrôler très précisément l'activation du neurorécepteur dans une zone donnée du cerveau. Les scientifiques se sont penchés sur des souris conscientes et libres de leurs mouvements, atteintes de douleurs inflammatoires chroniques. En activant l'optogluram par la lumière, ils ont pu inhiber de manière rapide et réversible ces symptômes douloureux, démontrant ainsi que le cerveau de ces souris conservait sa capacité à contrer ces effets. Avec l'identification d'un modulateur capable d'agir sur la douleur chronique, ces travaux sont porteurs d'espoirs thérapeutiques.
Vue des synapses dans l'amygdale d'une souris, obtenue par microscopie confocale. En rouge les récepteurs mGlu4 et en vert ceux de mGlu1a. La barre blanche en bas à droite correspond à 5 μm.
1
Bibliographie
Dynamic modulation of inflammatory pain-related affective and sensory symptoms by optical control of amygdala metabotropic glutamate receptor 4.
Charleine Zussy, Xavier Gómez-Santacana, Xavier Rovira, Dimitri De Bundel, Sara Ferrazzo, Daniel Bosch, Douglas Asede, Fanny Malhaire, Francine Acher, Jesús Giraldo, Emmanuel Valjent, Ingrid Ehrlich, Francesco Ferraguti, Jean-Philippe Pin, Amadeu Llebaria & Cyril Goudet
Publié le 20/12/2016 dans Molecular Psychiatry.
Contact
Cyril Goudet
CNRS Scientist
+33 (0)4 34 35 92 77
cyril.goudet@igf.cnrs.fr
Martin Koppe
CNRS Press Office
+33 1 44 96 51 51
presse@cnrs.fr
DOCUMENT CNRS LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
La consommation d'iode |
|
|
| |
|
| |
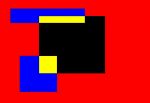
La consommation d'iode
Dans quels produits alimentaires peut-on trouver de l'iode et quels sont les besoins journaliers ? Les français consomment-ils suffisamment d'iode ? Comment se manifeste une carence en iode ? Quelles sont les conséquences d'une carence ou d'une surconsommation d'iode pour l'organisme ? Le point sur ces questions.
Publié le 3 octobre 2012
"Dans quels produits alimentaires peut-on trouver de l'iode et quels sont les besoins journaliers ?"
La plupart des aliments (viandes, légumes et fruits) sont pauvres en iode à l'exception des poissons et crustacés marins, consommés crus ou grillés. De plus le mode de cuisson et de conservation peut réduire la concentration en iode du produit consommé.
Dans les pays industrialisés, la principale source alimentaire est le lait, du fait de l'enrichissement des fourrages en iode, de l'utilisation de produits iodés antiseptiques dans la chaîne de traitement pour éviter les développements bactériens et de l'emploi de médicaments vétérinaires contenant de l'iode.
En 1952, dans le but de prévenir la déficience en iode, les pouvoirs publics français responsables de la santé ont opté pour l'utilisation de sel enrichi en iode. Le taux d'enrichissement est réglementé à 10-15 milligrammes (mg) d'iodure de sodium par kilo de sel ; il concerne exclusivement le sel à usage domestique, jusqu'à présent aucun apport d'iode n'était effectué au sel destiné aux collectivités ou à l'industrie agro-alimentaire. De plus le sel iodé ne représente que la moitié du sel domestique utilisé.
Le lait est notre principale source
alimentaire en iode. © DR
La carte des déficiences en
iode région par région
Une étude conduite en France (1999) révèle la persistance d’une légère déficience dans l’apport d’iode chez les adultes. L’apport quotidien en iode est évalué par la mesure de l’élimination urinaire, appelée iodurie. Un gradient est-ouest fait état d’ioduries plus faibles à l’est qu’à l’ouest. La valeur normale se situant à 10 µg/100 mL ; les variations mesurées sont comprises entre 6,7 et 8,6 µg/100 mL chez la femme, entre 7,4 et 9,6 µg/100 mL chez l’homme. © DR
L'apport journalier recommandé chez l'adulte se situe aux environs de 150 microgrammes (µg) par jour, les besoins sont accrus chez la femme enceinte, au cours de l'adolescence et pendant la période d'allaitement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise de respecter certaines valeurs (tableau).
Apports en iode stable recommandés par l'OMS
Age/statut physiologique particulier Apport quotidien (µg / jour)
0 à 12 mois 50
1 à 6 ans 90
7 à 12 ans 120
à partir de 12 ans 150
Grossesse 200
Allaitement 200
"Les Français consomment-ils suffisamment d'iode ?"
Une étude conduite en France (1999) révèle la persistance d'une légère déficience dans l'apport d'iode chez les adultes. L'apport quotidien en iode est évalué par la mesure de l'élimination urinaire, appelée iodurie. Un axe est-ouest fait état d'ioduries plus faibles à l'est qu'à l'ouest.
La valeur normale se situant à 10 µg/100 mL ; les variations mesurées sont comprises entre 6,7 et 8,6 µg/100 mL chez la femme, entre 7,4 et 9,6 µg/100 mL chez l'homme. L'origine de ces variations n'est pas complètement connue, mais les contributions du sol de la région et du contenu de l'eau en iode pourraient jouer un rôle, ainsi que des variations dans les habitudes alimentaires.
"Comment se manifeste une carence en iode ?"
En bref
Les nodules sont plus fréquents chez les femmes et leur fréquence augmente avec l'âge.
La carence chronique en iode se traduit par une augmentation de volume de la thyroïde, formant alors un goitre. L'apparition d'un goitre, parfois volumineux et visible extérieurement, ou de nodules, est un signe clinique des troubles dus à une déficience iodée. La taille de la thyroïde et la présence de nodules peuvent être analysées par la palpation du corps thyroïde et, depuis une vingtaine d'années, par l'échographie qui détecte aussi des nodules trop petits pour être repérés par l'examen clinique.
Qu'il y ait ou non déficit en iode, les nodules sont plus fréquents chez les femmes et leur fréquence augmente avec l'âge. Ainsi, on constate que plus d'une femme sur quatre a un ou plusieurs nodules thyroïdiens après 40 ans, plus de 90 % de ses nodules thyroïdiens étant bénins. La plupart des hypertrophies thyroïdiennes n'entraînent pas de symptôme. Elles peuvent, dans de rares cas, par compression des structures du cou, provoquer des difficultés à avaler ou respirer ou des changements dans la voix.
"Quelles sont les conséquences d'une carence ou d'une surconsommation d'iode pour l'organisme ?"
A savoir
Il n'existe pas à l'état naturel de surcharge en iode mais, au contraire, des carences, notamment dans de nombreuses régions du monde où l'apport naturel en iode est trop faible comme au Népal.
Tout d'abord, il n'existe pas à l'état naturel de surcharge en iode (toutefois des apports élevés peuvent exister au Japon) mais, au contraire, des carences, notamment dans de nombreuses régions du monde où l'apport naturel en iode est trop faible (ex. Népal, Amérique du Sud, Haut Atlas, …).
Les carences chroniques en iode sont responsables de troubles du métabolisme. Ces troubles sont d'autant plus marqués que la carence est importante et qu'il s'agit d'un sujet jeune. Le fœtus, le nouveau-né et l'enfant sont donc tout particulièrement sensibles aux carences en iode. Ainsi un abaissement du taux d'hormones thyroïdiennes chez la mère peut provoquer chez le fœtus des anomalies du développement physique et intellectuel, (retard mental, diminution du poids de naissance) et augmenter les risques de mortalité périnatale. C'est l'historique "crétinisme des Alpes", souvent observé par le passé, et attribué à une carence en iode dans l'alimentation.
Chez l'adulte, le déficit profond en iode peut également se traduire par un ralentissement intellectuel qui lui est réversible.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Une nouvelle étude éclaircit le lien entre les symptômes de TDAH pendant lâenfance et plusieurs comorbidités médicales non psychiatriques |
|
|
| |
|
| |

Une nouvelle étude éclaircit le lien entre les symptômes de TDAH pendant l’enfance et plusieurs comorbidités médicales non psychiatriques
13 Déc 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Santé publique
Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) touche de nombreux enfants et s’accompagne souvent de comorbidités, dont des troubles métaboliques, de l’asthme ou encore des caries dentaires. Cependant, des incertitudes demeurent concernant la chronologie de l’apparition de ces troubles, notamment pour savoir à quelles comorbidités le TDAH est associé au cours du temps et inversement, quelles conditions médicales augmentent le risque de développer des symptômes de TDAH. Des scientifiques de l’Inserm et de l’université de Bordeaux au sein du Centre de recherche sur la santé des populations, en collaboration avec des équipes au Royaume-Uni, en Suède et au Canada, ont mené l’analyse la plus complète jusqu’ici en évaluant les liens temporels entre les symptômes du TDAH et un large éventail de conditions médicales. Leurs résultats, publiés dans la revue Lancet Child and adolescent health, soulignent l’importance d’une prise en charge multidisciplinaire des patients TDAH, fondée sur une collaboration renforcée entre professionnels de santé physique et mentale.
Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble du neurodéveloppement qui débute dans l’enfance et se caractérise par des niveaux élevés d’inattention, et/ou d’agitation et d’impulsivité. Au-delà des difficultés qu’il engendre à l’école ainsi que dans la vie professionnelle et sociale, des travaux ont mis en évidence que le TDAH est associé à plusieurs comorbidités médicales (troubles métaboliques, asthme, obésité, addictions…) et à un risque accru de blessures accidentelles.
Néanmoins, les études publiées jusqu’ici pour y voir plus clair entre ces associations présentaient des limites méthodologiques. Réalisées sur des petits échantillons de patients, sans suivi de leur état de santé sur le long terme, elles ne permettaient pas de déterminer la direction des associations observées et la temporalité selon laquelle elles se mettaient en place. En outre, des facteurs de confusion comme les inégalités sociales de santé ou la prise de traitements médicamenteux étaient souvent insuffisamment pris en compte.
Il était donc difficile pour les scientifiques de répondre à un certain nombre de questions : les comorbidités apparaissent-elles avant ou après le développement du TDAH ? Sont-elles directement liées à ce trouble ou bien causées par d’autres facteurs ? Le TDAH peut-il être favorisé par des conditions médicales antérieures ? Comprendre les séquences temporelles de ces différentes associations est pourtant essentiel pour élaborer des stratégies de prise en charge et de prévention appropriées pour les patients.
L’équipe de Cédric Galera, chercheur au Centre de recherche sur la santé des populations de Bordeaux (Inserm/Université de Bordeaux) et pédopsychiatre, en collaboration avec des équipes britanniques, suédoises et canadiennes, a donc décidé d’analyser les données de plus de 2 000 enfants participant à une grande cohorte, l’Étude longitudinale du développement de l’enfant du Québec, menée au Canada. Les enfants ont été suivis de l’âge de 5 mois à 17 ans. Ils ont été vus à de multiples reprises, dans leur petite enfance (entre 5 mois et 5 ans), dans l’enfance (entre 6 et 12 ans) et à l’adolescence (entre 13 et 17 ans).
TDAH et autres troubles
À ces occasions, les enfants ont été évalués sur la gravité des éventuels symptômes de TDAH qu’ils présentaient ainsi que sur leur état physique (état de santé général, maladies éventuelles…). Ces données étaient rapportées aux chercheurs par la personne connaissant le mieux l’enfant dans la petite enfance, par les enseignants au milieu de l’enfance et par l’enfant lui-même à l’’adolescence.
S’appuyant sur ces données et en tenant compte de multiples facteurs de confusion, les scientifiques ont réalisé des analyses statistiques pour mesurer les associations entre le fait de présenter des symptômes de TDAH et celui de développer certains troubles physiques ultérieurs, et à l’inverse, entre le fait de présenter des problèmes physiques pendant l’enfance et de développer ensuite des symptômes du TDAH ultérieurs.
« Il s’agit de l’analyse la plus complète évaluant les liens temporels entre les symptômes du TDAH et un large éventail de conditions médicales, y compris les problèmes dermatologiques, les infections, les traumatismes, les conditions de sommeil et d’autres maladies chroniques. Nous avons cherché à évaluer les associations longitudinales possibles entre les symptômes du TDAH et un large éventail de conditions physiques, en tenant compte de plusieurs facteurs de confusion », explique Cédric Galera, qui est aussi le premier auteur de l’étude.
Les scientifiques ont ainsi montré que le fait d’avoir des symptômes de TDAH pendant la petite enfance était associé à un IMC élevé au milieu de l’enfance et à l’adolescence ainsi qu’à des blessures non intentionnelles pendant l’adolescence. À l’inverse, le fait d’avoir présenté des blessures involontaires pendant la petite enfance était associé à l’apparition ultérieure de symptômes de TDAH au milieu de l’enfance et à l’adolescence. Enfin, le syndrome des jambes sans repos pendant la petite enfance augmentait aussi le risque de TDAH au milieu de l’enfance.
« En éclaircissant les liens entre le TDAH et différentes comorbidités, ainsi que l’échelle temporelle à laquelle elles se mettent en place, notre étude renforce l’idée que les problèmes de santé physique et mentale sont imbriqués, et souligne la nécessité pour les professionnels de santé de toutes les disciplines de mieux travailler ensemble. Il faudrait par exemple que les médecins puissent réorienter vers d’autres champs disciplinaires au besoin. Plus on intervient tôt, plus on prévient les risques évolutifs associés au TDAH », souligne Cédric Galera.
Pour aller plus loin, l’équipe va continuer à s’intéresser à ces associations en étudiant les données recueillies chez le jeune adulte, entre 20 et 25 ans. En outre, les scientifiques souhaiteraient aussi mener des travaux similaires à partir des données françaises, en s’appuyant sur les grandes cohortes mises en place sur le territoire, comme la cohorte Elfe (Étude longitudinale française depuis l’enfance).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
