|
| |
|
|
 |
|
MOSCOU |
|
|
| |
|
| |

Moscou
en russe Moskva
Capitale de la Russie, sur la Moskova.
* Population : 11 514 330 hab. (recensement de 2010)
* Nom des habitants : Moscovites
GÉOGRAPHIE
Moscou s'est développée à 156 m d'altitude sur la Moskova en position de carrefour par rapport aux grandes voies fluviales de la Russie d'Europe : Volga, Dvina, Dniepr, Don. La situation géographique reste privilégiée, valorisée par le rail et l'air (plusieurs aéroports). Le noyau historique (autour du Kremlin et de la place Rouge) est entouré d'une première couronne mêlant quartiers industriels et résidentiels, parcs de loisirs et stades. Une deuxième couronne est composée surtout de grands ensembles résidentiels. L'ensemble, ceinturé par une zone forestière de loisirs (maintenant « mitée » d'ensembles urbains et industriels), couvre 886 km2. Métropole, Moscou détient toutes les fonctions. La centralisation politique a entraîné le développement économique. La ville est un grand centre culturel (universités, musées, théâtres) et commercial. L'industrie est caractérisée par l'essor des industries à forte valeur ajoutée (constructions mécaniques et électriques, chimie s'ajoutant au textile, et à l'agroalimentaire). La ville a accueilli les jeux Olympiques d'été de 1980.
LA POSITION GÉOGRAPHIQUE : UNE VILLE DE CARREFOUR
La position géographique explique en partie la fortune de la ville. À plusieurs titres, elle est marquée par les avantages du contact et du carrefour. La ville est au centre de la vieille Russie. Elle commande de nos jours à deux rayons (grandes régions économiques) : le Centre-Industriel au nord, dans lequel elle est située, et le Centre-Terres Noires, plus agricole, au sud. Ces deux régions assurent une partie notable (environ les deux tiers dans le textile, plus du tiers dans la mécanique) de la valeur de la production industrielle de la Russie.
Les deux régions chevauchent deux grandes zones biogéographiques : la taïga, qui commence au nord des limites de l'agglomération contemporaine, et la forêt mixte, dans laquelle est située la ville. Il s'agit donc d'abord d'une position de contact entre les pays du Nord et les pays du Midi. On passe avec de nombreuses transitions des pays noirs de la grande forêt de conifères aux pays plus ouverts, plus clairs de la forêt mêlée d'essences caducifoliées où apparaissent le chêne et le tilleul. Au nord, on cultive sur des sols médiocres (les podzols) du lin-fibre, du seigle, de la pomme de terre avec de faibles rendements ; vers le sud apparaissent le blé, puis le maïs-fourrage et le maïs-grain, enfin le tournesol sur des sols plus riches, déjà caractérisés par les « terres noires » (le fameux tchernoziom), qui, dans les îlots de steppe, annoncent les plaines ukrainiennes. Ainsi s'opposent encore l'izba, maison de bois de la forêt au nord, et la khata, maison de pisé qui apparaissait autrefois dans les campagnes au sud.
Le contact et les transitions s'observent également d'ouest en est. À l'ouest de la ligne de Moscou au Don se disposent des arcs morainiques disséqués, atteignant par endroits 300 m d'altitude, formant le plateau du Valdaï, les « hauteurs » de Smolensk et de la Russie centrale. À l'est et au sud-est, les marques de la glaciation sont insignifiantes, les formes empâtées du relief disparaissent avec les marécages et l'hydrographie indécise. Les eaux s'écoulent en direction de la gouttière du Don, où la sécheresse s'accuse d'amont en aval, où les violents orages d'été creusent les premiers ravins qui annoncent les steppes du Don inférieur.
Ces contrastes sont accusés encore par les circonstances historiques et les traces qu'elles ont laissées. Les paysans russes réfugiés dans la forêt durant les invasions nomades qui déferlaient sur les steppes (et ont même atteint Moscou au cours de razzias) se sont protégés par des postes militaires, des forteresses entourées de palissades de bois. Les nomades s'efforçaient de dévaster, en l'incendiant, la forêt où les chevaux pénétraient difficilement. Ainsi la limite entre les deux zones est artificielle. Au sud du Moscou contemporain s'étendait une sorte de no man's land dans lequel la ligne des fortifications ne cessa de s'étendre jusqu'à la fin du danger, au début du xviiie s. Ainsi la frontière entre les deux « gouvernements » de Moscou (dans la forêt) et de Toula (découvert) avait été fixée sur la rivière Oka. La rivière Voronej est formée de deux tronçons, Voronej des forêts, Voronej des steppes.
Cette dualité explique le peuplement plus récent, sous une forme militaire et féodale, des plateaux et vallées au sud de l'agglomération actuelle, un type d'agriculture reposant sur l'existence de vastes domaines chargés de ravitailler la capitale. Or, la ville de Moscou a grandi à la limite même de ces zones, mais elle a exploité cette position de confins et de carrefour. De plus, elle est placée dans une situation de diffluence hydrographique. Non loin de là, le plateau du Valdaï est un château d'eau d'où les rivières se dispersent dans toutes les directions. Moscou se trouve sur la Moskova, rivière assez large, elle-même affluent de l'Oka qui va confluer dans la Volga. Le cours supérieur de la Volga passe à une cinquantaine de kilomètres plus au nord, et le port fluvial actuel lui est relié par la « mer de Moscou ». Enfin, le réseau de la Desna, affluent du Dniepr, et celui du Don confluent vers les mers du Sud. Tous ces fleuves étaient navigables ; les routes de terre unissaient, par l'organisation de « portages », les cours supérieurs des rivières du Nord et du Sud. Ainsi, des routes fluviales et de terre se croisaient aux environs de Moscou, les deux principales étant celle de la Volga à Novgorod et de Smolensk à Vladimir. Il faut ajouter que la pêche dans les rivières et les lacs était une activité essentielle au Moyen Âge, au même titre que la navigation et l'exploitation de la forêt ; les troncs d'arbres étaient flottés. Ainsi, quelque chemin qu'on empruntât, on passait presque toujours par la région de Moscou. Il faut remarquer que cette position de diffluence est devenue, grâce aux techniques modernes, une position de convergence : Moscou et son port sont, aujourd'hui, l'un des nœuds essentiels du système des cinq mers qui les relie à la mer Baltique, à la mer Blanche, à la Caspienne et à la mer Noire (et à la mer d'Azov).
Enfin, Moscou est au centre d'une des clairières les plus vastes, ouvertes dans la forêt lorsque succomba la Russie kiévienne et que des Russes vinrent s'y réfugier. L'agglomération est de nos jours, comme Paris, entourée de tous côtés par des bois. La forêt mixte cerne les aéroports ou les grandes localités séparées de l'agglomération. Cette clairière fournissait non seulement des produits agricoles, mais les matières premières d'un artisanat du cuir, de la laine, du bois, dont les produits, élaborés par les artisans locaux, les koustar, étaient vendus durant la mauvaise saison par des colporteurs. C'est l'origine des premières manufactures, de l'afflux de marchands, d'une tradition industrielle qui s'épanouit au cours du xixe s., en particulier le textile. Ces conditions favorables de la circulation et de l'économie régionale expliquent la faveur d'un gros village, puis d'un gorod, que les princes choisirent comme résidence.
LE SITE ET L'EXTENSION
À l'origine, Moscou est un simple kreml, fortin de terre et de bois, dominant de quelque 40 mètres la rive escarpée de la Moskova, sur laquelle est jeté un pont, tandis que la rive droite, basse et marécageuse, reste inoccupée. La dissymétrie fondamentale du site demeure dans toute l'histoire de l'extension de la ville, sans doute parce que, mal défendue, l'autre rive offrait un danger tant que menaçaient les invasions, parce que ses prairies étaient inondées au moment de la débâcle, mais encore parce que le terrain de la rive gauche offrait davantage de possibilités pour le développement d'une grande ville. La cité s'étend en partie sur un plateau de craie, masqué par d'épais dépôts glaciaires et disséqué par des affluents en pente forte de la Moskova, dessinant autant de ravins, de méandres encaissés, si bien que les pentes dont s'accidente la ville sont restées dans le folklore international sous le nom de montagnes russes. D'autres buttes ou éperons seront utilisés pour la défense, mais le kreml constitue le centre, le noyau à partir duquel se développent plusieurs villes concentriques. On reconnaît en effet distinctement dans le plan actuel de la ville les ceintures de remparts qui marquent à chaque époque les limites de l'extension.
Le Kremlin était une forteresse entourée de palissades au pied de laquelle s'étendait une petite bourgade de marchands et de soldats. La plupart des édifices du Kremlin actuel ont été construits aux xive et xve s. ; la ville de bois débordait la Moskova et formait un faubourg.
Kitaï-gorod (appelée à tort « Ville chinoise », le terme, d'origine tatare, signifiant plutôt « le fort ») s'étendit au nord-est dans la première moitié du xvie s. ; elle était à peine plus spacieuse que le Kremlin lui-même.
Bielyï-gorod (la « Ville blanche ») enveloppait le Kremlin et Kitaï-gorod sur une superficie beaucoup plus grande, à l'ouest, au nord et à l'est : elle fut entourée de fortifications à la fin du xvie s.
Zemlianoï-gorod (la « Ville de terre ») enfin, ceinte en 1742, engloba l'ensemble des villes précédentes et passa la Moskova sur l'autre rive, dessinant grossièrement un cercle de 4 à 5 km de diamètre.
Les deux rocades circulaires sont parfaitement visibles dans le dessin actuel : la ceinture des « boulevards » autour de Bielyï-gorod, et la ceinture des jardins, ou Sadovaïa, très large, autour de la Ville de terre ; tel est encore le noyau urbain à forte densité de construction et de population de l'agglomération actuelle.
Cette ville a été décrite par tous les voyageurs jusqu'au xxe s. comme un immense village, aux rues étroites, aux maisons de bois, les izbas, basses et entourées de jardinets ; il suffit d'un « cierge d'un kopeck » pour que se déchaînent les incendies. Au début du xixe s., Moscou n'a encore que 200 000 habitants. Cette ville correspond en gros aux quatre rayons (arrondissements) formant le centre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont tendance à se dépeupler au profit de la périphérie et deviennent une city où sont concentrées l'administration et les affaires en même temps qu'une ville-musée visitée par les provinciaux et les étrangers. Son extension a bénéficié des conditions favorables offertes par le sol : vallée d'un affluent de la Moskova, la Iaouza, à l'est, terrasse étendue à l'ouest, sources nombreuses et possibilités de creusement de puits artésiens, abondance des matériaux de construction, argiles, bois et même pierre. C'est à partir de cette ville initiale que s'étend, dans toutes les directions, l'agglomération contemporaine : d'abord, sous la forme de faubourgs très allongés le long des routes radiales menant dans toutes les directions et qui, en raison du sol argileux et humide, sont pavées et portent le nom de « chaussées » ; ensuite, par l'insertion des gros villages de la clairière primitive, qui, peu à peu, reçoivent l'excédent de la population du centre et multiplient le nombre de leurs izbas ; enfin, par la construction, spontanée ou systématique, de quartiers nouveaux. Ainsi s'est modelé le « Grand Moscou », entouré de nos jours par une large rocade routière, future autoroute, ayant grossièrement la forme d'un ovale d'une trentaine de kilomètres du nord au sud et de plus de 20 km d'ouest en est.
Mais l'extension du Moscou des xixe et xxe s. doit tout à l'essor de la fonction industrielle et du carrefour de communications récentes.
LES FONCTIONS INDUSTRIELLES : LES GÉNÉRATIONS
La première génération d'ateliers et de manufactures de la ville est l'expression des activités de la Russie centrale. Moscou n'a pas d'industrie lourde, peu d'industrie chimique. L'industrie se développe à partir des matières premières locales (bois, cuir, lin et laine) ou des produits du négoce avec les pays du Nord (Novgorod) et de la Volga. Le choix de Moscou comme capitale a été en outre déterminant, le rôle dynastique ayant entraîné le développement de la fonction économique. Dès le xvie s., la ville vit de la Cour et accapare, même après la fondation de Saint-Pétersbourg, une partie des fonctions des autres villes de la Volga supérieure comme Iaroslavl ou la ville du textile, Ivanovo. Il s'agit donc de produits de qualité, voire de luxe, fabriqués par une main-d'œuvre experte, bénéficiant d'une longue tradition, disséminée dans des entreprises de petite ou moyenne taille. Même si certaines branches ont décliné après la Révolution, la plupart se sont maintenues, étoffées ou modernisées : ainsi la confiserie, les parfums, les jouets, les objets d'artisanat, qui connaissent avec les touristes étrangers un regain de faveur, ou les industries du cuir. Le textile, qui occupait encore à la fin du xixe s. plus des trois quarts de la main-d'œuvre industrielle, surtout féminine, en emploie encore environ le cinquième et vient au second rang des industries moscovites. Les manufactures utilisent des filés provenant d'autres régions, et leur production se situe en aval : tissages de la laine et du coton (dans la célèbre manufacture des Trois Montagnes), de la soie naturelle, de la rayonne et des textiles synthétiques, auxquels s'ajoutent la confection, le tricotage, la fourrure, la haute couture ; la branche textile a entraîné le développement du secteur des colorants et des machines.
La seconde génération d'industries date des chemins de fer et de l'abolition du servage. La première voie ferrée, venant de Saint-Pétersbourg, est achevée en 1851. Moscou est reliée au gros centre industriel de Kharkov en 1869, à la Biélorussie et à Varsovie en 1871, à la plupart des grandes villes de province en 1880. Les grandes gares se localisent à la périphérie de la Sadovaïa, portant le nom des villes qu'elles atteignent. Moscou devient un nœud de communications moderne, un carrefour commercial d'importance accrue, reçoit les produits lourds du Donbass. En même temps, les campagnes de la Russie centrale se dépeuplent à la suite de l'abolition du servage (1861). Des centaines de milliers de paysans viennent s'entasser autour des gares, le long des voies ferrées radiales qui pénètrent dans la ville, à proximité des usines nouvellement créées. Celles-ci sont fondées par d'autres capitaux, d'origine étrangère. C'est dans le dernier quart du xixe s. que naissent les premières entreprises métallurgiques : on en comptait 127, avant 1917, presque toutes de petite taille. Ce fut la base à partir de laquelle les premiers plans quinquennaux firent de Moscou le grand centre d'industrie mécanique, travaillant des métaux importés, se situant en aval de la production du Donbass et de l'Oural, livrant des produits finis de qualité, employant une main-d'œuvre qualifiée de cadres moyens et supérieurs formés dans de nombreuses écoles professionnelles. Ainsi, cette branche a ravi rapidement la première place à l'industrie textile et occupe actuellement plus de la moitié de la main-d'œuvre, concentrée dans des établissements de grande taille, fournissant plus du dixième de la valeur de la production mécanique de la Russie : machines-outils pour l'équipement des industries minière, chimique, automobile, textile, des roulements à billes ; électrotechnique, de plus en plus spécialisée dans les appareils électroménagers pour la large consommation urbaine et dans l'électronique (la plus connue est l'entreprise Dinamo, qui fabrique des moteurs et des transformateurs et exporte plus du dixième de sa production dans une trentaine de pays). L'automobile est concentrée depuis le premier plan quinquennal dans l'entreprise Likhatchev, qui a été rénovée et produit des voitures (mais aussi, dans les filiales situées dans l'agglomération, des camions, des autobus et du matériel de manutention). Enfin, la mécanique de précision (compteurs, horlogerie) est une vieille spécialité de Moscou.
À ces deux branches principales s'ajoutent les grandes industries urbaines, le combinat polygraphique (impression, édition) de la Pravda, des studios de cinéma, quelques usines de caoutchouc et de colorants. Au total, une main-d'œuvre de plus d'un million de salariés et de cadres, plus de 300 usines, le dixième du produit brut provenant de l'industrie en Russie.
Ces industries se localisent en fonction de l'origine de la matière première. Ainsi, en direction du bassin houiller de Toula et de Koursk, dans la banlieue sud, se trouvent une fonderie, l'usine de machines à coudre ex-Singer à Podolsk. Vers le sud-est, le long des voies ferrées, sont les usines Dinamo et Likhatchev ; vers le nord, près de Khimki, un chantier de constructions navales, des industries alimentaires ; vers l'est, en direction des villes de la Volga et du Second-Bakou, l'usine Elektrostal (aciers électriques), la chimie et les matières plastiques. Ainsi, l'agglomération s'est sans cesse avancée aux dépens de son oblast, où des villes de plus de 100 000 habitants concentrent une population industrielle et où les villes satellites ont été créées pour décentraliser la vieille ville. Moscou a ainsi construit sa zone d'attraction de main-d'œuvre.
MOSCOU, CAPITALE
Les fonctions de services liées au rôle grandissant de la capitale utilisent une main-d'œuvre plus nombreuse que l'industrie : ainsi, plus du quart de la main-d'œuvre est employé dans la santé publique, l'enseignement et la recherche. Le transfert du siège du gouvernement décidé par Lénine a accéléré l'évolution démographique par rapport à celle de Saint-Pétersbourg et multiplié les fonctions. Elle attire les cadres, les visiteurs, les touristes. Staline avait voulu exprimer cette prépondérance en construisant des gratte-ciel, laids et démodés de nos jours, mais d'autres constructions nouvelles symbolisent la volonté de prestige. Ainsi se sont édifiés la plus haute tour de télévision du monde, à Ostankino (plus de 500 m), le plus grand hôtel (6 000 lits), à côté du Kremlin. À des titres divers, le théâtre Bolchoï, l'Exposition permanente des réalisations de l'économie nationale, l'université Lomonossov, les parcs d'attraction et les stades rassemblent les visiteurs provinciaux et étrangers.
Cette fonction se traduit par la concentration, en régime de planification centralisée, des ministères, des représentations étrangères. L'université et les hautes écoles rassemblent le cinquième des effectifs de toute la Russie, et l'université est la plus réputée du pays. Près du cinquième des ingénieurs de Russie travaillent à Moscou. Les grandes académies et des instituts de recherche renommés dans le monde entier y ont leur siège. La proximité des centres travaillant pour la défense nationale, enfouis dans la ceinture de verdure, la fondation de centres de recherches nucléaires, comme l'accélérateur de particules de Serpoukhov au sud, le centre de recherches fondamentales de Doubna au nord, sur la mer de Moscou, ont encore accru la concentration de scientifiques sortant des hautes écoles.
Sur le plan international, l'université Lumumba, située au sud de la Moskova, a attiré, avec des succès d'ailleurs divers, les étudiants du tiers monde, notamment de l'Afrique.
La ville s'ouvre également aux autres pays et prend une importance mondiale. Elle est de plus en plus choisie comme centre de grands congrès internationaux. Elle accueille plusieurs centaines de milliers d'étrangers par an, hommes d'affaires, touristes, le plus souvent regroupés selon la formule des voyages organisés et guidés. L'aéroport international de Cheremetievo est construit à une trentaine de kilomètres au nord de Moscou.
EXPANSION ET RAYONNEMENT DE MOSCOU
La ville a ainsi forgé autour d'elle une région urbaine de grande taille et de densité à l'hectare encore relativement faible, par rapport aux grandes capitales mondiales (300 à l'intérieur de la Sadovaïa, moins de 100 à l'intérieur de la rocade). Le processus a été géométrique, sous la forme radio-concentrique, si bien qu'on peut facilement enfermer dans des cercles de rayon croissant les agglomérations successives, du Kremlin à l'oblast. Depuis le régime soviétique, cette extension a été planifiée, définie par des limites administratives. Pour la première fois au cours du premier plan quinquennal, un plan d'urbanisme se préoccupe d'organiser et de prévoir l'extension de la ville et la répartition de la population. Mais l'avant-guerre compta encore peu de réalisations. En 1948, Staline veut donner à la capitale de la Russie victorieuse une allure prestigieuse et fait construire les huit gratte-ciel, dont le plus élevé est l'université sur le mont des Oiseaux, puis les stations du métro, d'un luxe de goût discuté. Un plan datant de 1953 porte la superficie de la ville, marquée par la limite du pouvoir de son Conseil (Mossoviet), à 330 km2, contre 300 environ avant la guerre. En 1959, la superficie atteint, par annexion de quelques quartiers ou villages, 356 km2. Enfin, la dernière phase est marquée par le décret du 18 août 1960, qui porte le territoire à 875 km2 (886 aujourd'hui), enfermé par la rocade routière circulaire d'où partent dans toutes les directions les routes nationales (appelées « autoroutes ») à deux ou quatre voies. Autour, une autre enveloppe limite une « zone protégée » à faible densité où ne sont situées qu'une dizaine de localités de quelques milliers d'habitants chacune, où la construction est en principe interdite et qui doit être réservée au repos (forêt, parcs, prairies, plans d'eau, lacs et réservoirs sur les rivières, comme la Kliazma), s'étendant sur 1 800 km2, ce qui porte la superficie du « Grand Moscou » (Mossoviet, plus ceinture protégée) à plus de 2 650 km2. Les villes incluses sont Mytichtchi, Balachikha à l'est, Lioubertsyau sud-est, Vidnoïe au sud...
Enfin, la région suburbaine appelée Podmoskovie (« région autour de Moscou ») s'étend sur la majeure partie de la province (oblast) administrative. Elle comprend encore plusieurs millions d'habitants répartis dans plusieurs types d'agglomérations. Les localités rurales appartiennent à la zone de ravitaillement en produits agricoles de la ville, spécialisées dans la culture maraîchère (pommes de terre et choux), la production porcine et laitière (avec une densité d'une trentaine de têtes de gros bétail sur 100 ha), l'exploitation de serres, généralement chauffées par la vapeur des usines voisines, des vergers de pommiers. La vallée de la Kliazma au nord constitue en particulier une zone de cultures légumières très dense. Dans des localités mi-rurales, mi-urbanisées subsistent un artisanat ou des ateliers travaillant en vue du marché urbain (objets de bois, de cuir, poteries, textiles), où se sont décentralisées de petites entreprises de la vieille ville. Des localités de maisons de campagne (datcha) sont entourées de verdure, de terrains de chasse, de baignades, de parcs de récréation. Des vieilles villes industrielles ou des centres de recherche sont installés au milieu de la forêt (ainsi Serpoukhov au sud, Doubna au nord, Elektrostal à l'est, la file des usines allongées jalonnant le canal Volga-Moscou au nord-ouest). Des villes satellites, ou spoutnik, villes nouvelles à croissance rapide, sont chargées de décentraliser la population ou de retenir la population nouvelle à la périphérie de l'agglomération. Une partie de la main-d'œuvre travaille sur place, une autre à Moscou. Ainsi se sont développées une vingtaine de villes, dont la majorité se situe dans la partie occidentale de l'agglomération : Istra, Dedovsk, Troïtski, Naro-Fominsk...
Une vingtaine de grands ensembles, chacun d'eux pourvu d'un équipement scolaire et commercial, ont été construits : ainsi Tcheremouchki et Kountsevo au sud-ouest et à l'ouest ; Babouchkine et Medvedkovo au nord, Khimki-Khovrino au nord-ouest, etc. L'un des meilleurs exemples d'aménagement est celui du Iougo-Zapad, du sud-ouest, où de nouvelles avenues (prospekt) ont été tracées, où l'immense parc des sports Loujniki s'étend dans la boucle de la Moskova, avec un stade de 100 000 places.
UN URBANISME « VOLONTARISTE »
L'urbanisme soviétique reposait sur deux idées fondamentales qui déterminaient son originalité et son efficacité : le régime des droits de propriété élaboré depuis 1917 et l'intégration de l'aménagement du territoire dans le système de planification.
1924 : le plan de reconstruction et de développement de Moscou, par Chestakov, renforce le tracé radio-concentrique et la séparation sur le terrain des fonctions de la vie urbaine (zoning).
1929 : le plan d'« urbanisme socialiste » marque l'affrontement de deux grands courants de pensées : pour les « urbanistes », la création de maisons communes consacre la vie collective qui doit se dérouler dans un cadre urbain. Pour les « désurbanistes », la ville est historiquement et économiquement condamnée ; des cellules de vie collective doivent se créer sur tout le territoire et faire disparaître l'opposition ville-campagne. Les deux courants seront critiqués par le pouvoir, mais donneront cependant lieu à d'intéressantes réalisations.
1935 : le plan de reconstruction systématique amène la création de grandes artères radiales, la création du métro (son décor et son luxe témoignent de l'intérêt porté à l'aménagement de tous les lieux de vie collective), la délimitation stricte d'un périmètre d'extension. Si l'architecture proprement dite verse dans le monumentalisme (style « stalinien »), l'application de ce plan devait contribuer efficacement au développement de la capitale.
LE CLIMAT
Le climat de Moscou est continental, avec des précipitations moyennes (624 mm par an), qui tombent surtout en été, et des températures moyennes qui oscillent entre 19 °C en juillet (23 °C maximum et 13 °C minimum) et – 9 °C en janvier (– 9 °C maximum et – 16 °C minimum), soit 28 °C d'amplitude thermique, pour une moyenne annuelle de 4 °C. Les hivers sont longs (4 mois) et rigoureux (150 jours de gel), avec parfois des excès (les températures descendent jusqu'à − 30 °C).
L'HISTOIRE DE MOSCOU
Vers 1140, un boyard du nom de Koucha construit un petit village dans une clairière au milieu de la forêt près d'une rivière au cœur de la Russie, et il perçoit un péage pour le passage de cette rivière, la Moskova (Moskva). Le prince d'une ville voisine, Iouri Dolgorouki de Rostov-Souzdal, s'empare du village en 1147 et lui donne le nom de Moscou, d'après celui de la rivière (Moskva viendrait du finnois et signifierait « eaux troubles » en opposition à Oka, « eaux calmes »).
En 1156, ce prince décide de fortifier le village et il établit une citadelle sur la colline : le Kreml (ou Kremlin). Une ville (gorod) naît alors mais qui reste sans grande importance jusqu'à la seconde moitié du xiiie s. Le moment décisif, c'est en 1263 la fondation d'une principauté indépendante de Moscou par Alexandre Nevski, qui la confie à son fils cadet Daniel.
À partir d'un site géographique favorable, mais plutôt banal, le développement de Moscou s'explique par des raisons historiques. Daniel et ses successeurs mènent un jeu habile et utilisent la protection mongole pour agrandir leur territoire et abaisser les villes voisines. Capitale politique, Moscou devient en 1326 une capitale religieuse en raison de l'installation à l'intérieur du Kremlin du métropolite orthodoxe.
Derrière les palissades en bois du Kremlin, on trouve alors le palais du prince et la cathédrale de l'Assomption, mais la ville s'étend au-delà du Kremlin sur la rive gauche de la Moskova au xive et au xve s. Les succès des princes de Moscou qui en 1480 s'affranchissent définitivement du tribut mongol font de la ville le successeur de Byzance, conquise par les Turcs en 1453. Moscou prétend même être la troisième Rome.
La ville s'agrandit et devient une belle cité aux monuments en pierre à partir de la fin du xve s.
Au xvie s., Moscou est un grand centre commercial, en particulier grâce à ses relations asiatiques. Le centre commercial se trouve à l'est du Kremlin, c'est Kitaï-gorod, entourée elle-même d'une muraille. Plus loin s'étend Bielyï-gorod (la « Ville blanche »), également entourée d'une muraille, qui se développe au xviie s. Ce sera le quartier aristocratique et on y créera en 1755 la première université russe.
La ville s'étend également sur la rive droite, où se trouvent les quartiers populaires de la Zemlianoï-gorod (la Ville de terre). Avec 100 000 habitants au xvie s., près de 200 000 à la fin du xviie s., Moscou est une cité importante malgré les troubles et l'occupation polonaise.
En 1712, Pierre le Grand lui enlève cependant son titre de capitale au profit de Saint-Pétersbourg, qu'il vient de fonder. Néanmoins, l'importance de Moscou reste grande, car elle demeure la ville sainte où les tsars se font couronner, la capitale religieuse, la deuxième capitale de l'empire des tsars.
La ville est occupée par Napoléon en 1812 du 14 septembre au 19 octobre, et l'incendie de Moscou fait rage plusieurs jours après l'arrivée des troupes françaises.
Au xixe s., Moscou, malgré les progrès de Saint-Pétersbourg, connaît un développement certain dû à son rôle économique et à sa position centrale incontestablement plus favorable que celle de la métropole baltique. L'industrie textile, métallurgique et chimique apparaît dans les faubourgs, et Moscou compte plus d'un million d'habitants à la fin du xixe s. et plus d'un million et demi en 1917. Lors de la révolution de 1905, elle est une grande ville ouvrière, et c'est là que les socialistes russes déclenchent, en décembre, une insurrection, vaincue après quelques jours de violents combats.
En 1917, après la révolution d'Octobre victorieuse à Petrograd, le soviet de Moscou à majorité bolcheviste se heurte à la résistance acharnée des détachements d'élèves officiers, les junkers, qui réussissent à occuper le Kremlin et y massacrent plusieurs centaines de jeunes soldats rouges. Le soviet de Moscou doit donner l'ordre de bombarder les murailles du Kremlin pour reprendre la forteresse la nuit du 16 au 17 novembre.
Le 11 mars 1918, le Conseil des commissaires du peuple présidé par Lénine quitte Petrograd pour s'installer à Moscou, à l'intérieur du Kremlin.
Redevenue dès lors la capitale de la Russie, puis celle de l'Union des républiques socialistes soviétiques, fondée à la fin de 1922, Moscou va croître rapidement en raison même de la politique de centralisation suivie par Staline et par les dirigeants soviétiques. La ville se transforme rapidement et s'agrandit dans toutes les directions.
D'octobre à décembre 1941, les armées hitlériennes s'approchent jusque dans les faubourgs de Moscou, mais, malgré les 75 divisions (dont 14 blindées) et 1 000 avions mis en action par Hitler, elles ne peuvent s'emparer de Moscou, défendue par l'armée rouge et par un peuple dressé pour la défendre.
L'ART À MOSCOU
Moscou fut tout d'abord construite en bois ; elle reçut ses premiers bâtiments en pierre sous Ivan III (1462-1505), qui acheva le rassemblement des terres russes et voulut que la cité fût le symbole de sa puissance.
Ivan III confie tout d'abord à des architectes de Pskov la construction de la cathédrale de la Dormition (Ouspenski Sobor), à l'intérieur de l'enceinte fortifiée remontant au xiie s. (Kremlin) ; mais les Russes échouent, ayant oublié les techniques de construction en pierre sous le joug mongol. Le tsar fait alors appel à des Italiens, et c'est un architecte de Bologne, Aristotele Fieravanti (ou Fioravanti, vers 1415-vers 1486), qui en mène à bien la construction (1475-1479) en prenant pour modèle la cathédrale de la Dormition de Vladimir. Dans les années qui suivent, d'autres églises sont encore édifiées dans le Kremlin : la collégiale de l'Annonciation (Blagovechtchenski Sobor, 1484-1489), bâtie par des architectes de Pskov, se présente comme un cube entouré d'une haute galerie et coiffé de coupoles ; l'iconostase fut exécuté, semble-t-il, par Théophane le Grec (vers 1350-début du xve s.) et Andreï Roublev (vers 1360-1430). En face fut élevée la collégiale de l'Archange-Saint-Michel (Arkhangelski Sobor, 1505-1509), œuvre du Milanais Alevisio Novi ; cet édifice conserve la structure des églises russes, mais il est, en particulier, orné de coquilles de style Renaissance, motif décoratif qui sera un élément caractéristique de l'architecture moscovite. Ces grands édifices s'équilibrent avec des constructions plus modestes comme la petite église de la Déposition-du-Manteau-de-la-Vierge (1484-1486), derrière laquelle pointent les bulbes des églises intégrées au palais du Terem, construit en 1635-1636. Le palais à Facettes (Granovitaïa Palata, 1487-1491) fut bâti par Marco Ruffo (actif à Moscou à partir de 1480) et Pietro Antonio Solari (vers 1450-1493) ; l'intérieur fut, en 1668, décoré de fresques par Simon Fedorovitch Ouchakov (1626-1686). Au-dessus de tous ces édifices se dresse le clocher d'Ivan le Grand (Ivanovskaïa kolokolnia). Cette énorme tour, commencée au début du xvie s. et achevée en 1600 sous le règne de Boris Godounov, renferme trente et une cloches. L'une d'elles, la cloche Reine (Tsar kolokol), mesure 5,87 m de haut et pèse 218 t ; un fragment s'en détacha en 1737 et fut installé sur un socle de granit, au pied du clocher, en 1836. Résidence du tsar, mais aussi siège du métropolite, puis du patriarche, le Kremlin abrite encore le palais Patriarcal et la collégiale des Douze Apôtres (1655-1656), église privée du patriarche. Le Kremlin a été agrandi au cours des siècles, sa superficie est actuellement de près de 28 ha. Sous Dimitri Donskoï (1359-1389), l'enceinte de bois est remplacée par une enceinte en pierre. Elle est reconstruite en brique en 1485-1495 par Marco Ruffo et Pietro Antonio Solari, qui prennent pour modèle le château des Sforza de Milan. Les remparts, crénelés à l'italienne, sont flanqués de vingt tours : en 1485 est élevée la porte centrale, dite « porte secrète » (Taïnitskaïa vorota), d'où partait un souterrain conduisant à la rivière ; en 1487, on construit la tour de Beklemichev ; en 1490, la tour Borovitskaïa, par où Napoléon devait pénétrer dans le Kremlin ; en 1491, les portes Saint-Nicolas (Nikolskaïa vorota) et de Saint-Flor. Les couronnements actuels des tours sont du xviie s. ; ceux de la tour à horloge de la porte du Sauveur ont été conçus en 1625 par l'Anglais Christopher Galloway.
À l'extérieur du Kremlin, de l'autre côté de la place Rouge (Krasnaïa Plochtchad, « Belle Place » en vieux russe), la place principale de Moscou.
On élève l'église Saint-Basile-le-Bienheureux (1554-1560) sur ordre d'Ivan le Terrible, pour commémorer la prise de Kazan. Ce monument, constitué d'une église centrale entourée de huit chapelles coiffées de coupoles bariolées, est une curiosité pittoresque et non un édifice typique de l'architecture russe. Toutefois, la partie centrale est construite dans un style largement répandu au xvie s., le style pyramidal (en chater [chatior]). Les églises de ce modèle sont caractérisées par une flèche pyramidale coiffant un édifice très élancé et de section réduite. Les premières églises en chater avaient été construites dans les environs de Moscou : celle de Saint-Jean-Baptiste à Diakovo (1529), celle de l'Ascension à Kolomenskoïe (1532). Au xviie s., on élève surtout des églises paroissiales, presque toutes du même type : de plan carré, elles sont plus hautes que larges, souvent à deux étages et couronnées de cinq coupoles ; le sommet des façades se termine par des arcs en encorbellement. On accède à l'église par une longue galerie fermée dont l'entrée est surmontée d'un clocher en chater, comme dans l'église de la Nativité à Poutinki (1649-1652), celle de la Dormition-des-Potiers (1654) ou celle de Saint-Nicolas-des-Tisserands (1676-1682).
À la fin du xviie s. se répand un style nouveau, le baroque moscovite, ou style Narychkine, du nom du boyard Lev Kirillovitch Narychkine (1668-1705), beau-frère du tsar Alexis Mikhaïlovitch, qui fit bâtir en 1693 l'église de la Protection-de-la-Vierge à Fili. Celle-ci repose sur une haute galerie à arcades, et l'on y accède par des escaliers imposants. La partie inférieure de l'église est un cube flanqué sur chaque côté d'une construction semi-circulaire coiffée d'une coupole ; sur ce cube vient s'emboîter une première tour octogonale, surmontée d'une seconde, plus petite, elle-même couronnée d'une coupole. L'édifice, de couleur brique, est orné d'éléments décoratifs en chaux. Le style Narychkine se distingue en effet par la richesse du décor : les façades sont ornées de colonnettes, de chapiteaux, de corniches, de carreaux de faïence de couleurs vives ; les lignes architecturales sont soulignées par des moulures, les fenêtres sont encadrées de torsades et de volutes. On trouve de beaux exemples du baroque moscovite au monastère Novodevitchi ou au monastère Donskoï.
À partir des années1770-1780 et jusqu'au milieu du xixe s., le style classique remplace le baroque, en particulier dans l'architecture civile. Deux architectes, Vassili Ivanovitch Bajenov (1737 ou 1738-1799) et son élève Matveï Fedorovitch Kazakov (1738-1812), construisent pour de riches marchands ou pour des nobles une série d'hôtels particuliers, tous bâtis sur le même modèle : le corps central, décoré d'une imposante colonnade et d'un fronton, est flanqué de deux ailes ; l'ensemble de l'édifice est recouvert de stuc peint en couleurs pastel. Il en est ainsi de la maison Pachkov (1784-1786), œuvre de Bajenov, ou de la maison Demidov (1779-1791), due à Kazakov. C'est également sur ce modèle que Kazakov édifie dans les années 1780 l'ancien Sénat (avec sa vaste Salle à colonnes) et, en 1786-1793, le bâtiment de l'université, qui sera restauré après l'incendie de 1812. Une architecture semblable se retrouve dans les résidences que se font construire les nobles aux environs de Moscou : châteaux de Kouskovo des années 1770 et d'Ostankino des années 1790, appartenant aux comtes Cheremetev, château d'Arkhangelskoïe (vers 1780-1831), résidence des princes Galitzine (Golitsyn), puis Ioussoupov.
Après l'incendie de 1812, Alexandre Ier crée une commission pour la restauration de Moscou. L'architecte Ossip Ivanovitch Bovet (1784-1834) aménage le centre de la ville dans le style classique, notamment la place du Théâtre où il construit le théâtre Bolchoï (1821-1824). Près du Kremlin est édifié en 1817 le Manège (détruit par un incendie en 2004).
Au milieu du xixe s. se développe un style nouveau, inspiré par l'architecture russe médiévale, à laquelle il emprunte de nombreux éléments décoratifs. C'est dans ce style « vieux russe » qu'ont été édifiés par C. Thon (Konstantine Andreïevitch Ton [1794-1881] le, Grand Palais (1838-1849) et le palais des Armures (1849-1851), à l'intérieur du Kremlin ; de même, le Musée historique (1875-1881), dont la décoration extérieure est due à V. Sherwood (Vladimir Ossipovitch Chervoud [1833-1897]), les galeries marchandes (1888-1894), qui abritent aujourd'hui le magasin Goum, et la galerie de peinture Tretiakov, dont la façade a été dessinée par le peintre Viktor Mikhaïlovitch Vasnetsov (1848-1926).
Après la révolution d'Octobre, Moscou redevient la capitale. Comme dans les autres domaines de l'art, des tentatives se font jour pour créer une architecture rompant résolument avec celle du passé. Au début des années 1920, les architectes recherchent surtout des formes nouvelles, méprisant les aspects fonctionnels et les problèmes de construction. De nombreux projets, sans doute irréalisables, sont d'ailleurs dus à des peintres ou à des sculpteurs, tel celui de Tatline pour un monument à la IIIe Internationale. Par la suite, les architectes s'efforcent de concilier les recherches formelles et les nécessités d'une architecture fonctionnellement adaptée au nouveau genre de vie. C'est dans cet esprit, par exemple, que Konstantine Melnikov construit plusieurs clubs à Moscou, notamment le club Roussakov, auquel il applique le principe des volumes transformables (salle adaptable aux différents besoins).
Cette synthèse entre expression formelle et fonctionnalisme est parfaitement atteinte dans les projets d'Ivan Leonidov à la fin des années 1920. Cependant, ils ne furent pas pris en considération, car alors commençaient à s'imposer les partisans d'un style monumental empruntant ses éléments composites à l'architecture du passé. Ce style triomphera au milieu des années 1930. Qualifié parfois de « stalinien », il est caractérisé par la massivité et la surabondance des éléments décoratifs, colonnes, corniches, etc. Les gratte-ciel de Moscou, tel celui de l'université Lomonossov (1949-1953), en offrent un exemple typique. Après 1956, l'architecture devient beaucoup plus sobre. On édifie des bâtiments de verre et de béton aux formes parallélépipédiques, tels le palais des Congrès (1961) [dans l'ensemble du Kremlin], dont le projet a été établi sous la direction de Mikhaïl Vassilievitch Possokhine, le cinéma Russie sur la place Pouchkine, plus récemment l'hôtel Russie ou encore les immeubles du « nouvel Arbat ».
Un plan de rénovation du centre historique a été entrepris dans les années 1990 : reconstruction de la porte de la Résurrection, de la cathédrale Notre-Dame de Kazan, de l'ancienne cathédrale du Christ-Rédempteur, édifiée entre 1839 et 1883 pour célébrer la victoire de 1812 sur Napoléon (rasée par Staline en 1933 et aménagée en piscine en 1960) …
LES MUSÉES DE MOSCOU
La galerie Tretiakov, donnée à la ville de Moscou en 1892, présente un vaste panorama de l'art russe depuis le xie s. jusqu'à nos jours (Vierge de Vladimir, Andreï Roublev, Kandinski, etc.).
Le musée des Beaux-Arts Pouchkine est consacré à la peinture occidentale, des primitifs italiens à Picasso (collections Chtchoukine et Morozov), en passant par les écoles hollandaise (Rembrandt), flamande, espagnole, les impressionnistes, Van Gogh, Cézanne, Matisse, etc.
Le musée du palais des Armures est installé dans le palais construit pour lui de 1849 à 1851. L'institution a pour origine un dépôt d'armes créé dans les premières années du xvie s. Depuis 1917, le palais des Armures est devenu un grand et riche musée d'art : armes et armures, émaux des xvie et xviie s., orfèvrerie européenne, parures et broderies, pierres précieuses.
La ville et sa proche banlieue compte maints autres musées : le musée d'Histoire, le musée Pouchkine, le musée Andreï Roublev (dans l'ancien monastère Saint-Antoine), le musée d'architecture (à Kolomenskoïe), le musée d'Art et d'Histoire (à Serguiev Possad), le musée de la Céramique (dans le château de Kouskovo), etc.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
DE L'HOMME - ET DE LA FEMME - PRÃHISTORIQUES |
|
|
| |
|
| |

DE L'HOMME - ET DE LA FEMME - PRÉHISTORIQUES
Depuis leur fondation au milieu du XIXème siècle, les sciences de la préhistoire ont situé le devenir de la famille humaine dans les 5 ou 7 millions d'années de son existence. Ils ont déployé une rigueur et une inventivité extraordinaires pour faire parler les vestiges rares, disséminés et fragmentaires dont ils disposent.
La théorie de l'évolution conduit à penser l'origine de l'Homme, non comme création, moment ponctuel miraculeux où il serait triomphalement apparu sur la terre, mais comme filiation, qui enracine notre espèce dans l'ensemble du règne animal, dans les embranchements et les buissonnements multiples de l'histoire du vivant. Anthropologues et biologistes se sont attachés à reconstituer la généalogie de l'homme, et les mécanismes mêmes de son devenir : Ardipithecus ramidus, Australopithecus, Homo habilis, erectus, neandertalensis, sapiens... - dessinent, depuis le lointain de la préhistoire africaine, la constellation de nos ancêtres.
Les préhistoriens ont tenté de reconstituer les cultures, les modes de vie et de pensées des Préhistoriques : invention, usage et évolution de l'outillage, formes de l'expression et de la communication, gestes, croyances et rituels que pouvait exprimer l'art ou les sépultures. Les formes et les structures de la vie sociale des premières sociétés humaines - sociétés nomades de chasseurs-cueilleurs - ont elles aussi été interrogées ; de nouvelles approches ont permis de repenser les relations entre hommes et femmes au Paléolithique, et de réévaluer le rôle de la femme dans la préhistoire.
DE L'HOMME - ET DE LA FEMME - PRÉHISTORIQUES
Texte de la 11ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 11 janvier 2000 par Claudine Cohen
De l'homme (et de la femme) préhistorique
En 1883, l'anthropologue français Gabriel de Mortillet publie Le Préhistorique, une somme du savoir accumulé de son temps sur la préhistoire. Savoir tout neuf encore : seulement deux décennies plus tôt, Boucher de Perthes avait produit, aux yeux de ses contemporains d'abord sceptiques, puis émerveillés, les preuves de l'ancienneté de l'Homme, et démontré que des êtres humains avaient cohabité, en des temps dont aucune écriture n'a conservé la mémoire, avec des animaux aujourd'hui éteints - le Mammouth, l'Ours des Cavernes, le Rhinocéros laineux survivant par des froids glaciaires dans la profondeur des grottes, et armé de frustes "casse-têtes" de silex taillés.
Mortillet s'était employé à donner plus de rigueur à la science commençante, et avait classé selon un ordre typologique et évolutif les cultures humaines de cet homme, que déjà on n'appelait plus "antédiluvien". En 1865 John Lubbock avait forgé les termes de "Paléolithique" pour désigner les cultures de la pierre taillée, les plus anciennes, celles des chasseurs-cueilleurs, et "Néolithique" pour nommer les plus récentes, de la pierre polie et de la terre cuite propres aux premiers temps de la sédentarisation, de l'agriculture et de l'élevage.
L'étude de l'Homme préhistorique de Mortillet se nourrissait des recherches de Boucher de Perthes dans la basse vallée de la Somme, et des magnifiques découvertes de Lartet et Christy dans la vallée de la Vézère et de la Dordogne. S'inspirant de l'évolutionnisme darwinien (ou de ce qu'il croyait en savoir) il avait décrit le devenir linéaire et progressif de l'Homme et de ses cultures, depuis les primitifs bifaces de l'Acheuléen et du Chelléen, jusqu'aux industries de l'Homme de Néandertal (le Moustiérien) et aux cultures solutréennes et magdaléniennes, caractéristiques d'Homo sapiens. Cette progression de la lignée humaine culminait avec l'Homme de Cro-Magnon, un Homme semblable à nous, au front haut et à la stature robuste, découvert en 1868 dans la vallée de la Vézère. Aux racines de cette brillante lignée, Mortillet avait forgé la fiction d'un ancêtre mi-singe mi-homme, l'Anthropopithèque, auquel on attribua une petite industrie de silex éclatés trouvés à Thenay, dans le Loir et Cher, qui devaient bientôt se révéler être de vulgaires cailloux aux cassures naturelles.
Aujourd'hui, en l'an 2000, l'image de l'Homme préhistorique a beaucoup changé. Les idées sur l'évolution se sont modifiées, la Nouvelle Synthèse depuis les années 1930 a récusé l'image d'une évolution comprise comme progrès linéaire, mettant l'accent sur la variation, le buissonnement des formes, et la notion d'une histoire contingente, et imprévisible. D'innombrables découvertes ont enrichi notre vision du passé préhistorique de l'Homme, et ce n'est plus seulement dans le Loir-et-Cher, la vallée de la Somme et de la Vézère, que l'on va chercher ses origines, mais au Moyen Orient et en Europe centrale, aux confins de l'Afrique, de l'Indonésie, de la Chine...
Le regard sur la préhistoire est devenu plus directement ethnologique, et la volonté de mieux connaître dans leur réalité les premières sociétés humaines s'est marquée par de nouvelles exigences de rigueur dans les recherches de laboratoire et de terrain. Celles-ci font appel à un arsenal méthodologique nouveau - fouilles très fines, décapage horizontal des sites, remontages d'outils, méthodes quantitatives pour reconstituer la vie. La préhistoire expérimentale, par la taille et l'utilisation d'outils, en reproduisant les gestes du sculpteur ou du peintre, s'emploie à retrouver les pensées et les démarches opératoires des Hommes de ce lointain passé. Cette approche expérimentale et cognitive vise à livrer une vision plus vivante, plus vraie, plus humaine du passé lointain de notre espèce. Enfin, la vision de l'Homme préhistorique s'est diversifiée, complexifiée, et laisse aujourd'hui la place à une réflexion sur le rôle, les rôles possibles de la femme dans la préhistoire.
Généalogie d'Homo sapiens
"L'Homme descend du Singe", affirmait Darwin, et déjà Lamarck avant lui. La théorie de l'évolution, née au XIXème siècle, a conduit à penser l'origine de l'Homme, non comme création, mais comme filiation, qui enracine notre espèce dans l'ensemble du règne animal. Dès lors, reconstituer la généalogie de l'Homme, c'est réunir et tenter de donner un sens évolutif à tous ces vestiges osseux, baptisés Ardipithecus Ramidus, Australopithecus, Homo habilis, ergaster, rudolphensis, erectus, neandertalensis, sapiens... - qui dessinent, depuis le lointain de la préhistoire africaine, la constellation de nos ancêtres ; c'est interroger la configuration des événements complexes - biologiques, culturels, environnementaux - qui ont eu lieu depuis plus de 5 millions d'années.
La multiplicité des espèces d'Hominidés fossiles connues dès les époques les plus anciennes rend désormais impossible toute conception finaliste et linéaire de ce devenir. C'est un schéma arborescent, buissonnant même, qui rend le mieux compte de la profusion des espèces d'hominidés, parfois contemporaines entre elles, qui nous ont précédés. A lidée dune progression graduelle, on a pu opposer la possibilité de processus évolutifs plus soudains et contingents : ainsi Stephen Jay Gould a pu réaffirmer, après les embryologistes du début du siècle, l'importance pour l'évolution humaine de la néoténie : celle-ci consiste dans la rétention, à lâge adulte, de caractéristiques infantiles ou même fStales, qui peut faire apparaître dans une lignée des formes peu spécialisées qui seront à lorigine de groupes nouveaux. LHomme pourrait bien être un animal néoténique, et dériver dun ancêtre du Chimpanzé qui aurait conservé à lâge adulte les traits du jeune... Un des caractères particuliers de lHomme est en effet le retard de la maturation et la rétention des caractères juvéniles : ce retard se manifeste par certains traits anatomiques : régression de la pilosité, bras courts, tête volumineuse par rapport au reste du corps, gros cerveau, front redressé, régression de la face... - , mais aussi dans sa psychologie et son comportement : longue durée de léducation, goût du jeu, plasticité du système nerveux et capacité de lapprentissage jusque tard dans la vie.... L'acquisition chez l'homme de ces traits, et leur corrélation même, pourrait être explicable par un processus simple (et accidentel) du développement.
A la quête des origines de l'Homme s'est longtemps associée celle du "berceau" de l'humanité, dont Teilhard de Chardin se plaisait à dire qu'il était "à roulettes". On l'a recherché en Asie, en Europe, mais cest l'Afrique qui aujourd'hui s'impose comme le lieu d'enracinement le plus probable de la famille des Hominidés et du genre Homo. Les découvertes des hominidés les plus primitifs connus, les Australopithèques, faites d'abord en Afrique du Sud, puis en Afrique de l'Est conduisent à penser que le berceau de la famille des Hominidés se situe dans ces régions.
La Vallée du grand Rift africain doit elle être considérée comme le lieu d'origine le plus probable de la famille des Hominidés ? Cette thèse est débattue aujourd'hui. Il se peut en effet que les découvertes nombreuses et spectaculaires dans ces sites - ainsi, celle de "Lucy", une Australopithèque très primitive datée de 3 millions d'années, dont les restes presque complets ont été découverts dans le site de Hadar, en Éthiopie en 1974 - s'expliquent plutôt par d'extraordinaires conditions de préservation des fossiles, et des conditions géologiques particulièrement favorables à ce genre de trouvailles. Aujourd'hui, le schéma de "L'East Side Story" selon lequel les premiers Hominidés seraient d'abord apparus à l'est de la Rift Valley, après le creusement de cette faille il y a 7 millions d'années, semble devoir être révisé : une mandibule d'Australopithèque découverte par le paléontologue français Michel Brunet à quelque 2500 km à l'ouest la Rift Valley, au Tchad et contemporaine de Lucy, suggère que l'histoire humaine à cette époque très reculée met en jeu des facteurs environnementaux et comportementaux plus complexes que ceux supposés jusqu'alors. Cette découverte a fait rebondir la question du berceau de l'humanité : elle oblige à penser très tôt en termes de dispersions et de migrations, et à considérer que dès ces époques lointaines du Pliocène, il y a quelque 3 millions d'années, les Hominidés étaient déjà répandus dans une grande partie du continent africain.
Selon les constructions de la biologie moléculaire, c'est entre 5 et 7 millions d'années avant le présent qu'il faut situer l'enracinement commun des Hominidés et des Grands Singes. Les restes d'Ardipithecus ramidus, découverts en Éthiopie, ont été classés en 1994 dans un genre nouveau, que son ancienneté (4,4 millions d'années) semble situer tout près de l'origine commune des grands Singes africains et des premiers Hominidés.
Le tableau de l’ évolution de la famille humaine inclut de nombreuses espèces d' Australopithèques, ces Hominidés dallure primitive, au front bas, à la démarche bipède, qui ont coexisté en Afrique pendant de longues périodes et dont les vestiges sont datés entre 3,5 et 1 million d'années avant le présent.
Quant aux premiers représentants du genre Homo, ils sont reconnus à des périodes fort anciennes : à Olduvai (Tanzanie) Homo habilis, à partir de - 2,5 millions d'années, a été désigné comme le plus ancien représentant du genre auquel nous appartenons, mais il coexiste peut-être en Afrique avec une deuxième espèce du genre Homo, Homo ergaster.
A partir de -1,7 millions d'années Homo erectus apparaît en Afrique, puis va se répandre dans tout l'Ancien monde : Homo erectus est un Homme de taille plus élevée, au squelette plus lourd et dont le crâne, plus volumineux et plus robuste, a une capacité d'environ 800 cm3. Il va bientôt se répandre dans les zones tempérées du globe, dans le Sud-Est asiatique, en Asie orientale, dans le continent indien et en Europe. Culturellement, il s'achemine vers des sociétés de plus en plus complexes : il développe les techniques de la chasse, domestique le feu, et autour d'1,5 millions d'années invente le biface, qui pour la première fois dans l'histoire humaine manifeste le sens de la symétrie et de l'esthétique.
Les Néandertaliens (Homo neandertalensis) semblent apparaître il y a environ 400 000 ans en Europe occidentale, mais on les trouve aussi au Proche Orient, en Israël et en Irak, entre 100 000 et 40 000 avant le présent. Ces Hominidés au front bas, à la face fuyant en museau, à la carrure massive, mais au crâne dont la capacité cérébrale est proche de la nôtre, parfois même supérieure ont prospéré en Europe de l'Ouest, au Paléolithique moyen (jusqu'il y a 35 000 ans environ), avant d'être brusquement, et de façon encore mal comprise, remplacés par des hommes de type moderne au Paléolithique supérieur. Au Proche-Orient, les choses paraissent plus complexes. Au Paléolithique moyen, les Néandertaliens semblent bien avoir été les contemporains, dans les mêmes lieux, des sapiens archaïques. Pendant plusieurs dizaines de millénaires, ils ont partagé avec eux leurs cultures. Dans ces sites du Proche-Orient, la culture "moustérienne" est associée, non pas comme en Europe aux seuls Néandertaliens, mais à tous les représentants de la famille humaine. En particulier, la pratique de la sépulture est associée non à tel type biologique d'hominidé mais à ce qu'on peut appeler la culture moustérienne, qui leur est commune.
Histoire d'amour, de guerre ou... de simple cohabitation? Sapiens et Néandertaliens ont-ils pu coexister dans les mêmes lieux, avoir, à quelques variantes près, la même culture et les mêmes rituels funéraires, sans qu'il y ait eu d'échanges sexuels entre eux ? Pour certains, il pourrait s'agir de deux races d'une même espèce, donc fécondes entre elles, et les Néandertaliens auraient pu participer au patrimoine génétique de l'homme moderne. D'autres refusent cette hypothèse, sur la foi de l'étude récente d'un fragment d'ADN de Néandertalien, qui paraît confirmer - mais de manière encore fragile - la séparation des deux espèces, et donc l'impossibilité de leur interfécondité.
Les avancées de la génétique et de la biologie moléculaire ont conduit à poser en termes nouveaux la question de l'origine d'Homo sapiens et de la diversité humaine actuelle. Au milieu du XXème siècle, Franz Weidenreich, se fondant sur l'étude des Hominidés fossiles de Chine, les "Sinanthropes", considérait qu'"il doit y avoir eu non un seul, mais plusieurs centres où l'homme s'est développé ". Selon lui, la part trop importante faite aux fossiles européens avait masqué l'existence d'importantes particularités locales chez les Hominidés du Paléolithique inférieur (par exemple entre les Sinanthropes et les Pithécanthropes de Java). Au cours de l'évolution parallèle de ces groupes isolés les uns des autres par des barrières géographiques, les différences déjà présentes à ce stade ont pu se perpétuer jusqu'aux formes actuelles. Ces idées restent aujourd'hui à la source des approches "polycentristes" qui tentent de reconstituer le réseau complexe des origines des populations humaines actuelles, héritières selon eux de formes locales d'Homo erectus, remontant à 500 000 ans, voire 1 million d'années. Cette approche, qui privilégie l'étude des fossiles asiatiques, se donne pour une critique des mythes "édéniques" en même temps que de l'eurocentrisme qui a longtemps prévalu dans l'étude de la diversité au sein de l'humanité actuelle et fossile.
Face à ces positions "polycentristes", les tenants du "monocentrisme" défendent la thèse d'un remplacement rapide des formes d'hominidés primitifs par des Homo sapiens anatomiquement modernes : ils s'efforcent, à partir de l'étude des différences morphologiques, mais aussi des données de la biologie moléculaire, de reconstituer l'origine unique de toutes les populations humaines. Ces études ont abouti à un calcul des "distances génétiques" entre les populations actuelles, et avancé l'hypothèse d'une "Ève africaine" qui serait la "mère" commune de toute l'humanité
La thèse de l'origine unique et africaine de l'espèce Homo sapiens, il y a quelque 200 000 ans, irait dans le sens d'une séparation récente des populations humaines actuelles, et d'une différence très faible entre elles. Mais elle demande à être confirmée, non seulement par de nouvelles expériences et un échantillonnage rigoureux, mais aussi par les témoignages paléontologiques, rares à cette époque dans ce domaine géographique.
La mise en place de l'arbre généalogique de la famille humaine au cours de l'histoire de la paléoanthropologie et de la préhistoire reste aujourd'hui encore l'objet de discussions, qui concernent tant les schèmes évolutifs et les processus environnementaux que les critères biologiques et culturels qui y sont à l'Suvre. Lhistoire de la famille humaine apparaît fort complexe dès ses origines : aux racines de l'arbre généalogique, entre 4 millions et 1 million d'années, les Hominidés se diversifient en au moins deux genres (Australopithecus et Homo) et un véritable buissonnement d'espèces, dont certaines ont été contemporaines, parfois dans les mêmes sites. La multiplication des découvertes, l'introduction des méthodes de classification informatisées, et les bouleversements des paradigmes de savoir, ont abouti à rendre caduque la recherche d'un unique "chaînon manquant" entre l'Homme et le singe. L'espèce Homo sapiens a été resituée dans le cadre d'une famille qui a connu une grande diversification dans tout l'Ancien Monde. Que la plupart des espèces d'Hominidés se soient éteintes est un phénomène banal dans l'histoire du vivant, et ne signifie certainement pas que la nôtre fût la seule destinée à survivre. Plusieurs dizaines de milliers d'années durant, les Néandertaliens ont prospéré et parfois même cohabité avec notre espèce - et ils se sont éteints, comme d'ailleurs la plupart des espèces vivantes, il y a seulement un peu plus de 30 000 ans, pour des raisons qui restent inconnues. Mais ils auraient pu survivre, et la vision que nous avons de nous-mêmes en eût sans doute été fortement modifiée...
Le devenir des cultures humaines
"L'évolution [humaine] a commencé par les pieds"... aimait à dire par provocation André Leroi-Gourhan, insistant sur le fait que l'acquisition la bipédie précède dans l'histoire humaine le développement du cerveau.
De fait, des découvertes récentes ont montré que la bipédie a sans doute été acquise très tôt dans l'histoire de la famille humaine, il y a 3 ou 4 millions d'années. Les études menées sur la locomotion des Australopithèques ont conclu que ceux-ci marchaient déjà sur leurs deux pieds, même s'il leur arrivait parfois de se déplacer par brachiation - en se suspendant à l'aide de leurs bras. Les traces de pas découvertes en 1977 à Laetolil (Tanzanie ) et datées de 3,6 millions d'années sont bien celles de deux individus parfaitement bipèdes, marchant côte à côte... Elles ont confirmé le fait que la station redressée et la marche bipède étaient déjà acquises par ces Hominidés primitifs, - bien avant que la taille du cerveau n'atteigne son développement actuel.
Le développement du cerveau est certainement le trait le plus remarquable de la morphologie humaine. Des moulages naturels d'endocrânes fossiles - comme celui de lenfant de Taung, découvert en 1925 - ou des moulages artificiels obtenus à partir de limpression du cerveau sur la paroi interne du crâne dautres Hominidés fossiles ont permis de suivre les étapes de cette transformation du volume cérébral, de l'irrigation et de la complexification des circonvolutions cérébrales au cours de l'évolution des Hominidés. La question reste cependant posée du "Rubicon cérébral" - elle implique qu'il existerait une capacité endocrânienne au-delà de laquelle on pourrait légitimement considérer qu'on a affaire à des représentants du genre Homo, dignes d'entrer dans la galerie de nos ancêtres... La définition, longtemps discutée, d'Homo habilis comme premier représentant du genre humain, a fait reculer cette frontière à 600 cm3... et peut-être même encore moins : il faut donc bien admettre que le développement du cerveau n'a pas été l'unique "moteur" du développement humain : il s'associe à d'autres traits anatomiques propres à l'homme, station redressée, bipédie, morphologie de la main, fabrication et utilsation d'outils, usage d'un langage articulé...
La main humaine a conservé le schéma primitif, pentadactyle, de l'extrémité antérieure des Vertébrés quadrupèdes. La caractéristique humaine résiderait dans le fait que chez l'Homme le membre antérieur est totalement libéré des nécessités de la locomotion. Mise en rapport avec le développement du cerveau, la libération de la main ouvre à l'Homme les possibilités multiples de la technicité. L'avènement d'une "conscience" proprement humaine se situerait donc du côté de ses productions techniques.
L'outil est-il autant qu'on le pensait naguère porteur de la différence irréductible de l'homme ? Éthologistes, préhistoriens et anthropologues ont cherché à comparer, sur le terrain archéologique ou expérimental les "cultures" des Primates et celles des premiers Hominidés fossiles. Ils proposent des conclusions beaucoup plus nuancées que les dichotomies abruptes de jadis. Si l'outil définit l'Homme, l'apparition de l'Homme proprement dit ne coïncide plus avec celle de l'outil. Certains grands Singes savent utiliser et même fabriquer des outil. L'étude fine de la technicité des Panidés a également conduit à en observer des formes diversifiées dans différents groupes géographiquement délimités, et certains chercheurs n'hésitent pas à parler de "comportements culturels" chez ces Singes. D'autre part, les premières industries de pierre connues sont probablement l'Suvre des Australopithèques : ces hominidés au cerveau guère plus volumineux que celui d'un gorille sont-ils les auteurs des "pebble tools" ou des industries sur éclats vieilles d'environ 2,5 millions d'années - qui ont été trouvés associées à eux dans certains sites africains ? Beaucoup l'admettent aujourd'hui ... mais d'autres restent réticents à attribuer ce trait culturel à un Hominidé qui ne se situe pas dans notre ascendance ! Il a donc fallu repenser les "seuils" qui naguère semblaient infranchissables, non seulement entre grands Singes et premiers Hominidés, mais aussi entre les différents représentants de la famille humaine.
L'Homme seul serait capable de prévision, d'intention : Il sait fabriquer un outil pour assommer un animal ou découper ses chairs -et, plus encore, un outil pour faire un outil. Instrument du travail, l'outil est lui-même le produit d'un acte créateur. Si les vestiges osseux sont rares et se fossilisent mal, d'innombrables silex taillés, des primitifs "galets aménagés" aux élégantes "feuilles de laurier" solutréennes et aux pointes de flèches magdaléniennes permettent de suivre à la trace les chemins qu'ont empruntés les Hommes, d'évaluer leurs progrès dans la conquête et la maîtrise de la nature, de percevoir la complexité croissante de leurs échanges et de leurs communications.
Les "cultures" préhistoriques ont dans le passé été caractérisées, presque exclusivement, par l'outillage lithique qui les composent. Le Moustérien, le Solutréen, le Magdalénien, ce sont d'abord des types d'outils et de techniques lithiques décrits, inventoriés, étudiés dans leur distribution statistique. Cependant les approches contemporaines tendent à élargir cette notion de "cultures" en mettant en lumière d'autres traits culturels importants, inventions techniques essentielles comme celle du feu, de l'aiguille et du poinçon, de la corde, et du tissage, structures d'habitat, organisation du groupe social, division du travail...
Aux périodes les plus récents du Paléolithique supérieur, l'art, mobilier ou rupestre, traduit le fait que l'homme a désormais accès au symbolique, à la représentation. Innombrables sont les objets en ivoire, en os ou en bois de renne, sculptés ou gravés découverts sur les sites préhistoriques, et témoignant de la fécondité artistique des chasseurs cueilleurs de la préhistoire, et de ce que ces primitifs du Paléolithique avaient un talent et une sensibilité dartistes, très proches en somme de celles de lHomme daujourdhui.
Devant ces figurations animales et humaines ou ces signes abstraits, le problème se pose de leur signification : labbé Breuil nhésitait pas à prêter un sentiment religieux à ses auteurs, et à interpréter les figures et les symboles sculptés, gravés, dessinés ou peints du Paléolithique comme la manifestation de cultes animistes et de rituels chamaniques, que l'on retrouverait chez certains peuples actuels. La thèse du chamanisme a fait l'objet d'importantes critiques, elle a pourtant été récemment reprise par le préhistorien français Jean Clottes et l'anthropologue sud-africain David Lewis-Williams, qui proposent d'interpréter les symboles de l'art paléolithique en s'inspirant de ceux du chamanisme, lisibles selon eux dans l'art rupestre des Bushmen d'Afrique australe. Cette interprétation, étayée aussi par des arguments neuro-physiologiques, ne laisse pas d'être fragile, précisément par l'universalité qu'elle suppose, excluant les lectures de cet art qui viseraient à prendre en compte son contexte particulier et son symbolisme propre
La faculté symbolique dont témoigne l'art est sans aucun doute liée aux possibilités de l'échange et de la parole. On sait que certaines régions du cerveau humain sont dévolues à la parole et le développement de ces aires cérébrales a pu être observé, dès Homo habilis, voire même peut-être chez les Australopithèques. Certaines caractéristiques des organes de la phonation (larynx, apophyses de la mandibule pour linsertion de la langue, résonateurs nasaux) sont également invoquées, mais beaucoup dincertitudes subsistent : le grognement, le cri, le chant, ont-ils été les formes primitives de l'expression humaine ? Le langage "doublement articulé" - au niveau phonétique et sémantique - existe-t-il déjà aux stades anciens du genre Homo, voire dès Australopithecus, ou apparaît-il seulement avec l'Homme moderne ? Le langage humain résulte-t-il d'un "instinct" déterminé génétiquement qui dès les origines de la famille humaine nous distingue déjà des autres primates ? ou faut-il le considérer comme un produit de la société et de la culture, contemporain de la maîtrise des symboles de l'art ?
Nouveaux regards sur la femme préhistorique
Le XIXème siècle n'avait pas donné une image très glorieuse de la femme préhistorique. Le héros de la préhistoire, de Figuier à Rosny, cest l'Homme de Cro-Magnon, armé d'un gourdin, traînant sa conquête par les cheveux pour se livrer à d'inavouables orgies dans l'obscurité de la caverne& La sauvagerie des "âges farouches" est alors prétexte à des allusions à la brutalité sexuelle, au viol. Cet intérêt pour les mSurs sexuelles des origines est sans doute l'envers de la pruderie d'une époque. Il rejoint celui que l'on commence à porter aux ténèbres de l'âme, aux pulsions primitives, inconscientes, qui s'enracinent dans les époques primitives de l'humanité.
Notre regard aujourdhui semble se transformer. Notre héros de la préhistoire, c'est une héroïne, Lucy, une Australopithèque découverte en 1974 dans le site de Hadar en Ethiopie et qui vécut il y a quelque 3 millions d'années. Innombrables sont les récits qui nous retracent les bonheurs et les aléas de son existence. Signe des temps : la femme a désormais une place dans la préhistoire.
Les anthropologues ont renouvelé l'approche de la question des relations entre les sexes aux temps préhistoriques en mettant l'accent sur l'importance, dans le processus même de l'hominisation, de la perte de l'oestrus qui distingue la sexualité humaine de celle des autres mammifères. Tandis que l'activité sexuelle chez la plupart des animaux, y compris les grands Singes, est soumise à une horloge biologique et hormonale, celle qui détermine les périodes de rut - la sexualité humaine se situe sur le fond d'une disponibilité permanente. Cette disponibilité fut sans doute la condition de l'apparition des normes et des interdits qui dans toutes les sociétés limitent les usages et les pratiques de la sexualité. Peut-être a-t-on vu alors naître des sentiments de tendresse, s'ébaucher des formes de la vie familiale, de la division du travail - et s'établir les règles morales, l'interdit de l'inceste et les structures de la parenté dont les anthropologues nous ont appris quils se situent au fondement de toute culture.
Depuis environ trois décennies, des travaux conjugués d'ethnologie et de préhistoire ont remis en cause les a priori jusque là régnants sur linanité du rôle économique et culturel des femmes dans les sociétés paléolithiques. Les recherches des ethnologues sur les Bushmen dAfrique du Sud ont ouvert de nouvelles voies pour la compréhension des modes de vie et de subsistance, des structures familiales et de la division sexuelle du travail chez les peuples de chasseurs-cueilleurs. Dans ces groupes nomades, les femmes, loin d'être passives, vouées à des tâches subalternes, immobilisées par la nécessité délever les enfants, et dépendantes des hommes pour l'acquisition de leur subsistance, jouent au contraire un rôle actif à la recherche de nourriture, cueillant, chassant à loccasion, utilisant des outils, portant leurs enfants avec elles jusquà lâge de quatre ans, et pratiquant certaines techniques de contrôle des naissance (tel que l'allaitement prolongé). Ces études ont conduit les préhistoriens à repenser l'existence des Homo sapiens du Paléolithique supérieur, à récuser les modèles qui situaient la chasse (activité exclusivement masculine) à lorigine de formes de la vie sociale, et à élaborer des scénarios plus complexes et nuancés, mettant en scène la possibilité de collaborations variées entre hommes et femmes pour la survie du groupe.
La figure épique de Man the Hunter, le héros chasseur poursuivant indéfiniment le gros gibier a vécu. Il faut désormais lui adjoindre celle de Woman the gatherer, la femme collectrice (de plantes, de fruits, de coquillages). Larchéologue américain Lewis Binford est allé plus loin en insistant sur l'importance au Paléolithique des activités, non de chasse, mais de charognage, de dépeçage, de transport et de consommation de carcasses d'animaux morts, tués par d'autres prédateurs. Des preuves dactivités de ce type se trouveraient dans la nature et la distribution des outils de pierre sur certains sites de dépeçage, et dans la sélection des parties anatomiques des animaux consommés. Si tel est le cas, des femmes ont pu participer à ces activités, et être, tout autant que les hommes, pourvoyeuses de nourriture.
Il se peut aussi que, contrairement aux idées reçues, les femmes aient été très tôt techniciennes, fabricatrices d'outils quelles se soient livrées par exemple à la taille des fines industries sur éclats qui abondent à toutes les époques du Paléolithique -, qu'elles aient inventé il y a quelque 20 000 ans, la corde et l'art du tissage de fibres végétales, dont témoignent les parures et les vêtements qui ornent certaines statuettes paléolithiques : la résille qui coiffe la "dame à la capuche" de Brassempouy, le "pagne" de la Vénus de Lespugue, les ceintures des Vénus d'ivoire de Kostienki, en Russie&
Ces Vénus paléolithiques nous donnent-elles pour autant une image réaliste de la femme préhistorique ? Si tel était le cas, il faudrait croire, comme le disait avec humour Leroi-Gourhan, que la femme paléolithique était une nature simple, nue et les cheveux bouclés, qui vivait les mains jointes sur la poitrine, dominant sereinement de sa tête minuscule lépouvantable affaissement de sa poitrine et de ses hanches &Ces Vénus ont suscité une multitude d'interprétations - tour à tour anthropologiques, physiologiques, voire gynécologiques, religieuses, symboliques. Certains, s'appuyant sur l'abondance dans lart paléolithique des images sexuelles et des objets réalistes - vulves féminines ou phallus en érection, scènes d'accouplement, corps de femmes dont les seins, les fesses et le sexe sont extraordinairement soulignés, y ont vu l'expression sans détour de désirs et de pratiques sexuels, en somme l'équivalent paléolithique de notre pornographie&
Des études féministes ont mis en cause le fait, jusque là donné pour une évidence, qu'il puisse s'agir d'un art fait par des hommes et pour des hommes. Chez les Aborigènes australiens, l'art sacré est en certaines occasions réservé aux femmes. Si on admet que l'art paléolithique a pu avoir une fonction rituelle et religieuse, ses figurations et ses objets pourraient avoir été destinés, plutôt qu'à un usage exclusivement masculin, à l'usage des femmes ou à l'initiation sexuelle des adolescentes. L'ethnologue californienne Marija Gimbutas a reconnu dans ces Vénus paléolithiques des images de la "Grande Mère", figure cosmogonique, symbole universel de fécondité, qui se retrouve au Néolithique et jusqu'à l'Age du Bronze dans toute l'Europe : ces sociétés dont les religions auraient été fondées sur le culte de la "Grande Déesse" auraient connu, de manière continue jusqu'à une époque relativement récente, des formes de pouvoir matriarcales et des formes de transmission matrilinéaires, avant d'être remplacées par des structures sociales à dominance masculine et des religions patriarcales. Cette construction, qui reprend la thèse du matriarcat primitif à lappui de thèses féministes, reste pourtant fragile : lhistoire ultérieure ne nous montre-t-elle pas que le culte de la mère peut exister dans des religions à dominance masculine, et dans des sociétés comportant une bonne part de misogynie ?
Quoi quil en soit, limage de la femme du Paléolithique a changé. Sil reste souvent à peu près impossible de désigner précisément ce qui dans les rares vestiges de la préhistoire, ressortit à lactivité de lun ou lautre sexe, ces nouvelles hypothèses et ces nouveaux savoirs, qui ne sont pas sans liens avec les transformations de nos sociétés, nous livrent une image plus vivante, plus colorée, plus ressemblante peut-être, de la femme des origines.
Conclusion
Comme tous les savoirs de l'origine, la préhistoire est un lieu inépuisable de questionnements, de rêves et de fantasmes. Elle représente un monde à la limite de la rationalité et de l'imaginaire, où peut s'exprimer le lyrisme, la fantaisie, l'humour, l'érotisme, la poésie. Mais l'imagination, en ce domaine, ne saurait être réduite à une combinatoire de thèmes fixés, archétypes ou lieux communs. Elle invente, elle crée, elle se renouvelle en fonction des découvertes et des événements, mais aussi des représentations prégnantes en un moment et dans un contexte particulier.
La préhistoire est une science interdisciplinaire, qui mobilise la géologie, la biologie, l'archéologie, l'ethnologie, l'histoire de l'art& et qui s'enrichit des développement de tous ces savoirs. Mais elle est avant tout une discipline historique, dont les documents sont pourtant beaucoup plus pauvres que ceux de l'histoire : ce sont des traces, des vestiges fragmentaires et muets, auxquels il faut donner sens, et dont l'interprétation est un lieu privilégié de projection de nos propres cadres mentaux et culturels.
Cest pourquoi on peut prophétiser sans risque que l'humanité préhistorique du XXIème siècle ne ressemblera pas à celle du XIXème ou du XXème siècle. Non seulement parce que des découvertes, suscitées ou inattendues, surgiront du terrain ou du laboratoire. Mais aussi parce que nos sociétés elles-mêmes, et la conscience que nous en avons, changeront elles aussi. Car l'Homme préhistorique a une double histoire : la sienne propre, et celle de nos représentations.
VIDEO canal U LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
ANGKOR |
|
|
| |
|
| |
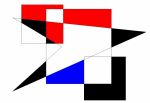
Angkor
INTRODUCTION
Angkor (du sanskrit nagara, ville, capitale) comprend plus de 80 sites classés, certains considérables, groupés dans le voisinage ou à l'intérieur de l'enceinte d'Angkor Thom. Leurs dates s'échelonnent, environ, entre 650 et la fin du xiiie s. Capitale fondée par Yashovarman Ier (889-vers 900), pillée par les Chams en 1177, reconstruite par Jayavarman VII (1181-vers 1218), elle a été la résidence de presque tous les souverains khmers jusqu'à sa prise par les armées d'Ayuthya (1431). Décrite par l'envoyé chinois Zhou Daguan (vers 1296), signalée par les missionnaires européens dès la fin du xvie s., Angkor a été révélée à l'Occident par les descriptions des voyageurs de la seconde moitié du xixe s. (Henri Mouhot, Adolf Bastian, J. Thomson, etc.) et, surtout, par les premières missions françaises (Francis Garnier, Louis Delaporte, Lucien Fournereau, etc.). Après la cession des provinces de Battambang et de Siem Reap par le Siam (1907), l'École française d'Extrême-Orient, qui y avait déjà créé un centre d'études, s'est vu confier « l'exploration, la conservation et la restauration » des monuments d'Angkor. C'est essentiellement leur étude qui a permis de retrouver l'histoire du Cambodge et celle de son art, que le site suffirait presque à illustrer. Laissés à l'abandon depuis 1973 et souvent pillés, les monuments d'Angkor ont beaucoup souffert des conflits cambodgiens. En 1991, un plan de sauvegarde et de mise en valeur de l'ensemble des temples a été mis en œuvre sous l'égide de l'Unesco.
LA PREMIÈRE ANGKOR
Parmi les monuments antérieurs à la fondation de la ville, Prasat Ak Yum semble fournir le premier exemple de temple sur pyramide à gradins (« temple-montagne »), type d'édifice caractéristique de l'architecture khmère et réservé aux temples personnels des souverains.
En fondant Yashodharapura (« la ville qui préserve la gloire »), Yashovarman Ier entend garantir la royauté en y affirmant la présence de Siva et en la rattachant aux fondations de sa dynastie par un système complexe : fondation au bénéfice de ses ancêtres dans l'ancienne capitale délaissée ; lien établi avec le Phnom Kulên (où avait été instauré le rituel royal) en détournant la rivière qui y prend source jusqu'à la nouvelle capitale ; création d'un vaste bassin sacré à l'est ; construction au sommet du Phnom Bakheng, « mont central », d'un temple-montagne, dont les 109 sanctuaires soulignent le symbolisme élaboré. Abandonnée de 921 à 944 au profit de Chok Gargyar (aujourd'hui Koh Ker), Angkor sera réoccupée par Râjendravarman II, qui, pour rétablir la continuité, construira deux temples-montagnes, Mébon oriental (952) et Prè Rup (961), l'une des grandes réussites khmères, et commencera le Palais Royal, achevé par son successeur. Du début du xie s., Tà Kèv, premier temple-montagne entièrement en grès, est demeuré inachevé, mais le Baphuon, élevé un demi-siècle plus tard, couvert de bas-reliefs, témoignera d'une hardiesse qui lui a été fatale, exigeant des travaux de reprise totale. Dans le même temps, le creusage du Baray occidental, dédié à Vishnu, plaçait la cité sous une double protection et constituait une réserve d'eau supplémentaire.
ANGKOR VAT (LA CITÉ-MONASTÈRE)
Édifié par Suryavarman II (1113-vers 1150), aussi remarquable par l'équilibre de son plan que par le classicisme de ses proportions, c'est le temple-montagne achevé et le chef-d'œuvre de l'architecture khmère. Bordée par un large bassin-fossé, une enceinte de 5,6 km de tour, avec entrée monumentale à l'ouest, enferme le complexe étagé de trois galeries, avec pavillons axiaux et tours-sanctuaires aux angles des deux étages supérieurs, conduisant au sanctuaire central, d'une admirable élévation. À l'ouest, le cloître cruciforme, qui unit les deux galeries inférieures, est une composition d'une étonnante noblesse. La sculpture est d'une richesse et d'une distinction extrêmes : décors courants des murs, des cadres de portes, avec leurs délicates figures féminines et le jeu savant des rinceaux, et, surtout, tout au long de la galerie du premier étage, le vaste ensemble de bas-reliefs illustrant l'épopée indienne. En raison de son orientation, que sa destination vishnouite pourrait suffire à expliquer, on a souvent insisté sur la destination funéraire d'Angkor Vat. Il a été transformé en temple bouddhique peut-être dès le xve s. ; ses bas-reliefs ont été achevés, avec moins d'art, vers le milieu du xvie s.
C'est la nouvelle Yashodharapura, construite par Jayavarman VII pour succéder à celle ruinée par les Chams, que les chroniques et une épigraphie tardive définiront comme la « cité d'Indra ». Enfermant le Palais Royal transformé et embelli (terrasses « des Éléphants », « du Roi Lépreux » …), ainsi que des temples antérieurs, dans une puissante muraille de 12 km de tour, haute de 8 m, entourée d'une douve large de 100 m, dotée en outre d'un important système de canaux, elle est moins une place forte que la cité des dieux par excellence, microcosme centré sur le Bayon, temple où triomphe le symbolisme architectural et où toutes les anciennes divinités du royaume s'intègrent à la perspective mahayanique. Devant cinq portes monumentales protégées par les Gardiens des Orients, des chaussées bordées, sur chaque côté, de 54 géants portant embrassé un naga matérialisent l'arc-en-ciel d'Indra, qui permettra d'accéder du monde des humains au monde des dieux (Paul Mus)… D'autres grandes fondations de Jayavarman VII précisent la signification d'Angkor Thom : Banteay Kdei, en l'honneur du Jina ; Ta Prohm (1186), au bénéfice de sa mère et de son maître spirituel ; Preah Khan (1191), au bénéfice de son père et symbole de la victoire finale sur le Champa ; Neak Pean, garant d'une royauté qui se veut universelle et inviolable…
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
DIRECTOIRE |
|
|
| |
|
| |

Directoire
Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
Régime qui gouverna la France depuis la fin de la Convention nationale (26 octobre 1795) [4 brumaire an IV] jusqu'au 9 novembre 1799 (18 brumaire an VIII).
1. Les institutions
Ce régime est organisé par la Constitution de l'an III, votée par la Convention le 22 août 1795. Ses tenants désiraient conserver le nouvel état social né des principes de 1789, empêcher toute concentration du pouvoir et donc toute possibilité de dictature personnelle comparable à celle de Robespierre, défendre les places acquises, les biens – souvent considérables – et les vies des révolutionnaires nantis.
Le pouvoir législatif est confié à deux Conseils, les Cinq-Cents et les Anciens, élus au suffrage censitaire. De fait, les droits politiques sont réservés aux possédants. Tout électeur au premier degré doit être contribuable (le sixième environ des hommes en âge de voter), ce qui élimine les plus pauvres. Les électeurs au second degré, qui choisissent les députés, les administrateurs locaux, les juges, doivent avoir plus de vingt-cinq ans et justifier d'un revenu au moins égal à deux cents journées de travail. Ce régime censitaire, qui réduit le nombre d'électeurs au second degré à trente mille, établit donc le privilège de la fortune.
La Constitution organise une rigoureuse séparation des pouvoirs et divise chacun de ces pouvoirs entre plusieurs corps ou individus. Les députés, élus pour trois ans, sont renouvelés par tiers chaque année, ce qui vise à empêcher la formation de partis. Une fois élus, les députés forment alors, par tirage au sort, le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens (dont les membres devaient avoir 40 ans au moins). Les Cinq-Cents ont seuls l'initiative des lois, que les Anciens ne peuvent qu'approuver sans amendement ou rejeter.
Le pouvoir exécutif est confié à un Directoire de cinq membres (les Directeurs) élus par les Anciens sur une liste de dix candidats présentée par les Cinq-Cents. Renouvelable par cinquième, tous les ans, ce Directoire ne peut dissoudre les Conseils. Désigné par tirage au sort, le directeur sorti de charge ne peut être réélu avant cinq ans; ainsi, le Directoire doit rester un collège sans aucune prépondérance personnelle. Les directeurs délibèrent à la majorité, nomment et révoquent les ministres, disposent de la force armée.
Dans chaque département, un commissaire représente le pouvoir central et surveille les autorités locales, dont l'autonomie demeurait fort étendue.
Le mécanisme constitutionnel ne prévoyait pas les conflits entre les pouvoirs. Ni les Conseils ni les directeurs ne pouvaient agir les uns sur les autres. Il leur fallait s'entendre ou régler par des coups d'État leurs oppositions.
2. Le premier Directoire (octobre 1795-septembre 1797)
Les cinq Directeurs (Barras, Rewbell, Carnot, Letourneur et La Révellière-Lépeaux), comme la majorité des membres des Conseils, étaient des anciens conventionnels (une loi d’août 1795 stipulait que les deux tiers des nouveaux députés seraient obligatoirement pris parmi les anciens Conventionnels).
Barras, directeur de 1795 à 1799, a symbolisé le régime tout entier, d'autant qu'il ne tira jamais la boule noire qui l'aurait exclu du Directoire. Ancien noble, Conventionnel et régicide, son avidité était notoire. Du reste, la corruption était générale dans les milieux politiques ; il s'y mêlait le goût des plaisirs : c'était le temps des Merveilleuses et des Incroyables avec leurs excentricités vestimentaires et leur luxe de parvenus. La classe dirigeante parisienne était faite de politiciens discrédités, de financiers trop vite enrichis, et d'aventuriers. À la crise morale qui touchait l'élite nouvelle sortie de la Révolution s'ajoutait la misère du peuple, qui, littéralement, mourait de faim à Paris et dans les principales villes. Il n'y avait plus ni industrie ni commerce ; l'inflation des assignats (papier-monnaie) ruinait les rentiers et l'État, qui ne payait ni ses fonctionnaires ni ses soldats. Le désordre était latent dans tous les départements, où sévissait le brigandage.
L'installation du Directoire fut rendue d'autant plus difficile que les cinq directeurs avaient des conceptions politiques et des tempéraments fort divers, ce qui allait jusqu'à l'inimitié. Cependant, ils s'attribuèrent dès le départ des domaines d'intervention en fonction de leurs compétences et de leur région d'origine, et s'entendirent, au terme de tractations parfois délicates, pour nommer les ministres. Tout en tentant de juguler la crise financière en créant un nouveau papier-monnaie, le mandat territorial (mars 1796), le Directoire doit faire face à l'opposition des jacobins et à celle des royalistes. Les premiers, qui conspirent avec Babeuf pour renverser le régime, sont mis en échec (les conspirateurs sont arrêtés le 10 mai 1796). Contre les seconds, qui triomphent aux élections de 1797 et choisissent un des leurs comme Directeur (Barthélemy), les « triumvirs » (Barras, Rewbell, La Révellière-Lépeaux) font appel à l'armée, qui écarte la restauration monarchique par le coup d'État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) : 177 députés royalistes sont exclus, certains sont déportés en Guyane ; Carnot (qui est jugé trop modéré et doit s’exiler) et Barthélemy sont remplacés par F. de Neufchâteau et Merlin de Douai.
À ces difficultés intérieures s'opposent, à l'extérieur, les succès de la politique de Bonaparte (indépendante de celle du Directoire), dont la brillante campagne d'Italie (victoires d'Arcole et de Rivoli, 1796-1797) aboutit aux préliminaires de Leoben (avril 1797) suivis du traité de Campoformio (octobre 1797) et à la création d'États alliés, ou « républiques sœurs » (→ République Cisalpine et République Ligurienne).
3. Le second Directoire (septembre 1797-novembre 1799)
Durant cette période, la lutte contre les royalistes et les jacobins se poursuit. En 1798, tandis que 160 émigrés sont exécutés et que 263 prêtres réfractaires sont déportés, les Directeurs, à nouveau en minorité dans les Conseils après les élections, mettent à profit une loi votée le 12 pluviôse (31 janvier) pour invalider 106 nouveaux élus jacobins et pour les remplacer par leurs concurrents, battus mais partisans du Directoire. C’est ce que l'on appelle avec quelque exagération le coup d'État du 22 floréal an VI (11 mai 1798). La manœuvre a consisté à admettre que des députés élus par des assemblées dissidentes d'électeurs – des « scissions » ont en effet été organisées par le gouvernement – peuvent être validés en lieu et place de députés élus par des assemblées majoritaires.
À la faveur d'une période de stabilité, le Directoire entreprend une œuvre réformatrice qui prépare la voie à celle de Napoléon : il réalise la banqueroute des deux tiers de la dette et la consolidation du tiers restant, organise l'administration des contributions, stimule l'industrie, multiplie les écoles centrales et instaure la conscription (« loi Jourdan », 5 septembre 1798).
À l'extérieur, il poursuit une politique d'expansion : de nouvelles républiques sœurs sont créées (Républiques romaine et helvétique, février-avril 1798) et Bonaparte entreprend sa campagne d'Égypte (mai). Mais cette politique expansionniste provoque la formation de la deuxième coalition européenne contre la France (décembre 1798), qui est encerclée à l'été de 1799. Les défaites extérieures (à Stockach, Cassano et Novi) suscitent inquiétude et mécontentement dont, par le coup d'État du 30 prairial an VII (18 juin 1799), profitent les jacobins pour renverser Merlin de Douai et La Révellière-Lépeaux (remplacés par Ducos et Moulin), et faire voter des mesures « terroristes » (levée en masse, loi des otages contre les nobles, etc.). Pour éliminer les jacobins, réviser la Constitution et créer un pouvoir exécutif fort, le Directeur Sieyès, soutenu par Barras et Ducos, fait appel à Bonaparte, qui, par le coup d'État des 18 et 19 brumaire an VIII (9-10 novembre 1799), renverse le Directoire et établit le Consulat.
Pour en savoir plus, voir l'article Napoléon Ier.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
