|
| |
|
|
|
 |
|
Greffe de peau : une nouvelle cible moléculaire pour activer les cellules souches |
|
|
| |
|
| |

Greffe de peau : une nouvelle cible moléculaire pour activer les cellules souches
COMMUNIQUÉ | 23 OCT. 2019 - 12H44 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | SANTÉ PUBLIQUE
Une équipe de chercheur du CEA-Jacob et de l’Inserm vient de publier une étude dans laquelle elle démontre le rôle central du facteur de transcription KLF4 dans le contrôle de la prolifération des cellules souches de l’épiderme et de leur capacité à régénérer ce tissu. Cette étude ouvre des perspectives pour la médecine régénérative de la peau. Elle est publiée le 21 octobre dans Nature Biomedical Engineering.
L’épiderme humain se renouvelle entièrement tous les mois grâce à la présence de cellules souches dans sa couche la plus profonde, qui donnent naissance à l’ensemble des couches plus superficielles de ce tissu. Le décryptage des gènes assurant le contrôle du caractère souche, ou « stemness », reste à ce jour une énigme imparfaitement résolue, en particulier pour la peau humaine.
Les découvertes d’une équipe de recherche française du CEA, de l’Inserm et de l’Université de Paris, générées en collaboration avec I-Stem, le laboratoire de l’AFM-Télethon, et l’Université d’Évry, ouvrent des perspectives pour la médecine régénérative cutanée, en particulier pour la bio-ingénierie des greffons de peau destinés à la reconstruction tissulaire. En effet, l’amplification massive en culture de cellules de l’épiderme (appelées kératinocytes) est nécessaire à la production de greffons. Elle est effectuée à partir d’un échantillon de peau issu du patient qui contient des kératinocytes matures et une population minoritaire de cellules souches kératinocytaires. Cette phase d’amplification comporte un risque : elle peut s’accompagner d’une perte quantitative ou d’une altération des cellules souches, conduisant à une perte de potentiel régénératif.
Les résultats de l’étude publiée dans Nature Biomedical Engineering montrent que diminuer l’expression du gène KLF4 pendant la préparation du greffon favorise une amplification rapide de cellules souches fonctionnelles1, sans altérer leur stabilité génomique. Les kératinocytes amplifiés dans ces conditions présentent un potentiel régénératif à long terme accru dans des modèles de reconstruction épidermique in vitro et de greffes in vivo 2. KLF4 constitue donc une nouvelle cible moléculaire pour préserver la fonctionnalité des cellules souches et faire progresser la bio-ingénierie des greffons cutanés. Ces résultats constituent une démonstration de principe, qui nécessite des développements complémentaires pour envisager des applications cliniques.Parmi celles-ci, citons le soin des grands brûlés, des ulcères chroniques et la reconstruction mammaire.
Ces travaux ont été étendus à d’autres types cellulaires d’intérêt pour la thérapie cellulaire cutanée. A l’avenir, les kératinocytes produits à partir de cellules pluripotentes pourraient constituer une alternative aux cellules souches adultes dans certaines applications de bio-ingénierie de tissus reconstruits.
Une des difficultés rencontrées dans cette voie est le fait que les kératinocytes obtenus ne possèdent pas toutes les fonctionnalités des cellules souches adultes. Ils sont notamment déficients au niveau de leur potentiel de prolifération. L’étude a permis de montrer que la manipulation de l’expression de KLF4 est également adaptée à ces cellules, car la diminution de son expression dans les kératinocytes dérivés d’ESC améliore leur capacité de prolifération ainsi que leur capacité à reconstruire de la peau.
Cellules souches en culture Greffon de peau obtenu par bioingéniérie
Des cellules souches de peau humaine multipliées en culture peuvent être utilisées pour régénérer l’épiderme© LGRK, IRCM, CEA-Jacob
1 Une cellules souche fonctionnelle est capable de régénérer l’épiderme pendant toute la vie de l’individu. Ceci grâce à une capacité de prolifération à très long terme, un caractère immature et une capacité d’organisation en trois dimensions.
2 Xénogreffe de peau reconstruite humaine sur un modèle animal
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Myopathie : un gain de force musculaire chez la souris |
|
|
| |
|
| |

Myopathie : un gain de force musculaire chez la souris
COMMUNIQUÉ | 03 DÉC. 2018 - 12H26 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION
Dans la myopathie de Duchenne, les fibres musculaires sont fragilisées et enclenchent des cycles permanents de régénération, un processus soutenu par les cellules souches musculaires. Sur cette photo, lesmyofibres en rouge sont en cours de régénération et sont indicatrices des lésions multiples présentes dans tout le muscle des patients. Le pourtour des myofibres est marqué en vert. Crédit image : Mélanie Magnan/Bénédicte Chazaud/Inserm
Des souris atteintes de dystrophie musculaire de Duchenne récupèrent plus de 20% de force musculaire grâce à la metformine. Ce résultat visant à stopper le processus de remplacement progressif des fibres musculaires par du tissu fibreux caractéristique de cette maladie a été obtenu grâce aux travaux de l’équipe de Bénédicte Chazaud, chercheuse Inserm au sein de l’Unité 1217 de l’Institut NeuroMyoGène (Inserm/CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1). Ces travaux sont publiés dans la revue Cell Reports.
Les myopathies dégénératives comme la Dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) sont incurables. Elles sont caractérisées par des lésions répétées des fibres du muscle qui déclenchent des cycles de régénération permanents, associés à une inflammation chronique. Ceci conduit sur le long terme à la perte des fibres musculaires, qui sont progressivement remplacées par de la fibrose, c’est-à-dire une augmentation anormale de tissu non fonctionnel (fibres de collagène). Les mécanismes de fibrogenèse sont mal connus dans ce contexte.
Dans cette nouvelle étude, les chercheurs montrent que la fibrose est associée à la présence de cellules immunitaires spécifiques (macrophages pro-inflammatoires) dans le muscle de patients et de souris atteints de myopathie de Duchenne.
Ces macrophages surexpriment une protéine qui est nécessaire à la sécrétion d’un facteur de croissance (TGFβ) principal responsable de la fibrose. Une fois libéré et activé dans l’environnement cellulaire, Le TGFβ stimule la production de collagène par les fibroblastes. Cette création excessive de tissu fibreux peut être endiguée par l’activation d’un régulateur présent dans les macrophages, l’AMP kinase (AMPK), qui diminue leur état pro-inflammatoire. L’activation de l’AMPK, en diminuant l’expression de la protéine nécessaire à la sécrétion du TGFβ, limite donc la fibrose.
Les souris traitées pendant trois semaines par un activateur pharmacologique de l’AMPK, la Metformine, voient la qualité de leurs muscles s’améliorer, y compris fonctionnellement avec un gain de force musculaire. Dans ces conditions, la destruction des fibres musculaires et la création de tissu fibreux diminuent (respectivement -56% et -23%) et surtout la régénération de fibres musculaires augmente (+38%). Chez ces animaux la force mesurée au niveau des muscles entourant le tibia après le traitement augmente de plus de 20%.
Le processus inflammatoire dans le muscle semble identique chez la souris et l’homme or la Metformine est un médicament déjà utilisé chez l’homme. Ces travaux montrent que des approches pharmacologiques ciblant l’inflammation et la fibrose pourraient être envisagées pour améliorer l’état du muscle dans le contexte des myopathies dégénératives, notamment dans le cadre de thérapies cellulaires ou géniques afin d’en augmenter l’efficacité. “Cependant, rappellent les chercheurs, il faut rester précautionneux, il n’est pas question de traiter la myopathie de Duchenne avec la Metformine, mais peut-être, dans un premier temps de diminuer l’état inflammatoire des patients”.
Les chercheurs s’attachent maintenant à disséquer la grande hétérogénéité des populations de macrophages dans cette pathologie, afin d’identifier les “mauvaises” sous-populations pro-fibrosantes des “bonnes” sous-populations réparatrices, aidant à la régénération musculaire.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
à lâorigine de la satiété, des cellules du cerveau qui changent de forme après un repas |
|
|
| |
|
| |
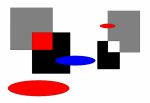
À l’origine de la satiété, des cellules du cerveau qui changent de forme après un repas
COMMUNIQUÉ | 03 MARS 2020 - 17H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
Vous venez de terminer un bon repas et vous vous sentez repu ? Des chercheurs du CNRS, de l’Inserm, d’Inrae, de l’Université de Bourgogne, d’Université de Paris et de l’Université du Luxembourg1 viennent de comprendre les mécanismes qui, dans votre cerveau, ont conduit à cet état. Il s’agit d’une cascade de réactions déclenchée par l’élévation du taux de glucose dans le sang. Cette étude, menée chez la souris, est publiée dans Cell Reports le 3 mars 2020.
Les circuits de neurones qui gouvernent les sensations de faim et de satiété dans notre cerveau ont la capacité de modifier leurs connexions, ce qui permet d’ajuster le comportement alimentaire aux conditions de vie et de maintenir un équilibre entre apports et dépenses énergétiques. Les scientifiques soupçonnent d’ailleurs que cette plasticité pourrait être altérée chez les sujets obèses.
Dans une nouvelle étude menée chez la souris, une équipe dirigée par Alexandre Benani, chercheur du CNRS au Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CNRS/Inrae/Université de Bourgogne/ AgroSup Dijon) montre que ces circuits sont activés à l’échelle d’un repas, ce qui contribue à la régulation du comportement alimentaire. Mais cette activation ne passe pas par un changement dans les « branchements » du circuit.
Les scientifiques se sont intéressés aux neurones POMC de l’hypothalamus, situés à la base du cerveau. Ces neurones sont connus pour limiter la prise alimentaire. Ils reçoivent un grand nombre de terminaisons nerveuses provenant d’autres régions du cerveau et les connexions de ce circuit sont malléables : elles peuvent se faire et se défaire très rapidement au gré des fluctuations hormonales. Les chercheurs ont observé qu’après un repas équilibré, ce circuit neuronal n’est pas modifié. En revanche, d’autres cellules nerveuses associées aux neurones POMC, les astrocytes, changent de forme.
Les astrocytes sont des cellules nerveuses en forme d’étoiles, d’abord décrites pour leur rôle de support des neurones. Dans les conditions habituelles, ils recouvrent étroitement les neurones POMC et agissent un peu à la manière de plaquettes de frein, limitant leur activité. Après un repas, le taux de glucose dans le sang (glycémie) s’élève transitoirement et ce signal est ressenti par les astrocytes qui se rétractent en moins d’une heure. Le « frein » étant levé, les neurones POMC se trouvent activés, ce qui favorise in fine le sentiment de satiété.
De manière étonnante, un repas riche en graisses n’induit pas ce remodelage. Est-ce à dire que les lipides sont moins efficaces pour couper la faim ? Les scientifiques cherchent à déterminer s’ils ne déclencheraient pas la satiété par un autre circuit. Il reste aussi à savoir si les édulcorants ont les mêmes effets ou s’ils sont de véritables leurres pour le cerveau, qui ne procurent que la sensation sucrée addictive sans couper la faim.
1 L’étude a été menée au Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CNRS/Inrae/Université de Bourgogne/Agrosup Dijon), en étroite collaboration avec des collègues de l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire (CNRS/Université Côte d’Azur), de l’Institut de génomique fonctionnelle (CNRS/Inserm/Université de Montpellier) et de l’Université du Luxembourg, et avec les contributions de l’Unité de biologie fonctionnelle et adaptative (CNRS/Université de Paris) et de l’Institut de psychiatrie et de neuroscience de Paris (Inserm/Université de Paris).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
